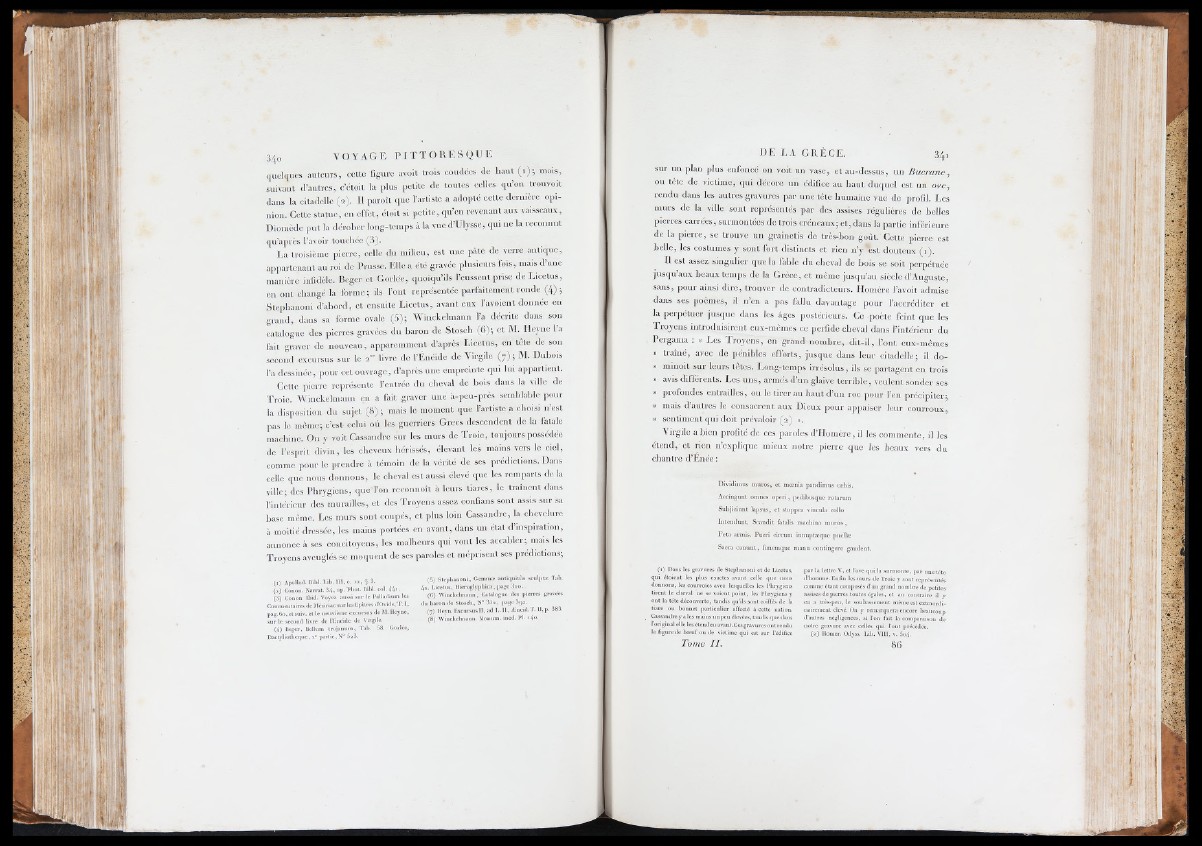
ë
■Vï-i
.‘â K
■0 '
ih - j
N:-.-
'0
| S
il
.|iieliliics ailleurs, celle figure avoil Irois coudccs dc liant ( i ) ; mais,
suivanl d’autres, c’étoit la jilas Jiclilc dc toutes celles iju’oii trouvoit
dans la citadelle (a). H Jiaroit ijac l'artiste a adojité cette dernière oj.i-
iiion. Celte staine, cn elìci, étoit si jictitc, qu’en revenant aux vaisseaux,
Oiomèdc Jint la di’rolicr loiig-tcnijis à la vue d’Ulysse, qui ne la rccomiul
qu’après l’avoir loiiulicc (3).
J-a troisième jncrrc, celie du milieu, csl une pâle dc verre antique,
ajipartcmmt an roi dc Prusse. Elle a été gravée plusieurs fois, mais d’une
manière infidèle. Beger el Goricc, quoiqu’ils l’oussciit prise dc Licctiis,
cn ont changé la forme ; ils font représentée parfaitement ronde (/,) ;
Stcphaiioni d’abord, ct ensuite Licctus, avanl eux l’avoient donnée en
grand, dans sa forme ovale (5); AVinckelinaiiii l’a décrite dans sou
catalogue des pierres gravées du baron dc Stoseb f(i); ct M. lleync l’a
fait graver dc nouveau, apparemment d’après Licctus, cn tele dc son
second excursus sur le 2“ livre dc f Enéide dc A'ii'gilc (7) ; M. Duliois
l’a detssinée, pour cet ouvrage, d’après une empreinte (jui lui apparlicnl.
Cetlc jiierre représente l’cutrée du clicval dc bois dans la ville dc
Troie. W iiickclinanu eu a fait graver une à-pcu-jirès semblable pour
la disposition dn sujet (8) ; mais le moment que l’artislc a choisi n’est
Jias le même; c’cst celui où les guerriers Grecs descendent de la fatale
niacliinc. On y voit Cassandrc sur les murs dc Troie, lonjours possédée
de l’cspril divin, les clievcnx hérissés, élevant les mains vers le ciel,
comme pour le prendre à témoin de la vérité dc scs jn-édictions. Dans
celle que nous donnons, le clicval est aussi élevé qnc les remparis de la
ville; des Phrygiens, ijiic l’on rceoimoît à leurs tiares, le Iraîneiil dans
rinléricur dc! murailles, ct des Troycus assez conCaiis sont assis sur sa
base mi'ine. Les murs sont coujiés, ct plus loin Cassandre, la elievelure
à moitié dressée, les mains jiorlécs en avanl, dans un état (fiiispiratioii,
annonce à scs concitoyens, les malheurs qni vont les accabler; mais les
Troycns aveuglés sc imxjncnt dc scs paroles ct niéjirisciil ses jirédictions;
(c) Apolloil. Bibl. Lih. in ,c , 12, § 3,
(2) Ciinon. Narrat. 3.j, ap. Pbol. Bilil. col.
(3) CoMi... ll>kl. Voyez aussi sur le Palla.ll.im les
Conuueulaires de Méziriac .sur les Epiiresd'Ovide, T. I.
pag.bo, et suiv, cl le neuvième excursus de M, lleync,
sur le second livre dc l’Énéide dc Virgile.
(4) Buger, Bclluin Inijaniim, Tab, 58- Goilée,
Daclyliulbcque, 2' partie, V 5a3.
(5) Stepbanoni, Ccmma? aiitiqniuis sculpttr. Tab.
4a, Liceius, llicroglypliica, page 3 io.
(fi) Winckelmann, Catalogue dcs |.ierrcs gravdes
dll baron dc -Sloscli, N" 3 ia , page 392.
(7) lleyn-Excursusir.ad 1- 11. /laieiil.T. H,p. 383.
(8) Winckelmann. Moiium. ined. I'l. i4U'
sur un jilan jilus enfoncé on voit tm vase, ct au-dessus, un B u c n in e ,
ou tête de victime, qm décore un édifice au Iiam duijucl est un ove,
rendu dans tes autres gravures jiar une téle humaine vue dc jirolil. Les
murs dc la ville sont représentés jiar des assises régulières dc belles
JIICITCS carrées, surmontées de trois créneaux; ct, dans la partie inférieure
dc la pierre, se trouve uu graiiicüs dc très-bon goût. Ccltc pierre est
belle, les coslmnos y sont Ibrl distincts et rien ii’y est douteux (i).
11 est assez singulier que la fiiblc du cheval dc bois sc soit perpétuée
jusqu’.anx beaux tcmjis dc la Grèce, ct même jusiju’an siècle d’Auguste,
sans, pour ainsi dire, trouver dc contradicteurs. Homère l’avoit admise
dans scs jioèmes, il n’en a jias Gllii davanlagc pour l’accréditer ct
la perpétuer jusque dans les âges jiostérieurs. Ce jioclc remt que les
Troycns inlroduisirent cux-mémes cc jicrfidc cheval dans l’intérieur du
Pcrgama : « Les Troyens, cn grand nombre, dit-il, l’ont eux-mêmes
» traîné, avec do pénibles efforts, jusque daus leur citadelle; il do-
» minoit sur leurs têtes. Long-lcmps irrésolus, ils se partagent eu trois
» avis différents. Les uns, armés d'un glaive tcrrilile, veulent sonder scs
» jirofondcs entrailles, ou le tirer au haut d’un roc pour l’cn précipiter;
» mais d’.iutrcs le coiisacrcm aux Dieux pour apjiaiser leur courroux,
» sentiment qui doit prévaloir ça) ».
\irgilc a bien profité de ces paroles d’Homère, il les eomnicule, il les
étend, et rien ii’cxjiliqiie mieux notre jiicrrc que les beaux vers du
chantre d’Enée :
* s i
Divitîiinus muros, ct nKcnia pntlimiis urbis.
Accingiint omnes o p e ri, pcclibtisque roUii uin
Subjtciiml lapsus, et stiippea vincula collo
Iiiiemliiiit. Scandit fatalis machina mu ro s ,
Fcta armis. Pticri lircnm inmiptoeque piiclla;
Sacra canunt, funemqiie manu conlitigerc gaudent.
(i) Dans les gravures dc .Stcplianoni el dc Licctus,
qui étoient les plus exactes avant celle que nous
donnons, les courroies avec lesquelles les Phrygiens
tircnl le cheval ne se voient point, le.s Phrygiens y
ont la tête découverte, tandis qu’il.s sont coiffés dc la
tiare ou bonnet particulier affecté celte nation.
Ciissandrcy a les mains uiipou élevée.s, tandis que dans
l’original elle les étend eu .avant. Ces gravures onl rendu
la figure dc boeuf ou de victime qui esl sur l'édilicc
Tome I L
par la lettre V, ct l'ove qui la surmonte, p.ar uue lèle
d’homme. Eulin les murs de Troie y sont reiiré.sciilés
comme étaut composés d'un grand numbic de petites
assises de pierres toutes égales, ct au contraire il y
eu a très-peu, le soubassement même est extraordinairement
élevé. On y remarquera encore beaucoup
d'autres négligences, si l’on fait la comparaison de
notre gr.avure avec celles qui Tout précédée.
(2) Ilomer. Odyss. Lib. V lll, v. 5o4-
86