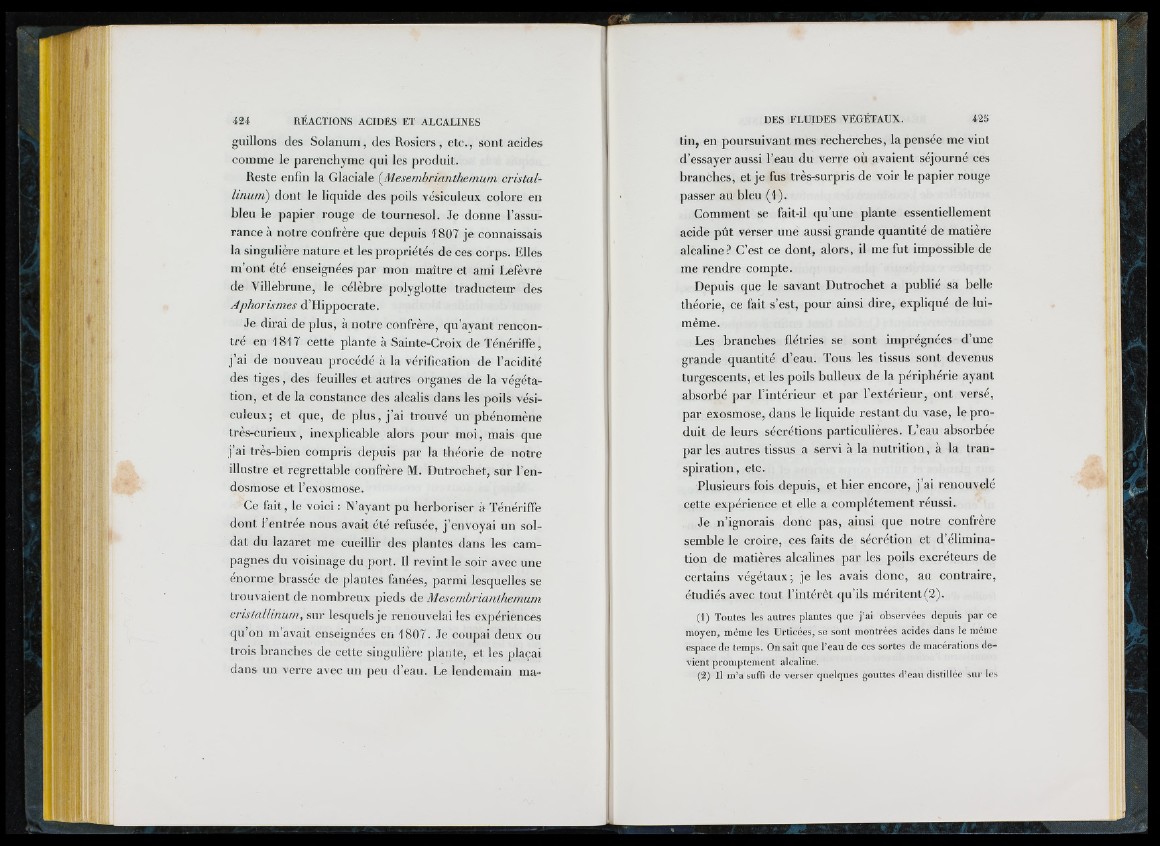
guillons (les Solanurn, des Rosiers, etc., sont acides
comme le parenchyme qui les produit.
Reste enfin la Glaciale (Mesernbrianlhenium cristal-
Iinum) dont le liquide des poils vésiculeux colore en
bleu le papier rouge de tournesol. .le donne l’assurance
à noire confrère que depuis 1807 je connaissais
la singulièi-e nature et les propriétés de ces corps. Elles
m’ont été enseignées par mon maître et ami Lefèvre
de Villebrune, le célèbre polyglotte traducteur des
Aphorismes d’Hippocrate.
Je dirai de plus, à notre confrère, qu’ayant rencontré
en 1817 cette plante à Sainte-Croix de Ténériffe,
j’ai de nouveau procédé à la vérification de l’acidité
des liges, des feuilles et autres organes de la végétation,
et de la constance des alcalis dans les poils vésiculeux;
et que, de plus, j ’ai trouvé un phénomène
très-curieux, inexplicable alors pour moi, mais que
j’ai très-bien compris depuis par la tbéorie de notre
illustre et regrettable confrère M. Dutrocbet, sur l’endosmose
et l’exosmose.
Ce fait, le voici : N’ayant pu herboriser à Ténériffe
dont l’entrée nous avait été refusée, j’envoyai un soldat
du lazaret me cueillir des plantes dans les campagnes
du voisinage du port. Il revint le soir avec une
énorme brassée de plantes fanées, parmi lesquelles se
trouvaient de nombreux jfieds de Mesembrianihemurn
cristallinum, sur lesquels je renouvelai les exjjériences
qu’ou m’avait enseignées en 1807. Je coupai deux ou
trois branches de cette singulière plante, et les plaçai
dans un verre avec un j)eu d’eau. Le lendemain matin,
en poursuivant mes recherches, la pensée me vint
d’essayer aussi l’eau du verre où avaient séjourné ces
branches, et je fus très-surpris de voir le papier rouge
passer au bleu ( 1 ).
Comment se fait-il qu’une plante essentiellement
acide pût verser une aussi grande quantité de matière
alcaline? C’est ce dont, alors, il me fut impossible de
me rendre compte.
Depuis que le savant Dutrocbet a publié sa belle
tbéorie, ce fait s’est, pour ainsi dire, expliqué de lui-
méme.
Les branches flétries se sont imprégnées d’une
grande quantité d’eau. Tous les tissus sont devenus
turgescents, et les poils bulleux de la périphérie ayant
absorbé par l’intérieur et j>ar l’extérieur, ont versé,
par exosmose, dans le liquide restant dn vase, le produit
de leurs sécrétions particulières. L’eau absorbée
par les autres tissus a servi à la nutrition, à la transpiration,
etc.
Plusieurs fois depuis, et hier encore, j’ai renouvelé
cette expérience et elle a complètement réussi.
Je n’ignorais donc pas, ainsi que notre confrère
semble le croire, ces faits de sécrétion et d’élimination
de matières alcalines par les poils excréteurs de
certains végétaux; je les avais donc, au contraire,
étudiés avec tout l’intérêt qu’ils méritent (2 ).
(1) Toutes les autres plantes que j’ai observées depuis par ce
moyen, moine les Ürticées, se sont montrées acides dans le même
espace de temps. On sait que l’eau de ces sortes de macérations de-
vient promptement alcaline.
(2) Il in’a suffi de verser quelques {^outtes d’eau distillée sur les