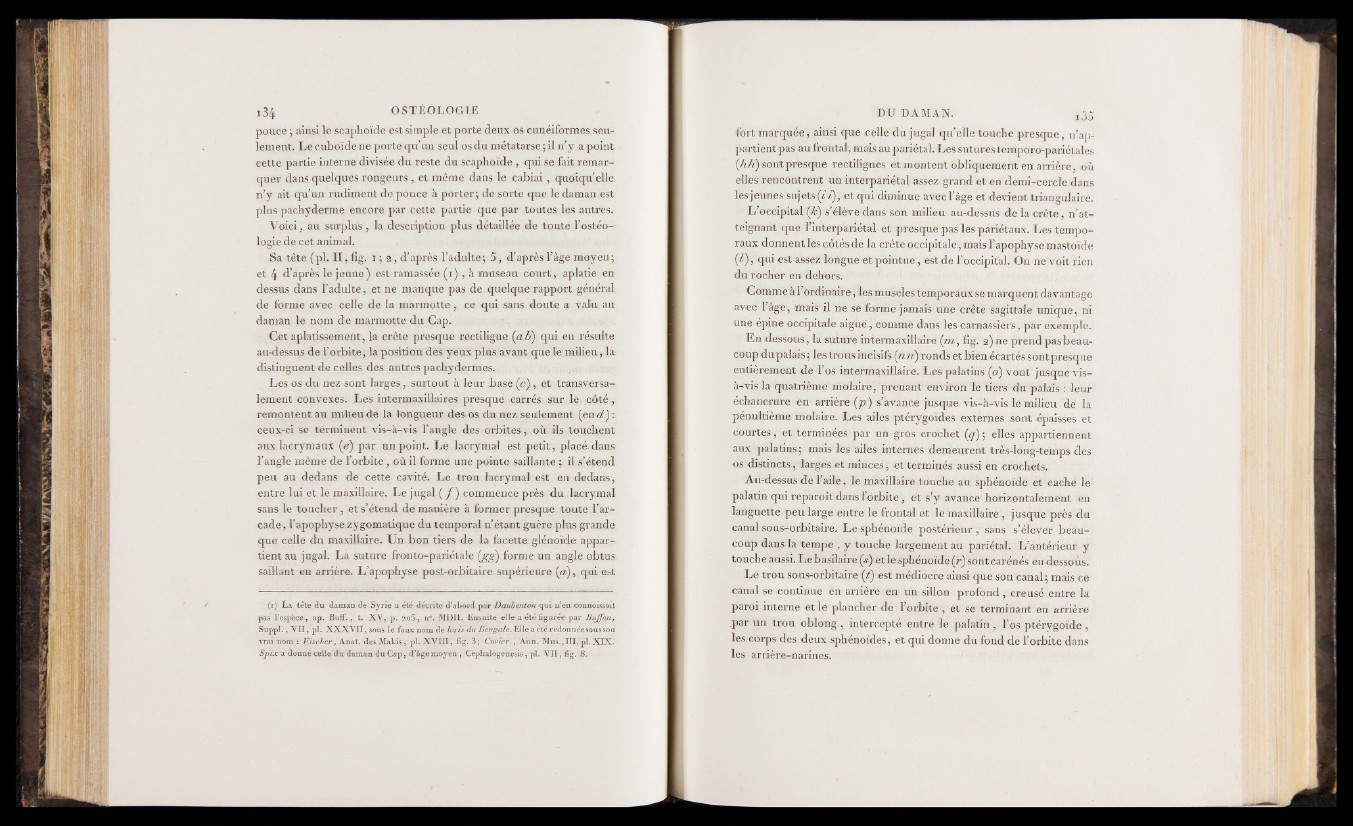
pouce ; ainsi le scaphoïde est simple et porte deux os cunéiformes seulement.
Le cuboïde ne porte qu’un seul os du métatarse ; il n’y a point
cette partie interne divisée du reste du scaphoïde , qui se fait remarquer
dans quelques rongeurs, et même dans le cabiai, quoiqu’elle,
n’y ait qu’un rudiment de pouce à porter; de sorte que le daman est
plus pachyderme encore par cette partie que par toutes les autres.
Voici, au surplus, la description plus détaillée de toute l’ostéo-
logie de cet animal.
Sa tête (pl. I I, fig. i ; 2, d’après l ’adulte; 5, d’après l’âge moyen;
et 4 d’après le jeune) est ramassée (1) , à museau court, aplatie en
dessus dans l’adulte, et ne manque pas de quelque rapport général
de forme avec celle de la marmotte , ce qui sans doute a valu an
daman le nom de marmotte du Cap.
Cet aplatissement, la crête presque rectiligne (aA) qui en résulte
au-dessus de l’orbite, la position des yeux plus avant que le milieu, la
distinguent de celles des autres pachydermes.
Les os du nez sont larges, surtout à leur base (c), et transversalement
convexes. Les intermaxillaires presque carrés sur le côté,
remontent au milieu de la longueur des os du nez seulement (en d') :
ceux-ci se terminent vis-à-vis l ’angle des orbites , où ils touchent
aux lacrymaux (e) par un point. Le lacrymal est petit,- placé-dans
l’angle même de l’orbite, où il forme une pointe saillante ÿ il s’étend
peu au dedans de cette cavité. Le trou lacrymal est en dedans,
entre lui et le maxillaire. Le jugal ( ƒ ) commence près du lacrymal
sans le toucher, et s’étend de manière à former presque toute l’arcade
, l’apophyse.zygomatique du temporal n’étant guère plus grande
que celle du maxillaire. Un bon tiers de la facette glénoide appartient
au jugal. La suture fronto-pariétale (gg) forme un angle obtus
saillant en arrière. L ’apophyse post-orbitaire supérieure (a\, qui est
(1) La tête du daman de Syrie a été décrite d'abord par Daubenton qui n’en connoissoit
pas l’espèce, ap. Buff., t, X Y , p. 2o5:, n°. MDU. Ensuite elle a été figurée par Bujffbn,
Suppl., Y I I , pl. XXXVII,sous le faux nom de loris du Bengale. Elle a été redonnée sous son
vrai nom : Fischer, Anat. des Makis , pl. XY I I I , fig. 3; Cuvier., Ann. Mus.,Ill, pl.XIX.'
Spix a donné celle du daman du Cap, d’âge moyen, Cephalogenesis, pl. V I I , fig. 8.
fort marquée, ainsi que celle du jugal qu’elle touche presque, n’appartient
pas âu frontal, mais au pariétal. Les suturestemporo-pariétales
(AA) sont presque rectilignes et montent obliquement en arrière, où
elles rencontrent un interpariétal assez grand et en demi-cercle dans
les jeunes sujets (i î), et qui diminue avec l’âge et devient triangulaire.
L ’occipital (A) s’élève dans son milieu au-dessus de la crête, n’atteignant
que l’interpariétal et presque pas les pariétaux. Les temporaux
donnent les côtés de la crête occipitale, mais l’apophyse mastoïde
(J) j qui est assez longue et pointue, est de l’occipital. On ne voit rien
du rocher en dehors.
Comme à l’ordinaire, les muscles temporaux se marquent davantage
avec 1 âge, mais il ne se forme jamais une crête sagittale unique, ni
une épine occipitale aiguë, comme dans les carnassiers, par exemple.
E n d e s s o u s , la su tu r e in te rm a x ilia ir e (pi, fig . a ) n e p r e n d p as b e a u c
o u p d u p ala is ; le s tr o u s in c is ifs (nn) Tond s e t b ie n é c a r té s so n t p r e s q u e
e n t iè r em e n t d e l ’ os in te rm a x i lla ir e . L e s p a la tin s (o ) v o n t ju s q u e v is -
à - v is la q u a t r ièm e m o la ir e , p r e n a n t e n v i ro n le tie r s d u p a la is : le u r
é c h a n c ru r e e n a r r iè re (p ) s’a v a n c e ju s q u e v is -à - v i s le m ilie u d e la
p é n u l t ièm e m o la ir e . L e s aile s p té r y g o ïd e s e x te rn e s s o n t épaisses e t
c o u r t e s , e t te rm in é e s p a r u n g ro s c r o c h e t (<y) ; e lle s a p p a r t ien n en t
a u x p a la t in s ; m ais le s a ile s in te rn e s d em e u r e n t tr è s - lo n g - tem p s d e s
o s d is t in c t s , la rg e s e t m in c e s , e t te rm in é s au s s i en c r o c h e ts .
Au-dessus de l’aile, le maxillaire touche au sphénoïde et cache le
palatin qui reparoit dans l’orbite, et s’y avance horizontalement en
languette peu large entre le frontal et le maxillaire, jusque près du
canal sous-orbitaire. Le sphénoïde postérieur , sans s’élever beaucoup
dans la tempe, y touche largement au pariétal. L ’antérieur y
touche aussi. Le basilaire (j) et le sphénoïde (z^ sontcarénés en dessous.
L e t r o u so u s -o rb ita ire ( t) e s t m é d io c r e ainsi q u e so n c a n a l ; m ais c e
c a n a l se c o n t in u e en a r r iè re en u n s illo n p r o f o n d , c r e u s é e n tr e la
p a r o i in te rn e e t le p la n c h e r d e l ’o r b i t e , e t se te rm in a n t en a r r iè r e
.p ar u n t r o u o b lo n g , in te r c e p té e n t r e le p a la t in , l ’os p t é r y g o ïd e ,
le s c o rp s d e s d e u x sp h én o ïd e s , e t q u i d o n n e d u fo n d d e l ’ o r b i t e d an s
le s a r r iè re -n a r in e s .