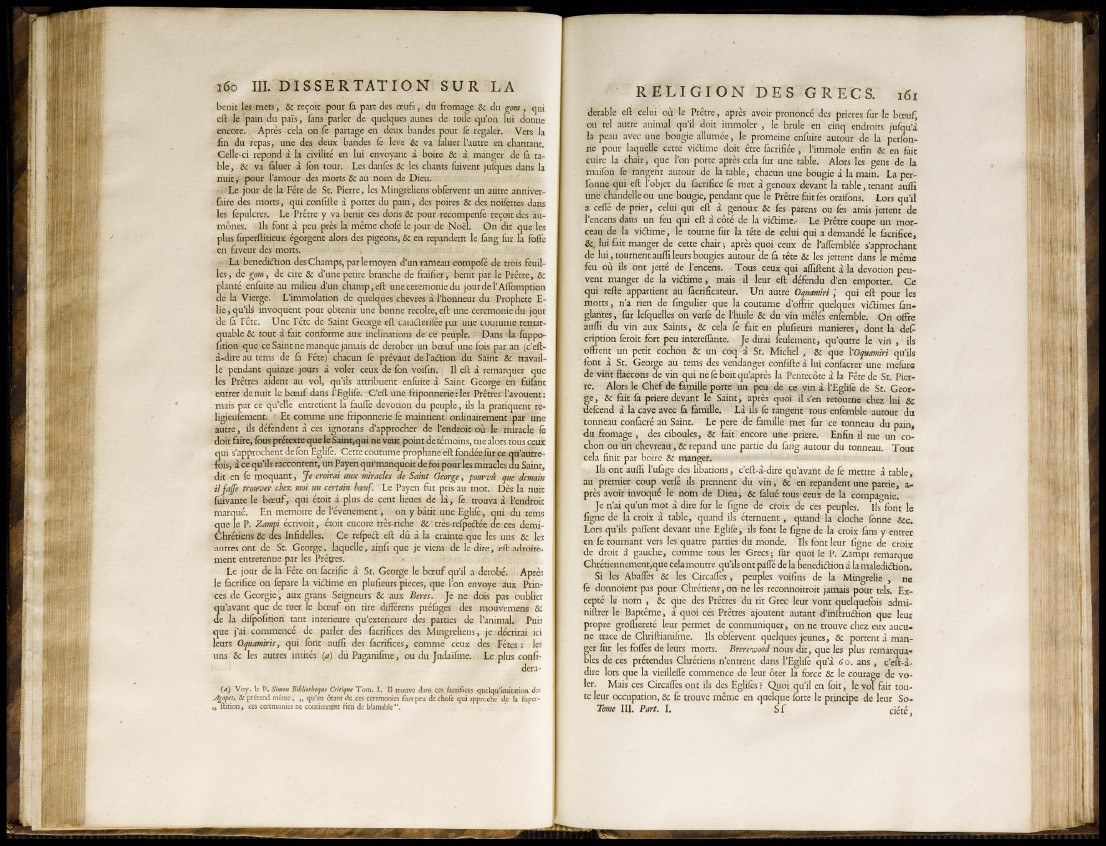
: îJ.IIj,
ï ;
l-lis
160 m. D I S S E R T A T I O N SUR LA
bénit les mets, & reçoit pour û part des oeufs, du fromage & du gom, tjui
clt le pain du pais, fans parler de quelques aunes de toile qu'on lui donne
encore. Après cela on Te partage en deux bandes pour iè rcgaler. Vers la
fin du repas, une des deux bandes fe levé & va laluer l'autre en chantant.
Celle-ci repond à la civilité en lui envoyant à boire & à manger de là table
, va làluer à fbn tour. Les danfes & les chants lùivent julques dans la
nuit, pour l'amour des morts & au nom de Dieu.
. Le jour de la Fête de St. Pierre, les Mingreliens obfervent un autre anniver-
Crire des morts, qui confiée à porter du p,iin, des poires & des noifettes dans
les lèpulcres. Le Prêtre y va bénir ces dons & pour recompenië reçoit des aumônes.
Ils font à peu près la même chofe le jour de Noel. On dit que les
plus fuperlliticux égorgent alors des pigeons, &: en rep.indent le fang fur la folle
en {àveur des morts.
La benediftion des Champs, par le moyen d'un rameau compofé de trois feuilles,
de gom, de cire Se d'une petite branche de fraifier, bénit par le Prêtre, &
plante enfuite au milieu d'un champ,efi; uneceremoniedu jourdel'Aflbmption
de la Vierge. L'immolation de quelques chevres à l'honneur du Prophète Ehe,
qu'ils invoquent pour obtenir une bonne récolté, ell; une ceremonie du jour
de fa Fête. Une Fête de Saint George eft carafterifée par une coutume remarquable
&L tout à fait conforme aux inclinations de ce peuple. Dans la fuppohtion
que ce Saint ne manque jamais de derober un boeuf une fois par an (c'eftà
dire au tems de fa Fête) chacun fë prévaut de l'adion du Saint & travaille
pendant quinze jours à voler ceux de fon voifin. Il eft à remarquer que
les Prêtres aident au vol, qu'ils attribuent enfuite à Saint George en failant
entrer de nuit le bceuf dans l'Eglile. C'cfl. une friponnerie : les Prêtres l'avouent;
mais par ce qu'elle entretient la fàulTc devotion du peuple, ils la pratiquent religieufement.
Et comme une firiponnerie lê maintient ordinairement par une
autre, ils défendent à ces ignorans d'approcher de l'endroit où le miracle fe
doit faire, Ibus prétexte que le Saint,qui ne veut point de témoins, tue alors tous ceux
C]ui s'approchent de fon Eglife. Cette coutume prophane ell fondée fur ce qu'autrefois,
à ce qu'ils raccontent, un Payen qufmanquoit de foi pour les miracles du Saint,
dit en fe itioquant, Je croirai aux miracles de Saint George, poar-vü que demain
il f a ß trouroer chez moi un certain hoeuf. Le Payen fut pris au mot. Dès la nuit
fuivante le boeuf, qui étoit à plus de cent lieues de là, fe trouva à l'endroit
marque. En memoire de l'évenement, on y bâtit une Eglife, qui du tems
que le P. Zamfi écrivoit, étoit encore très-riche & très-refpeâce de ces demi-
Chrétiens & des Infidelles. Ce rcfpeft eft dû à la crainte que les uns & les
autres ont de St. George, bquelle, ainfi que je viens de le dire, ell adroitement
entretenue par les Prêtres.
Le jour de la Fête on facrifie à St. George le boeuf qu'il a dérobé. Après
le facrifice on fepare la vidime en plufieurs pieces, que l'on envoye aux Princes
de Georgie, aux grans Seigneurs & aux Beres. Je ne dois pas oublier
qu'avant que de tuer le boeuf on tire difFérens prélâges des mouvemens &:
de la difpofîtiori tant Interieure qu'exterieure des parties de l'animal. Puisque
j'ai commence de parler des làcrifices des Mingreliens, je décrirai ici
leurs Oquamiris, qui font auffi des facrifices, comme ceux des Fêtes : les
uns & les autres imités {a) du Paganifme, ou du Judaïfme. Le plus confidera
(a) Voy. le P. Simon Bihtiarkf^iie Crlti^ite Tom. I. 1] trouve dans ces furifices c]iielqu'imitation des
^Ifpei, & prétend même, „ qu'en ôtant de ces ceremonies fort peu de chofe qui approche de la fuper-
„ ftition, ces ceremonies ne contiennent rien de blamable ".
R E L I G I O N DES GRECS. i6i
derable ell celui où le Prêtre, après avoir prononcé des prieres fur le boeuf,
ou tel .autre animal qu'il doit immoler , le brûle en cinq endroits jufqu'i
la peau avec une bougie allumée, le promeine enfuite autour de la perfonr
e pour Laquelle cette viftime doit être facrifice , l'immole enfin & en fait
cuire la chair, que l'on porte après cela fur une table. Alors les gens de la
maifon fe rangent autour de la table, chacun une bougie à la main. La perfonne
qui eft l'objet du facrifice fe met à genoux devant la table, tenant aulli
une chandelle ou une bougie, pendant que le Prêtre fctfes oraifons. Lors qu'il
a ceflé de prier, celui qui eft .à genoux & fes parens ou fes amis jettent de
l'encens dans un feu qui eft .à côté de la viâimc.- Le Prêtre coupe un morceau
de la viaime, le tourne fur la tête de celui qui a demandé le ficrifice,
&. lui fait manger de cette chair ; après quoi ceux de l'alTemblée s'approchant
de lui, tournent auffi leurs bougies autour de là tête & les jettent dans le même
feu où ils ont jette de l'encens. Tous ceux qui afliftent à la devotion peuvent
manger de la v i a i m e , mais il leur eft défendu d'en emporter. Ce
qui refte appartient au lâcrificateur. Un autre Oqmmiri ; qui eft pour les
morts, n'a rien de fingulier que la coutume d'offrir quelques viaimes (ângbintes,
fur lefquelles on verfe de l'huile & du vin mêlés enfemble. On offre
auffi du vin aux Saints, & cela le fait en plufieurs maniérés, dont la def
cription (èroit fort peu interellànte. Je dirai feulement, qu'outre le vin , ils
offrent un petit cochon & un coq à St. Michel , & que ï'Ojuamiri qu'ils
font à St. George au tems des vendanges confifte à lui confacter une mefure
de vint flaccons de vin qui ne le boit qu'après la Pentecôte à la Fête de St. Pierre.
Alors le Chef de femille porte un peu de ce vin à l'Eglife de St. Georte,
& fait fa priere devant le Saint, aptes quoi il s'en retourne chez lui &
cfcend à la cave avec fâ fimille. Là ils fe rangent tous enfemble autour du
tonneau conlàcré au Saint. Le pere de famille met lût ce tonneau du pain,
du fromage , des ciboules, & fait encore une priere. Enfin il tue un cochon
ou un chevreau, & répand une partie du làng autour du tonneau. Tout
cela finit p.ar boire & manger.
Ils ont auffi l'ulàge des hbations, c'eft-à-dire qu'avant de fe mettre à table,
au premier coup verfé ils prennent du vin, & en repandent une partie, après
avoir invoqué le nom de Dieu, & fâlué tous ceux de la compagnie.
Je n'ai qu'un mot à dire fur le figne de croix de ces peuples. Ils font le
figne de la croix à table, quand ils cternuent, quand la cloche fonne &c.
Lors qu'ils pallent devant une Eglife, ils font le figne de la croix fans y entrer
en fe tournant vers les quatre parties du monde. Ils font leur ligne de croix
de droit à gauche, comme tous les Grecs; fur quoi le P. Zampi remarque
Chrétienncment,que celamontre qu'ils ont palTé de la benediaion à la malediaion.
Si les Abaffes K les Circaffes, peuples voifins de la Mingrelie , ne
le donnoient pas pour Chrétiens, on ne les reconnoitroit jamais pour tels. Excepté
le nom , & gue des Prêtres du rit Grec leur vont quelquefois adminiftrer
le Baptême, à quoi ces Prêtres ajoutent autant d'inllruftion que leur
propre groffiereté leur permet de conmuniqiier, on ne trouve chez eux aucu.
ne tr,ice de Chrillianifme. Ils obfervent quelques jeunes, & portent à manger
llir les foffes de leurs morts. Brerewood nous dit, que les plus remarquables
de ces prétendus Chrétiens n'entrent dans l'Eglife qu'à tfo. ans , c'eft-àdire
lors que la vieilleffe commence de leur ôter la force & le courage de voler.
Mais ces Circ.affes ont ils des Eglifes ! Quoi qu'il en foit, le vol fait toute
leur occupation, & fe trouve même en quelque forte le principe de leur So-
Tome III. Part. I. Sf ciété.
Mi ï,
.=1,1
I'll
• • ii-il";