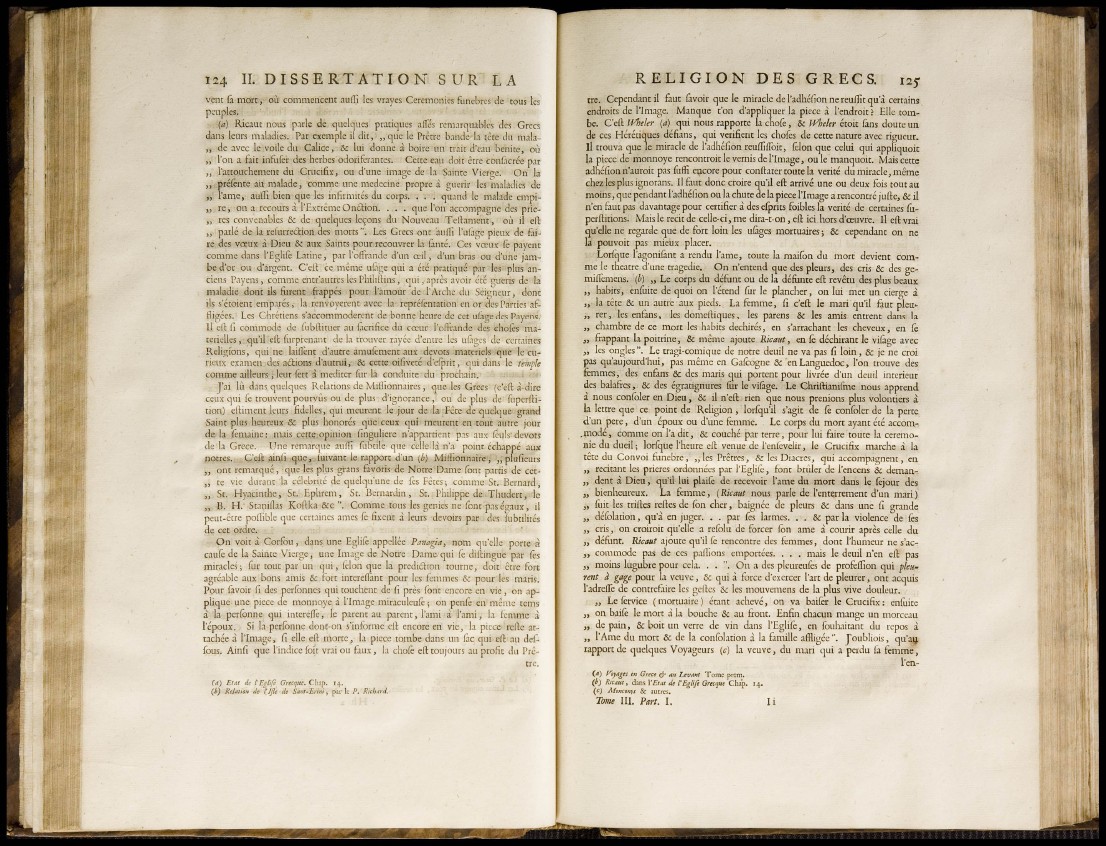
4
h
124 II. D I S S E R T A T I O N S UR' LA
vent (à m o r t , où commencent niifli les vraycs Ceremonies funèbres de tous les
peuples.
. (a) Ricaut nous parle de quelques pratiques afîes remarquables des Grecs
dans leurs maladies. Par exemple il d i t , „ q u e le Prêtre bande la tcte du mala-
„ de avec le voile du C a l i c e , & lui donne à boire un trait d'eau benite, où
5, l o n a fait infufer des herbes odoriférantes. Cette eau doit être c o n f i c r é e pat
„ l'attouchement du C r u c i f i x , ou d'une image de la Sainte Vierf^e. On la
„ pré{ënte au m a l a d e , comme une medecine propre d s;uerir les maladies de
„ l'ame, aulli bien que les infirmités du corps. . . . quand le malade empi-
,3 r e , on a recours à l'Extrême O n d i o n . . . . que l'on accompagne des prie-
„ res convenables Se de quelques leçons du N o u v e a u T e l l a m e n t , où il eft
„ parlé de la refurrection des m o r t s " . Les Grecs ont aulli l'ufàge pieux de faire
des v oe u x à D i e u & aux Saints pour recouvrer la (ànté. Ces voeux fe payent
c o m m e dans l'Eglifè L a t i n e , par l'offrande d'un c c i l , d'un bras ou d'une jambe
d'or ou d'argent. C ' e i l ce meme uCige q u i a été pratiqué par les plus anciens
Payens, c o m m e entr'autres les P h i l i l t i n s , q u i , après avoir été guéris de la
maladie dont ils hirenc frappés pour l'amour de l'Arche du Seii^ncur, dont
ils s'étoient emparés, la renvpyerent avec la repréfentation en or cles Parties affligées.
Les Chrétiens s'accommodercnt de bonne heure de cet ufàgedes Payens.
Il cit fi c o m m o d e de fubftituer au f i e r i f i c e du coeur l'offrande de's chofès materielles,
qu'il ell furprenant de la trouver rayée d'entre les ufàges de certaines
R e l i g i o n s , qui ne LiiQènt d'autre a m u f e m e n t a u x dévots matériels que le curieux
examen des aâiions d'autrui, 6c cette oifiveté d'efprit, qui dans le temple
c o m m e ailleurs, leur (êrt à méditer fiir la conduite du prochain. • c-i-
J'ai lu dans quelques Relations de M i f l i o n n a i r e s , que les Grecs {c'efl: à-dirc
ceux q u i fe trouvent pourvus ou de plus- d ' i g n o r a n c e , ou de plus de fuperftition)
eiliment leurs fiddles, qui meurent le jour de la Fete de quelque grand
Saint plus heureux & plus honorés que ceux qui meurent en tout autre jour
de la lèmaine: mais c e t t e . o p m i o n finguliere n'appartient pas aux (êuis'dévots
de la Grece. Une remarque aufll fubtile que celle-là n'a point échappé aux
nôtres. Ç'eil ainil q u e , luivanc le rapport d'un {b} M i t î i o n n a i r e , „ p l u f i e u rs
, , ont r e m a r q u é , que les plus grans favoris de N o t r e Dame (ont partis de cet-
, , te vie durant la célébrité de quelqu'une de fcs Fêtes^ c o m m e St. Bernard,
„ St. H y a c i n t h e , St. E p h r e m , St. Bernardin, St. Philippe de T h u d e r c , le
„ B. H.- Staniflas K o f t k a & c ". C o m m e tous les genies ne (ont pas é g a u x , il
peut-être poÜible que certaines ames fe fixent à leurs devoirs par des ïubcilités
de cet ordre.
O n voit à C o r f b u , dans une Eglilë appellee Panagia, nom qu'elle porte à
caufê de la Sainte V i e r g e , une Image de N o t r e Dame qui fe dillin^ue par (es
miracles5 fur tout par un q u i , lelon que la predidlion tourne, doit être fort
agréable aux bons amis & fort interefiant pour les femmes & pour les maris.
P o u r {avoir Ii des perfonnes qui touchent de fi près (ont encore en v i e , on applique
u n e piece de monnoye à l ' I m a g e miraculeufe ; on penle en même tems
à la perlbnne qui interelTè, le parent au parent, l'ami à l ' a m i , la temmc à
l ' é p o u x . . Si la perfbnne dont-on s'informe ell encore en vie, la piecc refte attachée
à l ' I m a g e , fi elle eft m o r t e , la piecc tombe dans un f i e qui ell au deffous.
Ainfi que l'indice foie vrai o u f x u x , la choie eft toujours au profit du Prêfrt)
Etat dt lEglife Grecque. C b p . 14.
{b) Reianw de l'IJle de Smt-Erini, par Ic P. Richard.
R E L I G I O N DES GRECS. 125
tre. Cependant il faut {avoir que le miracle de l'adhéfion n e reuffit q u ' à certains
endroits de l'Image. Manque t'on d'appliquer la piece à l'endroit > Elle tombe.
C e l l lyheter {a) qui nous rapporte la c l i o f e , & vyhekr étoit fans doute un
de ces Hérétiques défians, qui vérifient les chofes de cette nature avec rigueur.
Il trouva que l e miracle de l'adhéfion r e u l l i f l b i t , {êlon q u e celui qui appliquoic
la piecc de m o n n o y e rencontroit le vernis de l ' I m a g e , o u le m a n q u o i t . Mais cette
adhéfion n'auroit pas fuffi epcore pour c o n i b t e r toute la vérité du m i r a c l e , m ê me
chez les plus ignorans. Il 6 u t donc croire qu'il eft arrive une ou deux fois tout au
m o i n s , q u e pendant l'adhéfion o u la chute d e l à piece l ' I m a g e a rencontré j u f t e , & il
n'en faut p.is davantage pour certifier à des elprits foibles la vérité de certaines fuperftitions.
M.iisle récit de c e l l e - c i , m e d i r a - t o n , e f t ici h o r s d ' oe u v r e . Il eft vrai
qu'elle ne regarde q u e de fort loin les uiâges mortuaires ; & cependant on ne
la pouvoir pas mieux placer.
Lorfque l'agonifant a rendu l ' a m e , toute la m a i f o n du mort devient comme
le theatre d'une tragedie. On n'entend que des p l e u r s , des cris & des g e -
miffemens. (i) „ Le corps du défunt o u de la dcfiinte eft r e v ê t u des plus beaux
, , habits, enfuite de quoi on l'étend fur le p l a n c h e r , on lui met un cierge à
„ la tête & un autre aux pieds. La f e m m e , fi c'eft le mari qu'il feut pleu^
„ rer, les enfans, les d o m e f t i q u e s , les parens 8c les amis entrent dans la
„ chambre de ce mort les habits déchirés, en s'arrachant les c h e v e u x , en fe
„ frappant la p o i t r i n e , & même ajoute Kicmt, en le déchirant le vifâge avec
„ les ongles ". Le tragi-comique de notre deuil ne v a pas fi l o i n , & je ne croi
pas q u ' a u j o u r d ' h u i , pas même en G a f c o g n e & en L a n g u e d o c , l'on trouve des
f e m m e s , des enfans & des maris qui portent pour livrée d'un deuil intcrieut
des balafires, & des cgratignures (ùr le vilâge. Le Chriftiamfme nous apprend
à nous confoler en D i e u , & il n'eft rien que nous prenions plus volontiers à
la lettre q u e ce point de R e l i g i o n , loriqu'il s'agit de fè confoler de la perte
d ' u n p e r e , d'un époux o u d'une femme. Le corps du mort ayant été accom-
. m o d é , comme on l'a d i t , & couché par terre, pour lui &ire toute la ceremonie
d u dueil ; lorfque l'heure eft venue de l ' e n i e v e l i r , le C r u c i f i x marche à la
tête du C o n v o i f u n e b r e , „ l e s Prêtres, & les D i a c r e s , qui a c c o m p a g n e n t , en
„ recitant les prières ordonnées par l ' E g i i f e , font brûler de l'encens & deman-
„ dent à D i e u , qu'il lui plaife de recevoir l'ame du mort dans le fejour des
, , bienheureux. La f e m m e , [Rtcaut nous parle de l'enterrement d'un m a r i)
, , fuit les trilles reftes de fôn c h e r , baignée de pleurs & dans une fi grande
„ défolation, qu'à en juger. . . par fes larmes. . . & par la violence de Ces
„ cris, on croiroit qu'elle a refolu de forcer fon ame à courir après celle du
, , défunt. Rscau/ ajoute qu'il fè rencontre des f e m m e s , dont l'humeur ne s'ac-
„ commode pas de ces pallions emportées. . . . mais le deuil n'en eft pas
3, moins lugubre pour cela. . . ". O n a des pleureufès de profeffion qui p/eurent
à gage pour la v e u v e , & qui à force d'exercer l'art de p l e u r e r , ont acquis
l'adrefie de c o n t r e h i r e les geftcs &c les mouvemens de la plus v i v e douleur.
, , Le fèrvice ( mortuaire ) étant achevé, on va b.ai[èr le C r u c i f i x : enfûite
„ on baife le mort à la bouche & au front. Enfin chacun mange un morceau
„ de p a i n , & boit u n verre de vin dans l ' E g i i f e , en fouluirant du repos à
„ l'Ame du mort & de la conlblation à la famille affligée ". J'oubliois, qu'ai^
rapport de quelques V o y a g e u r s [c) la v e u v e , du mari qui a perdu fa f e m m e ,
l'en-
(.1) ^oj/a^es en Gt-ece & A» Levant T o m e prem.
{h) Riuur^ dans VEtat dt l'Egiife Grecqut C h a p . 14.
( O Monconys & autres.
Tome III, Part. I. li