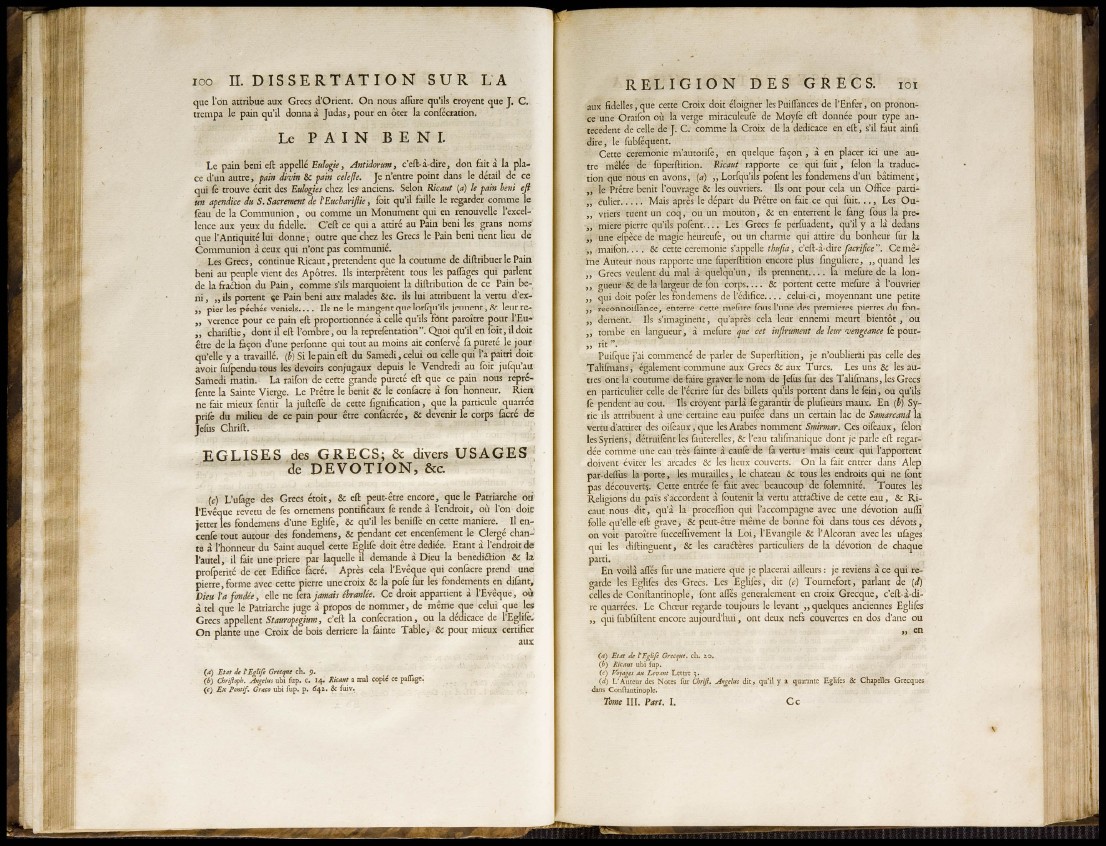
M'
i u |i
1l„
iîil;;.
î •
'Mt
' î f p i i
100 II. D I S S E R T A T I O N SUR LA
que l'on attribue aux Grecs d'Orient. On nous aflùre qu'ils croyent que J. C.
trempa le pain qu'il donna à Judas, pour en ôter la confécration.
Le P A I N B E N I.
t e pain beni eft appelle Eulogie, Amidorum, c'eft-à-dire, don fait à la place
d'un autre, fain dhin & pain cekfle. Je n'entre point dans le détail de ce
qui fe trouve écrit des Eulogies chez leî anciens. Selon Ricaut {a) le fain leni efi
m afendice du S. Sacrement de tEuchariJiie, foit qu'il faille le regarder comme le
feau de la Communion, ou comme un Monument qui en renouvelle l'excellence
aux yeux du fidelle. C'eft ce qui a attiré au Pain beni les grans noms
que l'Antiquité lui donne ; outre que chez les Grecs le Pain beni tient lieu de
Communion à ceux qui n'ont pas communie.
Les Grecs, continue Ricaut, prétendent que la coutume de diftribuer le Pain
beni au peuple vient des Apôtres. Ils interprêtent tous les pafTages qui parlent
de la fraction du Pain, comme s'ils marquoient la diftribution de ce Pain beni
, „ ils portent «e Pain beni aux malades &c. ils lui attribuent la vertu d'ex-
„ pier les péchés veniels Ils ne le mandent que lorfqu'ils jeûnent, & leur re-
„ verence pour ce pain eft proportionnée à celle qu'ils font paroître pour l'Eu-
„ chariftie, dont il eft l'ombre, ou la reprefentation". Quoi cju'il en foit, il doit
être de la &çon d'une perfonne qui tout au moins ait confervé fa pureté le jour
qu'elle y a travaillé, (h) Si le pain eft du Samedi, celui ou celle qui l'a paitri doit
avoir fu(pendu tous les devoirs conjugaux depuis le 'Vendredi au foir jufqu'aii
Samedi matin. La raifon de cette grande pureté eft que ce pain nous reprcfente
la Sainte Vierge. Le Prêtre le bénit & le confacre à fon honneur. Rien
ne fait mieux fentir la juftelTe de cette fignification, que la particule quarréc
prife du miheu de ce pain pour être con&crée, Se devenir le corps {âcré de
Jefus Chrift.
EGLISES des GRECS; & divers USAGES
de DEVOTION, &c.
{c) L'ufâge des Grecs étoit, & eft peut-être encore, que le Pamarche ou
l'Eveque revetu de fes ornemens pontificaux fe rende à l'endroit, où l'on doic
jetter les fondemens d'une Eglife, & qu'il les beniffe en cette manière. ^ Il encenfe
tout autour des fondemens, & pendant cet encenfement le Clergé chanta
à l'honneur du Saint auquel cette Eglife doit être dediée. Etant à l'endroit de
l'autel, il fait une priere par laquelle il demande à Dieu la benediaion Se la
profperité de cet Edifice facré. Après cela l'Evêque qui confacre prend une
pierre, forme avec cette pierre une croix & la pofe fur les fondements en difant.
Dieu l'a fondée, elle ne fera jamais éhanlée. Ce droit appanient à l'Evêque, où
à tel que le Patriarche juge à propos de nommer, de même que celui que les
Grecs appellent Stauropegim, c'eft la confecration, ou la dédicace de l'Eglife.
On plante une Croix de bois derriere la ûintc Table, Se pour mieux certifier
(4) Et/it de l'Eglife Grecfte ch. s>.
(i) chrijl,fh. ^ f e U , ubi fup. c. 14. X i M « a mal copie ce paiTagï.
(0 ^^ Pontif. Grttco ubi fup. p. (Î4Z. & fuiv.
R E L I G I O N DES GRECS. loi
aux fidclles,que cette Croix doit éloigner lesPuiCTances de l'Enfer, on prononce
une Oraifon où la verge miraculeufe de Moyfe eft donnée pour type antecedent
de celle de J. C. comme la Croix de la dédicacé en eft, s'il faut ainfi
dire, le fubféquent.
Cette ceremonie m'autorilê, en quelque &çon , à en placer ici une autre
mêlée de fuperftition. Ricaut rapporte ce qui f u i t , fclon la traduction
que nous en avons, (a) „ Lorfqu'ils pofent les fondemens d'un b.îtiment,
„ le Prêtre bénit l'ouvrage & les ouvriers. Ils ont pour cela un Office parti-
„ eulier Mais après le départ du Prêtre on fait.ce qui fuit. . . , Les Ou-
„ vriers tuent un coq, ou un mouton, & en enterrent le fang fous la pre-
„ miere pierre qu'ils pofent Les Grecs fe perfuadent, qu'il y a là dedans
„ une efpèce de magie heureufe, ou un charme qui attire du bonheur fur la
„ maifôn.... 8c cette ceremonie s'appelle thujia, c'eft-à-dire facrifice". Cemêrne
Auteur nous rapporte une fuperftitiori encore plus fmguliere, „quand les
,, Grecs veulent du mal à quelqu'un, ils prennent la mefure de la lon-
„ gueur & de la largeur de fou corps & portent cette mefure à l'ouvrier
„ qui doit pofer les fondemens de l'édifice celui-ci, moyennant une petite
„ reconnoiàànce, enterre cette mefure fous l'une des premieres pierres du fon-
„ dement. Ils s'imaginent, qu'après cela leur ennemi meurt bientôt, ou
„ tombe en langueur, à mefure fw cet inflrument de leur 'vengeance fe pourj.
rit "•
Puifque j'ai commencé de parler de Superftition, je n'oublierai pas celle des
Talifmans, également commune aux Grecs & aux 'Turcs. Les uns & les autres
ont la coutume de faire graver le nom de Jefus fur des Talifmans, les Grecs
en particulier celle de l'écrire fur des billets qu'ils portent dans le fèin, ou qu'ils
le pendent au cou. Ils croyent parla fe garantir de plufieurs maux. En (h) Syrie
ils attribuent à une certaine eau puifée dans un certain lac de Samarcand la
vertu d'attirer des oi(èaux,que les Arabes nomment Smirmar. Ces oifeaux, félon
lesSyriens, détruifent les fciuterelles, & l'eau talifinanique dont je parle eft regardée
comme une eau très fainte à caufe de fa vertu : mais ceux qui l'apportent
doivent éviter les arcades &: les lieux couverts. On la fait entrer dans Alep
par-defTus la porte, les murailles, le chateau & tous les endroits qui ne font
pas découvert?. Cette entrée fe fait avec beaucoup de fblemnité. Toutes les
Religions du pais s'accordent à foutenir la vertu .ittraftive de cette eau, & Ricaut
nous dit, qu'à la proceflîon qui l'accompagne avec une dévotion aufïi
folle qu'elle efi grave, & peut-être même de bonne foi dans tous ces dévots,
on voit paroître (licceflivement la Loi, l'Evangile & l'Alcoran avec les ufâges
qui les diftinguent. Se les caraiftères particuliers de la dévotion de chaque
parti.
En voilà affés fur une matiere que je placerai ailleurs : je reviens à ce qui regarde
les Eglifes des Grecs. Les Eglifes, dit {c) Tournefort, parlant de (d)
celles de Conftantinople, font afTés generalement en croix Grecque, c'eft-à-dire
qu.arrées. Le Choeur regarde toujours le levant ,, quelques anciennes Eglifes
„ qui fubfiftent encore aujourd'hui, ont deux ne& couvertes en dos d'ane ou
„ en
(il) El/tt de l'Eglife Grecque, ch. ïO.
0) Ricaut ubi fup.
(c) Voyages m Levant Lettre 5.
(.d) L'Auteur des Notes fur Chrifl, Angehs dit, qu'il y a quarante Eglifes ,
dans Conftantinople.
tome III. ¥art. I. Ce
chapelles Grecques
-f
1
• ï:.
• if •
"VI :iii
mà mk