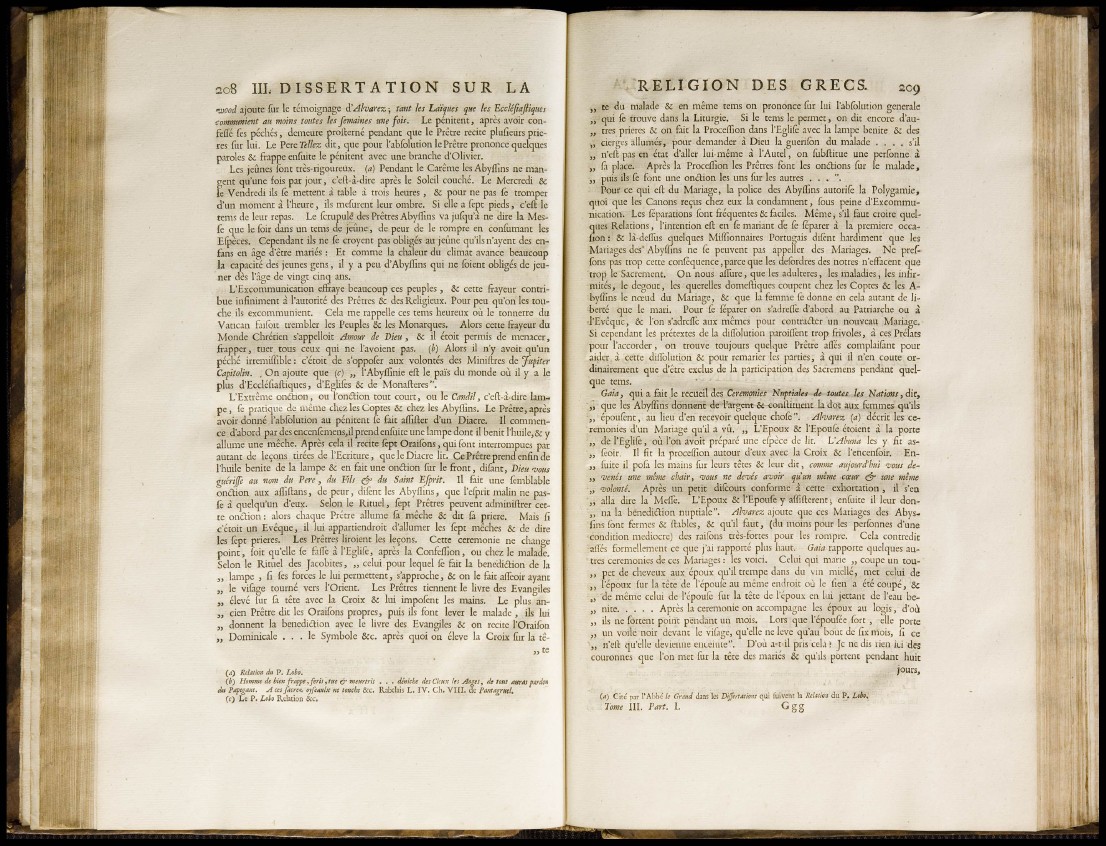
J
f f '
208 IIL D I S S E R T A T I O N SUR LA
rüood ajoute für le t é m o i g n a g e ^Ahanx-, tant les Laitues que les EccUßaßiques
communient an mows tantes les femaines une fais. Le p é n i t e n t , après avoir confeffé
fes p é c h é s , demeure p r o i b r n c pendant que le Prêtre recite plufieurs prieres
fur lui. Le Pere Tellex dit, que pour l'ablôlution le Prêtre prononce quelques
paroles & frappe enfuite le penitent avec une branche d'Olivier.
Les jeûnes font très-rigoureu.x. {a) Pendant le C a r ê m e les A b y f f i n s ne mangent
qu'une fois par j o u r , c'eft-à-dirc après le Soleil couché. Le Mercredi &
le Vendredi ils (è mettent à table à trois heures , & pour ne pas fe tromper
d ' u n moment à l ' h e u r e , ils mefurent leur ombre. Si elle a fept p i e d s , c'eft le
tems de leur repas. Le icrupuld des Prêtres A b y f l i n s va jufqu'à ne dire la Mes-
(è que le foir dans un tems de j e û n e , de peur de le rompre en confumant les
Efpèces. Cependant ils ne le croyent pas obligés au jeûne qu'ils n'ayent des enÉins
en âge d'être mariés : Et comme la chaleur du climat avance beaucoup
la capacité des jeunes g e n s , il y a p e u d ' A b y f f i n s qui ne foient obligés de jeûner
des l'âge de v i n g t cinq ans.
L ' E x c o m m u n i c a t i o n effraye beaucoup ces p e u p l e s , & cette frayeur contrib
u e infiniment à l'autorité des Prêtres èc des R e l i g i e u x . Pour peu q u ' o n les touche
ils e x c o m m u n i e n t . Cela me rappelle ces tems heureux où le tonnerre du
V a t i c a n fâifoit trembler les Peuples & les Monarques. Alors cette frayeur du
M o n d e Chrétien s'appelloit Amour de Dieu , & il éroit permis de menacer,
ftapper, tuer tous ceux qui ne l'avoient pas. (J) A l o r s il n'y avoit q u ' un
péché irrcmiffîble : c'étoit de s'oppofèr aux volontés des Minifires de Jupiter
Cafitolin. , O n ajoute que (c) „ TAbyfTinie eft le pais du m o n d e où il y a le
plus d ' E c c l é f i a f t i q u e s , d'EgHfes & de Monafteres ".
L ' E x t r ê m e o n â i o n , ou l ' o n ä i o n tout c o u r t , ou le Cimdil, c'eft-à-dire l a m -
p e , fc pratique de m ê m e chez les C o p t e s & chez les A b y f f i n s . Le Prêtre, après
a v o i r donné r.ibfolution au pénitent fe fait affifter d'un Diacre. Il commenc
e d'abord par des enccnfèmens,il prend enfuite une lampe d o n t il b c n i t l'huile, & y
allume une mèche. Après cela il récité fept O r a i f o n s , q u i f o nt interrompues par
autant de leçons tirées de l ' E c r i t u r e , que l e Diacre lit. C e Prêtre prend e n f in de
l'huile benite de la lampe & en fait une o n f l i o n fur le fiont, difànt, Dieu -vous
guérijfe au nom du Pere, du Fils ^ du Saint Efprit. Il fait une femblable
o n ( ä i o n aux alTiftans, de p e u r , difent les A b y f E n s , que l'elprit m.ihn ne pasfe
à q u e l q u ' u n d'eux. Selon le R i t u e l , fept Prêtres peuvent adminiftrer cett
e o n û i o n : alors chaque Prêtre allume fà meclie & dit fà priere. Mais fi
c ' é t o i t u n E v ê q u e , il lui appartiendroit d'allumer les fept mèches &c de dire
les fcpr prieres. Les Prêtres liroient les leçons. Cette ceremonie ne change
p o i n t , foit qu'elle fe f i f f e à l ' E g l i f e , après la C o n f e f ï î o n , ou chez le malade.
S e l o n le Rituel des Jacobites, „ celui pour lequel fe fait la b e n e d i a i o n de la
„ lampe , fi fes forces le lui p e r m e t t e n t , s'approche, & on le fait affeoir ayant
„ le vifàge tourné vers l'Orient. Les Prêtres tiennent le livre des Evangiles
„ élevé fur fà tête avec la C r o i x & lui impotent les mains. Le plus an-
5, cien Prêtre dit les Oraifons propres, puis ils font lever le malade , ils lui
„ donnent la b e n e d i a i o n avec le livre des Evangiles & on recite l'Oraifon
„ Dominicale . . . le Symbole & c . après quoi o n élève la Croix fur la tê-
ReUlioM du p. Loho.
(è) Homme de hien fra^e,fsris,lue à" memril . . . denkbc desCIctix Ut Anm, de tml aitritf purdei
(ht Fapegaui. A cet fierez, eyfemlx ne touche &c. Rabelais L . I V . C h . V I I I . de Pantugrutl.
CO I-e Relation
R E L I G I O N DES GRECS. £09
„ te du malade & en même tems o n prononce fur lui l'ablôlution générale
„ qui le trouve dans la Liturgie. Si le tems le p e r m e t , on dit encore d'au-
„ très prières &: o n fait la ProcefTion dans l'Eglife avec la lampe benite & des
„ ciergcs allumés, pour demander à D i e u la guerifbn du malade . . . . s'il
„ n'efl pas en état d'aller lui m ê m e à l ' A u t e l , on fubftitue une perfbnne à
„ fà place. Après la ProcefTion les Prêtres font les o n a i o n s fur le m a l a d e.
„ puis ils fè f o n t une o n a i o n les uns fur les autres
Pour ce qui eft du Mariage, la police des A b y f f i n s autorifê la P o l y g a m i e,
quoi que les Canons reçus chez eux la c o n d a m n e n t , fous peine d ' E x c o m m u -
nication. Les féparations font fréquentes & faciles. M e m e , s'il faut croire quelques
R e l a t i o n s , l'intention efl: en fê mariant de fè féparer à la premiere occaf
i on : Se là-deffus quelques Miffionnaires Portugais difent hardiment que les
Mariages des' A b y f f i n s ne fe peuvent pas appeîler des Mariages. Ne pref^
fons pas trop cette confèquence, parce q u e les defordres des nôtres n'effacent que
t r o p le Sacrement. On nous affure, que les adultérés, les maladies, les infirm
i t é s , le d e g o u t , les querelles domeftiques coupent chez les Coptes Se les A -
byfîins le noeud du Mariage, Se que la f e m m e fe d o n n e en cela autant de liberté
que le mari. Pour fè féparer o n s'adreffe d'abord au Patriarche o u à
l ' E v e q u e , Se l'on s'adreffe aux mêmes pour c o n t r a a e r un nouveau Mariage.
Si cependant les prétextes de la diffolution paroiffent trop frivoles, à ces Prélats
pour l'accorder, on trouve toujours que que Prêtre affés complaifànt pour
aider, à cette diffolution & pour remarier les parties, à qui il n'en coûte ordinairement
que d'être exclus de la participation des Sacremens pendant quelq
u e tems.
Gaia^ q u i a fàit le recueil des Ceremonies Niftiales de toutes les Natims
„ que les A b y f f i n s donnent de l'argent & c o n f l i t u e n t la d o t aux femmes qu'ils
3, époufènt, au lieu d'en recevoir quelque c h o f è " . Aharez (a) décrit les ceremonies
d'un Mariage qu'il a vu. „ L'Epoux Se l'Epoufe étoient à la porte
„ de l ' E g l i f e , où l'on avoit prép.aré une elpèce de lit. VAhma les y iir as-
„ fèoir. Il fit la proceffion autour d'eux avec la C r o i x & l'enccnfôir. En-
„ fiiite il poià les mains fur leurs têtes Se leur d i t , comme aujortrdhui l'ous de-
„ menés une mime chair, mous ne deués avoir qu'un même coeur éf une mime
„ wolonté. Après un petit difcours conforme à cette exhortation , il s'en
„ alla dire la Meffe. L'Epoux & l'Epoufe y affifterent -, enfuite il leur don-
, , na la b e n e d i a i o n nuptiale". Aharez ajoute que ces Mariages des A b y s -
fins font fermes Se fiables, Se qu'il f a u t , (du moins pour les perfonnes d'une
c o n d i t i o n mediocrc) des raifons très-fortes pour les rompre. Cela contredit
affés formellement ce que j'ai rapporté plus haut. Gaia rapporte quelques autres
ceremonies de ces Mariages : les voici. Celui qui marie „ coupe un tou-
, , pet de cheveux aux époux qu'il trempe dans du vin miellé, met celui de
, , l'époux fur la tête de l'époufe au même endroit où le fien a été c o u p é . Se
„ de m ê m e celui de l'époule fur la tête de l'époux en lui jettant de l'eau be-
„ nitc Après la ceremonie o n accompagne les époux au l o g i s , d'où
„ ils ne fbrtent point pendant un mois. Lors que l'époufée fort , elle porte
„ un voile noir devant le viCige, qu'elle ne leve qu'au bout de fix mois, fi ce
„ n'eft qu'elle devienne enceinte". D'où a-t-il pris cela î Je ne dis rien ici des
couronnes que l'on met fur la tête des mariés & qu'ils portent pendant huit
jours,
(t>) Cire par l'Abbé le Grmâ dans les Vijftrtatmt qui fnivent la ReUim du P. Uhc,
Tome III. Part. I. Ggg
m