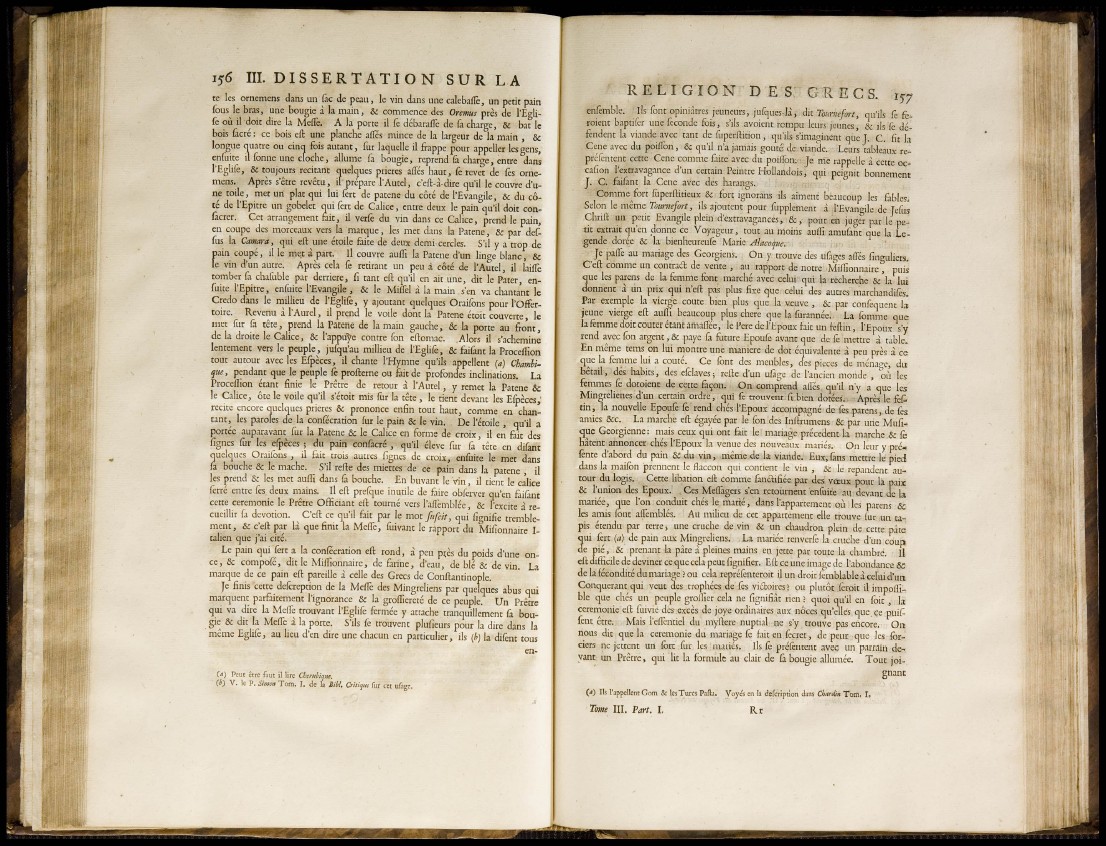
iiri '
156 III. D I S S E R T A T I O N SUR LA
tc les ornemens dans un fie de peau, le vin dans une calebaffe, un petit pain
fous le bras, une bougie à la main, & commence des Oremus près de l'Eglife
où il doit dire la MelTe. A la porte il fe dcbaralTe de fa charge, & bat le
bois ûcrc : ce bois eft une planche affcs mince de la largeur de la main , &
longue ciuatre ou cinq fois autant, fur laquelle il frappe pour appeller les gens,
enfuite il fonne une cloche, allume fa bougie, reprend fa charge, entre dans
l'Eglife, & toujours recitant quelcjues prières afles haut, fe revet de fes ornemens.
Après s'être revêtu, il prepare l'Autel, c'eft-à-dire qu'il le couvre d'une
toile, met un plat qui lui fert de patene du côté de l'Evangile, & du côté
de l'Epitre un gobelet qui fert de Calice, entre deux le pain qu'il doit confacrer.
Cet arrangement lait, il verfe du vin dans ce Calice, prend le pain,
en coupe des morceaux vers la marque, les met dans la Patene, & p.ir det
fus la Camara, qui efl: une étoile fiite de deux demi-cercles. S'il y a trop de
pain coupé, il le met à part. Il couvre auffi la Patene d'un linge blanc, &
le vin d'un autre. Après cela fe retirant un peu à côté de l'Autel, il laiffe
tomber fo chafuble par derriere, fi tant efl: qu'il en ait une, dit le Rater, enfuite
l'Epitre, enliiite l'Evangile, & le Miflèl à la main s'en va chantant le
Credo dans le millieu de l'Eglife, y ajoutant quelques Oraifons pour l'Offertoire.
Revenu à l'Aurel, il prend le voile dont la Patene étoit couverte, le
met fur fa tête, prend la Patene de la main gauche, & la porte au front,
de la droite le Calice, & l'appuie contre fon eftomac. Alors il s'achemine
lentement vers le peuple, jufqu'au millieu de l'Eglife, & Énûnt la Proceffion
tout autour avec les Efpèces, il chante l'Hymne qu'ils appellent {a) Chamhip
e , pendant que le peuple fe profterne ou Élit de profondes inclinations. La
Proceflion étant finie le Prêtre de retour à l'Autel, y remet la Patene &
le Calice, ôte le voile qu'il s'étoit mis fur la tête , le tient devant les Efpèces,'
recite encore quelques prieres & prononce enfin tout haut, comme en chantant,
les paroles de la confécration fur le pain & le vin. De l'étoile , qu'il a
portée auparavant fur la Patene & le Calice en forme de croix, il eiî fait des
fignes fur les efpèces ; du pain confacrc , qu'il éleve fur fa tête en diûn:
quelques Oraifons , il fait trois autres fignes de crou, enfuite le met dans
(a bouche & le mâche. S'il refle des miettes de ce pain dans la patene , il
les prend & les met auffi dans (â bouche. En buvant le vin, il tient le calice
ferré entre fes deux mains. Il eft prefque inutile de &ire obferver qu'en faifant
cette ceremonie le Prêtre Officiant eft tourné vers r.airemblée, & l'excite à recuciUir
fa devotion. C'eft ce qu'il fait par le mot fufcit, qui fignifie tremblement,
& c'eft par là que finit la MelTe, fuiv.ant le rapport du Mifionnaire Italien
que j'ai cite.
Le p.iin qui fert a la confécration eft rond, à peu puès du poids d'une once,
& compofé, dit le Miffionnaire, de farine, d'eau, de blé & de vin. La
marque de ce pain eft pareille à celle des Grecs de Conftantinople.
Je finis cette defcreption de la Melfe des Mingreliens par quelques abus qui
marquent parfaitement l'ignorance & la groffiereté de ce peuple. Un Prêtre
qui va dire la Meffe trouvant l'Eglife fermée y att.iche tranquillement fa bougie
& dit la Meffe à la porte. S'ils fe trouvent plufieurs pour la dire dans la
même Eglife, au lieu d'en dite une chacun en particulier, ils [h) la difent tous
U) Peut être faut il lire Chcmiiijw
( h V. k I>. fis»» Tom. I. de k , Critique fur « t ufage.
R E L I G I O N D E S GRECS. 157
enfemble. Ils font opiniâtres jeuneurs, jufques-là, dit Tamefort, qu'ils fe fc.
roient baptifer une fécondé (bis, s'ils avoicnt rompu leurs jeunes, & ils fe défendent
la viande avec tant de fuperftition, qu'ils s'imaginent que T. C. fit la
Cene avec du poiflbn, & qu'il n'a jamais goûté de viande. Leurs tableaux repréfentent
cette Cene comme faite avec du poiflbnr. Je me rappelle à cette occafion
l'extravagance d'un certain Peintre Hollandois, qui peignit bonnement
J. C. faifant la Cene avec des harangs.
Comme fort fuperftitieux & fort ignorans ils .aiment beaucoup les fibles.
Selon le même Toumefort, ils .ajoutent pour fupplement .à l'Evangile de Jefus
Chrift un petit Evangile plein d'cxtr.avag.ances, &, pour en juger par le petit
extrait qu'en donne ce Voyageur, tout au moins auffi amufant que la Légende
dorée & la bienheureufe Marie Ahcoque,
Je paife au imriage des Géorgiens. On y trouve des ufiges alfés finguliers.
C'eft comme un contraft de vente , au rapport de notre Miffionnaire , puis
que les p.irens de la femme font marché avec celui qui la recherche &: la lui
donnent à un prix qui n'eft p.is plus fixe que celui des autres marchan'difes.
Par exemple la vierge coûte bien plus que la veuve , & p.ar confequent b
jeune vierge eft auftl beaucoup plus chere que la furannée. La foraine que
la femme doit coûter étant amaflee, le Pere de l'Epoux fait un firftin, l'Epoux s'y
rend avec fon argent, & paye (à future Epoufe avant que de fe mettre à table.
En même tems on lui montre une maniéré de dot étjuiv.ilente à peu près .à cc
que la femme lui a coûté. Cc font des meubles, des pieces de ménao-e, du
bétail, dés habits, des efclaves; refte d'un ufige de l'ancien monde , où les
femmes fe dotoient de cette façon. On comprend affés. qu'il n'y a que les
Mingrelienes d'un certain ordre, qui Cc trouvait fi bien dotées. Après le fef.
tin, la nouvelle Epoufe fe rend chés l'Epoux accompagné de fes patens, de fes
amies &c. La marche eft égayée par le fon des Inftrutnens & par une Mufique
Géorgienne: mais ceux qui ont fait le mariage précèdent la marche & fe
hâtent annoncer chés l'Epoux la venue des nouveaux mariés. On leur y préfente
d'abord du pain Se du vin, même de la vi.ande. Eux, fans mettre le pied
dans la maifbn prennent le iîaccon qui contient le vin , Se le repandent autour
du logis. Cette hbation eft comme fanftifiée p.ir des voeux pour la paix
& l'union des Epoux. Ces Me0àgers s'en retournent enfuite .lu devant de la
mariée, que l'on conduit chés le marié, dansl'app.irtement où les parens ôc
les amis font alTemblés. Au milieu de cet appattenient elle trouve fur un tapis
étendu par terre, une cruche de vin & un chaudron plein de cette pâte
qui fert (a) de pain aux Mingreliens. La mariée renverfe la cruche d'un coup
de pié, 3c prenant la pâte â pleines mains en jette par toute la chambre. Il
cft difficile de deviner ce que cela peut fignifier. Eft ce une im.age de l'abondance 5c
de la fécondité du mariage ; ou cela repréfenteroit il un droit femblable à celui d'un
Conquérant qui veut des trophées de fes vidoires ï ou plutôt feroit il impoffible
que chés un peuple grollier cela ne (ignifi,ît rien > quoi qu'il en foit , la
ceremonie eft fuivie des excès de joye ordinaires aux nôces qu'elles que ce puif^
fent être. Mais l'eflentiel du myftere nuptial ne s'y trouve pas encore. On
nous dit que la ceremonie du mari,age fe f.iit en fecret, de peur que les forciers
ne jettent un fort fur les imriés. Ils fe préfentent .avec un parrain devant
un Prêtre, qui lit la formule au clair de fâ bougie allumée. Tout joignant
(a) lU l'appellent Gom & les Turcs Pafij. Voyés en la defcription dans C W r à Tom, I,
Tms III. Part. I, Rt
m