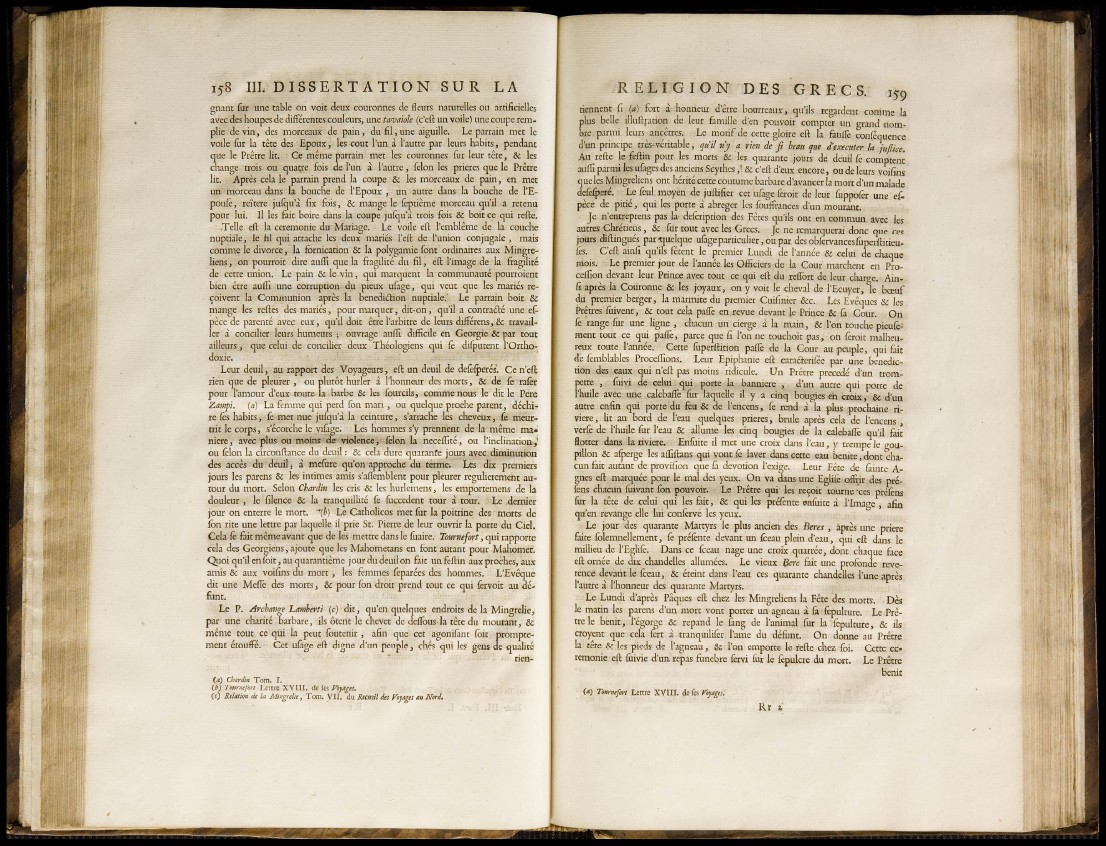
' i l :
llT;
I f - '
i f '
t
L M
1 5 8 I I L D I S S E R T A T I O N S U R LA
gnanc fur une table on voit deux couronnes de fleurs naturelles ou artificielles
avec des houpes de différentes couleurs, une îa'vaiole (c'eft un voile) une coupe remplie
d e v i n , des morceaux de pain, du fil, une aiguille. Le parrain met le
voile fur la tête des Epoux, les cout l'un à l'autre par leurs habits, pendant
que le Prêtre lit. Ce même parrain met les couronnes fur leur tête, & les
change trois ou quatre fois de l'un à l'autre, felon les prières cjue le Prêtre
lit. Après cela le parrain prend la coupe fie les morceaux de pain, en met
un morceau dans la bouche de l'Epoux , un autre dans la bouche de l'Epou[
ê, reïtere jufqu'à fix fois, & mange le feptième morceau qu'il a retenu
pour lui. Il les fait boire dans la coupe jufqu à trois fois 6c boit ce qui refte.
Telle eft la ceremonie du Mariage. Le voile ell l'emblème de la couche
nuptiale, le fil qui attache les deux mariés l'eft de l'union conjugale , mais
comme le divorce, la fornication & la polygamie font ordinaires aux Mingreliens,
on pourroit dire aufli que la fragilité du fil, eft l'image de la fragilité
de cette union. Le pain Se le v i n , qui marquent la communauté pourroient
bien ctre au(îi une corruption du pieux ufàge, qui veut que les mariés reçoivent
la Cominunion après la benedidion nuptiale.' Le parrain boit &:
mange les reftes des mariés, pour marquer, dit-on, qu'il a contradlé une efèce
de parenté avec eux, qu'il doit être l'arbitre de leurs difFérens, & travailler
à concilier leurs humeurs 5 ouvrage auflî difficile en Georgie & par roue
ailleurs, que celui de concilier deux Théologiens qui fè difputent l'Orthodoxie.
Leur deuil, au rapport des Voyageurs, eft un deuil de defèfperés. Ce n'eft:
rien que de pleurer , ou plutôt hurler à l'honneur des morts, & de fe rafer
pour l'amour d'eux toute la barbe & les fourcils, comme nous le dit le Pere
Zam^i. (<î) La femme qui perd fon mari , ou quelque proehe parent, déchi"
re (es habits, fê met nue jufqu'à la ceinture, s'arrache les cheveux, fe meurtrit
le corps, secorche le vilâge. Les hommes s'y prennent de la même maniéré,
avec plus ou moins de violence, felon la necelïîtc, ou l'inclinatioa,'
ou felon la circonftance du deuil : & cela dure quaran(e jours avec diminution
des accès du deuil, à mefure qu'on approche du terme. Les dix premiers
jours les parens & les intimes amis s'aflèmblent pour pleurer regulierement autour
du mort. Selon Chardin les cris & les hurlemens, les emportemens de la
douleur , le filence & la tranquillité fe fuccedent tour à tour. Le dernier
jour on enterre le mort, "(h) Le Catholicos met fur la poitrine des morts de
fon rite une lettre par laquelle il prie St. Pierre de leur ouvrir la porte du Ciel.
Cela lë Elit même avant que de les mettre dans le fuaire. Tournefort, qai rapporte
cela des Georgians,ajoute que les Maliometans en font autant pour Mahomet.
Qiioi qu'il en foit, au quarantième jour du deuil on fait un feftin aux proches, aux
amis éc aux voifins du mort , les femmes fèparées des hommes. L'Evêque
dit une Mefle des morts, & pour fon droit prend tout ce qui {ervoit au défunt.
L e P. Archa-nge Lamberîi {c) dit, qu'en quelques endroits de la Mingrelie,
par une charité barbare, ils ôtent le chevet de deffous la tête du mourant, &
même tout ce qui la peut foutenir, afin que cet agonifant foit promptement
ctoufFé. Cet ufàge eft digne d'un peuple, chés qui les gens de qualité
(a) Chardin Tom. T.
Tonrnefort Lettre XVIII. de Tes royages.
ic) Relation de U Mingrelie, Tom. VII. du Ricmil dts Fojages n
R E L I G I O N D E S G R E C S .
1 5 9
tiennent fi (a) fort à honneur d'être bourreaux, qu'ils regardent comme la
plus belle illuftradon de leur fimille d'en pouvoir compter un grand nombre
parmi leurs anccnes. Le motif de cette gloire eft la fàtifFe confcquence
d'un principe très-véritable, qui! ny a rien de fi hem que d'emcMer k juflice.
Au refte le feftin pour les morts & les quarante jours de deuil fe comptent
auffi parmi les uÊges des anciens S c y t h e s & c'eft d'eux encore, ou de leurs voifins
queles Mingrelicns ont hérité cette coutume barbare d'avancer la mort d'un malade
defcfperc. Le feul moyen de juftifier cet ulàge feroit de leur fuppoiér une et
pcce de pidé, qui les porte à abreger les fouffrances d'un mourant.
J e n'entreprens pas la deicription des Fêtes qu'ils ont en commun avec les
autres Chrétiens, & fur tout avec les Grecs. Je ne remarquerai donc que ces
jours diftingués parijuelque ufageparticulier, ou par des obfervancesfuperftitieufes.
Ccft ainfi qu'ils fêtent le premier Lundi de l'année & celui de cliaque
mois. Le premier jour de l'année les Oificiers de la Cour marchent en Procellion
devant leur Prince avec tout ce qui eft du reffort de leur charge. Ain-
(î après la Couronne & les joyaux, on y voit le cheval de l'Ecuyer, ^le boeuf
du premier berger, la marmite du premier Cuifinier &c. Les Evoques &: les
Frênes fuiveiit, & tout cela paflè en revue devant le Prince 8c fa Cour. On
fe range (ûr une ligne , chacun un cierge à la main, & l'on touche pieufement
tout ce qui paflè, parce que Ci l'on ne touchoit pas, on feroit malheureux
toute l'année. Cette fuperftition paffe de la Cour au peuple, qui 6 it
de femblables Proceffions. Leur Epiphanie eft caraderifée par une benediction
des eaux qui n'eft pas moins ridicule. Un Prêtre précédé d'un trompette
, fuivi de celui qui porte la banniere , d'un autre qui porte de
l'huile avec une calebaife fur laquelle il y a cinq bougies en croix, & d'un
autre enfin qui porte du feu & de l'encens, fe rend à la plus prochaine riviere,
lit au bord de l'eau quelques pricres, brulc après cela de l'encens ,
verfe de l'huile fur l'eau & allume les cinq bougies de la calebafTe qu'il fait
flotter dans la riviere. Enfîiite il met une croix dans l'eau, y trempe le goupillon
& afperge les alfiftans qui vont fe laver dans cette eau benite,dont chacun
fait autant de provifion que la devotion l'e.xige. Leur Fête de fàinte Agnes
eft marquée pour le mal des yeux. On va dans une Eghfe offrir des prélens
chacun fuivant Ibn pouvoir. Le Prêtre qui les reçoit tourne-ces prétèns
fur la tête de celui qui les B i t , & qui les préfeme enfuite à l'Image , afin
qu'en revange elle lui conièrve les yeux.
Le jour des quarante Martyrs le plus ancien des Beres , après une priere
faite folcmncllemenc, fe préfènte devant un fceau plein d'eau, qui eft dans le
millieu de l'Eglifc. Dans ce fceau nage une croix quarrée, dont chaque face
eft ornée de dix ch.indelles allumées. Le vieux Bere fait une profonde reverence
devant le fceau, & éteint dans l'eau ces quarante chandelles l'une après
l'autre à l'honneur des quarante Martyrs.
Le Lundi d'après Pâques eft chez les Mingreliens la Fête des morts. Dès
le matin les parens d'un mort vont porter un agneau à fa fepulture. Le Prêtre
le bénit, l'cgorge & répand le fang de l'animal fur la fcpulture. Se ils
croyent que cela fèrt à tranquililèr l'ame du défunt. On donne au Prêtre
la tête & les pieds de l'agneau, & l'on emporte le refte chez foi. Cette ceremonie
eft fuivie d'un repas funebre fervi fur le fepulcre du mort. Le Prêtre
beni:
W Tmmfin Lettre XVIII. de fe yijain.
K r