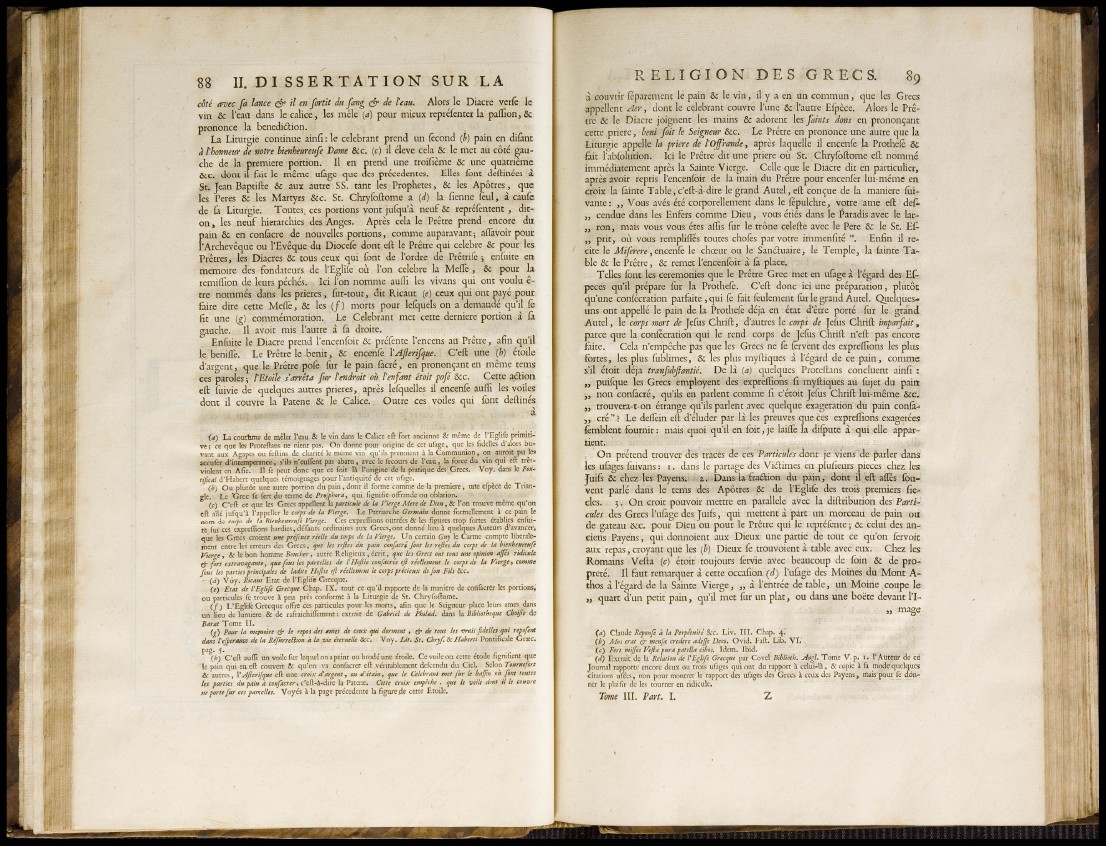
w
ü li::
K 88 II. DI S S E R T A T I O N SUR LA
côté amc f a Unce ér 'I ™ /""g & Alors le Diacre verlê le
vin & l'eau dans le calice, les mêle (a) pour mieux repréfenter la palTion, Se
prononce la benediftion.
La Liturgie continue ainfi : le celebrant prend un (êcond (h) pain en difant
à thmnem de votre bienheureufe Dame &c. (c) il eleve cela & le met au côte gauche
de la premiere portion. Il en prend une troifième & une quatrième
&c. dont il fait le même ufàge que des précédentes. Elles font deftinées à
St. Jean Baptifte & aux autre SS. tant les Prophètes, & les Apôtres, que
les Peres & les Martyrs &c. St. Chryfoftome a (d) la fienne (eul, à caufe
de fa Liturgie. Toutes, ces portions vont jufqu'à neuf ôc rcprcfcntent , diton
, les neuf hierarchies des Anges. Après cela le Prêtre prend encore du
>ain Se en conlâcre de nouvelles portions, comme auparavant ; aflivoir pour
'Archevêque ou l'Evêque du Dioceiè dont eft le Prêtre qui célébré & pour les
Prêtres, les Diacres & cous ceux qui font de l'ordre de Prctrilè ; enlûite en
memoire des fondateurs de l'Eglile où l'on célébré la Meflè , & pour la
remillion de leurs péchés. Ici l'on nomme aulli les vivans qui ont voulu être
nommés dans les prieres, fur-tout, dit Ricaut (e) ceux qui ont payé pour
faire dire cette Meife, & les (ƒ) morts pour lelquels on a demandé qu'il fe
fit une (g) commémoration. Le Celebrant met cette derniere portion à fà
gauche. Il avoit mis l'autre à fa droite.
Enfuite le Diacre prend l'encenfoir & prefente l'encens an Prêtre, afin qu'il
le benilfe. Le Prêtre le bénit, & encenfe \'AJlerif^iie. Ceft une (h) étoile
d'argent, que le Prêtre polê fur le pain ficré, en prononçant en même rems
ces paroles ; l'Etoile s'arrêta fur l'endroit où l'enfant était pofé &c. Cette a â i on
eft fuivie de quelques autres prieres, après lefquelles il encenfe auffi les voiles
dont il couvre la Patene & le Calice. Outre ces voiles qui font deftinés
U ) La couthme de mêler l'eau & le vin dans le Calice eft fort ancienne S: même de l'Eglife primitiv
e ; ce que les Proteftam ne nient pas. On donne poui" origine de cet ufage, que les fidelles d'alors buvant
aux Agapes ou feftins de cliariré le meme vin qu'ils prenoicnr à la Communion, on auroir pu les
acculer d'intemperance, s'ils n'euffent pas abatu, avec le fecours de l'eau, la force du vin qui eft trèsviolent
en Aiie. l! fe peut donc que ce foie là l'origine de la pi-atique des Grecs. Voy. dans le Po»^
tißcal d'Habert quelques témoignages pour l'antiquité de cet ufage.
0 ) Ou plutôt une autre pomon du pain, dont il forme comme de la premiere, urte efpèce de Triangle.
Le 'Grec fe fert du terme de Prejphara^ qui fignifie offrande ou oblation.
( c ) C e f t ce que les Grecs appellent la partie nie de la Flerge Aîeri de Dieu, Se l'on trouve même qu'on
cft allé jufqu'à l'appeller le corps de la Vitrge. Le Patriarche Germain donne formellement à ce pain le
nom de corps de la Bienheiircufi Vierge. Ces expreffions outrées & les figures trop fortes établies enfuite
fur ces cxpreffions hardies, défauts ordinaires aux Grecs,ont donné lieu à quelques Auteurs d'avancer,
que les Grccs croient une préfmce réelle du corps de U Vierge. Un certain GHJ le Carme compte libéralement
entre les erreurs des Grecs, Us refies du pain confacrg font les refies du corps de la hienheuriufi
Vierge, & le bon homme Boucher, autre Religieux, e'crit, ^w les Grecs ont tous une opinion ajfe's ridicule
fort extravagante, <jue fous Us parcelUs de l'Hofiie confacrée efi réellement U corps de U Vierge y comme
foHs les parties principales de ladite ILfiie ( f i re'elUmnt U corps précieux de fort Fils &c.
• (_d) V o y . Ricauc Etat de l'Eglife Grecque.
( e ) Etat de l'Eglife Crecc^ue Chap. IX. tout ce qu'il rapporte de la manière de confacrCr les portions,
ou particules fe trouve à peu près conforme à la Liturgie de St. Chryfoftome.
C/) L'Eglife Grecque offre ces particules pour les morts, afin que le Seigneur place leurs ames dans
•un lieu de lumiere & de rafraichiffemcnt : extrait de Gabriel de PhtUd. dans la Bibliothcque Choiße de
Bar at Tome IL
{g) Pour la mepjoire I« >''pos "w« ^^ dorment , dr de tous Us vmis ßdelles ejui repofent
dans refperoMce de la Réfurretiwn k la vie éternelle &c. Voy. Lit. St. Chryf. & llakrti Pontificale Grsc.
^ \ h l C e f t auffi un voile fur lequel on apeint ou brodé une étoile. Ce voile ou cette étoile fignifient que
le pain qui en eft couvert & qu'on va confacrer eft véritablement defcendu du Ciel. Selon Tournefort
& autres, V^fieriJ^ue eft une croix d'argent, ou â'éiain, ^uc le Celebrant met fur U baßn «u font toutes
les parties du pain à confacrer, c'eft-à-dire la Patene. Cette croix eptpcche , que le voile dont il U couvre
ne porte fur ces parcelles. Voyés à la page préccdcnte la figure ,de cette EtoiJc.
R E L I G I O N DES GRECS. 89
.à couvrir féparement le pain & le v i n , il y a en un commun, que les Grecs
appellent Aer, dont le celebrant couvre l'une & l'autre Efpèce. Alors le Prêtre
& le Diacre joignent les mains & adorent les faints dons en prononçant
cette prière, heni foit le Seigneur &c. Le Prêtre en prononce une autre que la
Liturgie appelle la priere de l'Offrande, après laquelle il encenfe la Prothelc ôc
fait l'abfolution. Ici le Prêtre dit une priere où St. Chryfoftome ell nommé
immédiatement après la Sainte Vierge. Celle que le Diacre dit en particulier,
après avoir repris l'enccnfoir de la main du Prêtre pour encenlèr lui-même en
croix la làinte Table, c'eft-à-dire le grand Autel, eft conçue de la maniéré fuivante
: ,, Vous avés été corporellement dans le fêpulchre, votre ame eft def-
„ cendue dans les Enfers comme Dieu, vous éties dans le Paradis avec le lar-
„ ron, mais vous vous êtes aifis fur le trône celefte avec le Pere Se le St. E t
„ prit, où vous rempliffés toutes chofes par votre immenfité ". Enfin il recite
le Miferere,cnccnCe le choeur ou le Sanduaire, le Temple, la fainte Table
& le Prêtre, & remet l'encenfoir à fa place.
Telles font les ceremonies que le Prêtre Grec met en ufage à l'égard des E t
peces qu'il prépare fur la Prothefe. Ceft donc ici une préparation, plutôt
qu'une confécration parfaite, qui le fait feulement fur le grand Autel. Qtielquesuns
ont appellé le pain de la Prothefe déjà en état d'être porté fur le grand
Autel, le corps mort de Jefùs Chrift, d'autres le corps de jelus Chrift imparfait^
p.arce que la confécration qui le rend corps de Tefus Chrift n'eft pas encore
faite. Cela n'empêche p.a5 que les Grccs ne fè fervent des expreftions les plus
fortes, les plus fublimes, & les plus mylBques à l'égard de ce pain, comme
s'il étoit déjà tranfuhflantié. De là (a) quelques Proteftans concluent ainfi :
„ puifque les Grecs employent des expreftions fi myftiques au fujet du pain
„ non confacré, qu'ils en parlent comme fi c'étoit Jefus Chrift lui-même &c.
j , trouvera-t-on étrange qu'ils parlent avec quelque exagération du pain confit^
3, cré " ? Le deflèin efl d'éluder par là les preuves que ces expreffions exagerées
fcmblent fournir : mais quoi qu'il en foit, je laifTe la difpute à qui elle appartient.
On prétend trouver des tracés de ces Particules dont je viens de parler dans
les ufàges fuivans : i . dans le partage des Vidimes en pluficurs pieces chez les
Juifs & chez les Payens. i. Dans la fradion du p.lin, dont il eft aftès fouvent
parlé dans le tems des Apôtres & de l'Eglife des trois premiers fiecles.
;. On croit pouvoir mettre en parallele avec la diftribution des Particules
des Grecs l'ufage des J u i f s , qui mettent à part tm morceau de pain ou
de gateau &c. pour Dieu ou pour le Prêtre qui le repréfente ; & celui des anciens
Payens, qui donnoient aux Dieux une partie de tout ce qu'on fervoit:
aux rep.is, croy.int que les {b) Dieux fe trouvoient à table avec etrx. Chez les
Romains Vefia (c) étoit toujours fervie avec beaucoup de foin & de propreté.
Il faut remarquer à cette occafion ( d ) l'ufage des Moines du Mont Athos
à l'égard de la Sainte Vierge, „ à l'entrée de table, un Moine coupe le
„ quart d'un petit p.iin, qu'il met fur un p l a t , ou dans une boëte devant l'I-
„ m.age
(a) Claude Rtpaiift k U Pirpt'iiiiii &c. Llv. III. Clup. 4.'
(4) tral & mm/« nickr, a j r j f , Dm. Ovid. Faft. Lib. VI.
(c) Fert Mifos yèjla pura pntilU cihoi. Idem. Ibid.
( 4 Extraie de la Rclutkn de l'Eglife Grecejue par Covel Biblipth. Tome V. p. 1. l'Auteur de ce
Journal rapporte encore deux ou trois ufages qui onr du rapport i celui-là, & copie à fa mode quelques
cicarions ufées, non pour montrer le rapport des ufages des Grecs à ceux des Payens, mais pour fe donner
le plaifir de les tourner en ridicule.
Tmm III. Part. I. Z
wm