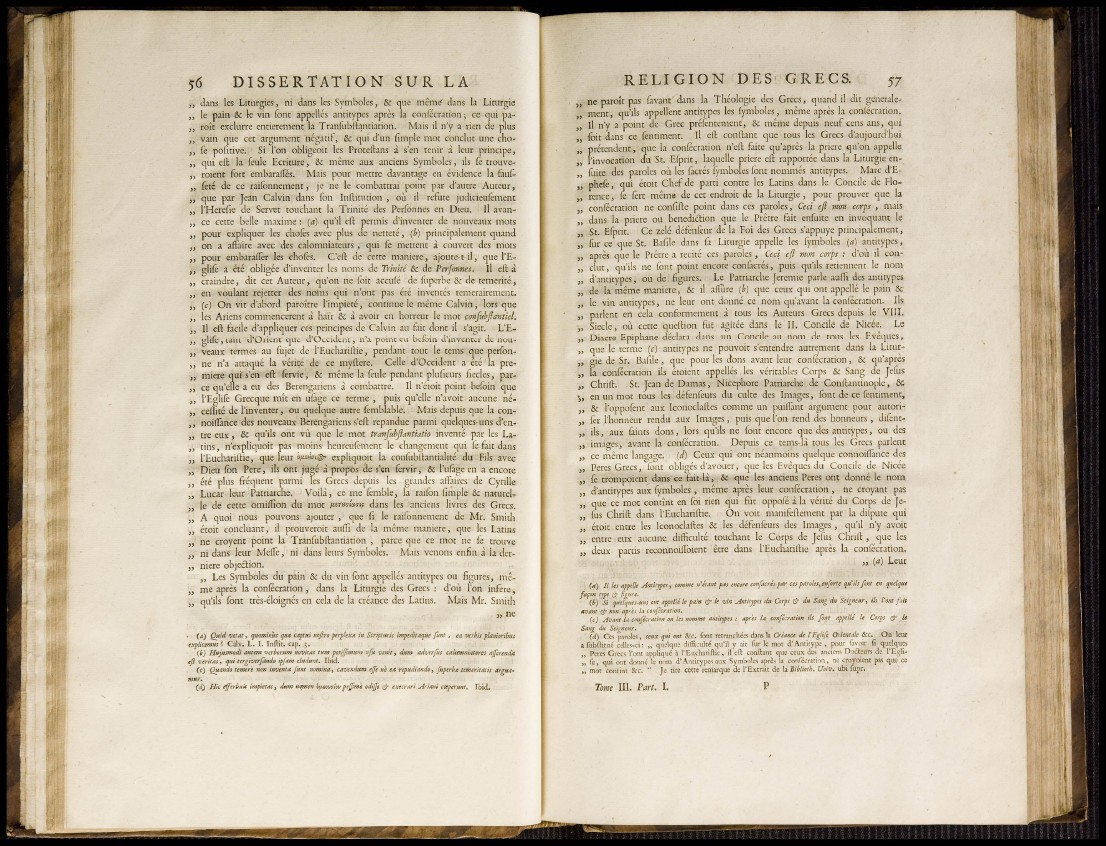
u
5 .
, à -
I iir
t«(f.i,
56 D I S S E R T A T I O N SUR LA
J, dans les Liturgies, ni dans les Symboles, & que même' dans la Liturgie
„ le pain & le vin font appelles antitypes après la confccration ; ce qui pa-
„ roîc exclurre entièrement la Tranfiibilantiacion. Mais il n'y a rien de plus
„ vain que cet argument négatif, Se qui d'un fimple mot conclut une cho-
, , (è pofitive. Si l'on obligeoit les Proceftans à s'en tenir à leur principe,
, , qui ell la feule Ecriture, & mcme aux anciens Symboles, ils (è trouvej,
roienc fort embarafl"és. Mais pour mettre davantage en évidence la fiuf-
,, fête de ce raifonnement, je ne le combattrai point par d'autre Auteur,
„ que par Jean Calvin dans (on Inllitution , où il refute judicieufêmenc
„ i'Herefie de Servet touchant la Trinité des Pcrfonnes en Dieu. Il avan-
,, ce cette belle maxime : {a) qu'il cil permis d'inventer de nouveaux mots
„ pour expliquer les chofc avec plus de netteté, [b) principalement quand
, , on a affaire avec des calomniateurs, qui le mettent à couvert des mots
„ pour embaraflèr les chofes. Ceft de cette maniéré, ajoute-t-il, que l'Ej
, çli(è a été obligée d'inventer les noms de Trinité & de Pcrfonnes. Il elt à
, , craindre, dit cet Auteur, qu'on ne foit accu(é de fuperbe & de témérité,
„ en voulant rejetter des noms qui n'ont pas été inventes temcrairement.
„ {c) On vit d'abord paroître l'impiété, continue le mcme Calvin, lors que
„ les Ariens commencèrent à haïr 6c à avoir en horreur le mot confuhfantiel.
„ il ell: facile d'appliquer ces principes de Calvin au fiit dont il s'agit. L'E-
„ glife, tant d'Orient que d'Occident, n'a point eu befoin d'inventer de nou-
, , veaux termes au fujet de l'Euchar-itHe, pendant tout le tems c|ue perfon-
„ ne n'a attaqué la vérité de ce myllere. Celle d'Occident a été la pre-
„ miere qui s'en eft fervie, tz mcme la {èule pendant plufieurs fiecles, par-
, , ce qu'elle a eu des Berengariens à combattre. Il n'ctoit point befoin que
j , l'Eglifè Grecque mît en uiâge ce terme , puis qu'elle n'avoit aucune né-
„ ceflitc de l'inventer, ou quelque autre (emblable. Mais depuis que la con-
, , noiflànce des nouveaux Berengariens s'eft répandue parmi quelques-uns d'en-
, , tre e u x , & qu'ils ont vii que le mot tYanfuhJîantiaîto inventé par les La-
„ tins, n'expliquoit pas moins heureufement le changement qui (ê fait dans
j , l'Eucharillie, que leur o^ca«-»©- expliquoit la condibilantialitc du Fils avec
„ Dieu fon Pere, ils ont jugé à propos de s'en fêrvir, & l'ufageen a encore
, , été plus fréquent parmi les Grecs depuis les grandes affaires de Cyrille
j, Lucar leur Patriarche. Voilà, ce me fèmble, la raifon fîmple & naturel-
, , le de cette omiflion du mot p-vtadaim dans les anciens livres des Grecs.
„ A quoi nous pouvons ajouter , que fi le raifonnement de Mr. Smith
„ étoit concluant, il prouveroit aufTi de la mcme maniéré, que les Latins
,, ne croyent point la Tranfubftantiation , parce que ce mot ne (ê trouve
„ ni dans leur MefTe, ni dans leurs Symboles. Mais venons enfin à la dcr-
„ niere objection.
„ Les Symboles du pain & du vin font appellés antitypes ou figures, me-
„ me après la confëcration , dans la Liturgie des Grecs : d'où l'on infere,
„ qu'ils font très-éloigncs en cela de la créance des Latins. MAIS Mr. Smith
„ ne
• vet at J (juom'wus ^ti<c captai »ofiro ferpUxa in Scriparis impgtiiia<jnc fnnt, ta verbis planioribus
explicemus Calv. L . I. Inftit. cap. 3.
C^) HHjHsmodi autem vcrbornm novitas ttm pot'ijjimiim ufn vem, dum advtrfiis cahmniatores nferenda
ejî •Veritas, (jHi tergiverfando rpfàm eluduit. Ibvd.
(c) Onundo teratre non inventa fmt nomina, cavendum tjfe ni en repudinndf, fnpirl>4 temeritaiis argtiA'
{d) Hic eferlriik impietas, dnm nmtn huMVJÎav psjjime odijf« c^ execrm ^iriani capermt. Ibid.
R E L I G I O N DES GRECS. 57
ne paroît pas fâvanf dans la Théologie des Grecs, quand il dit généralement,
qu'ils appellent antitypes les lymboles, même après la conlécration.
Il n'y a point de Grec préfentement, & même depuis neuf cens ans, qui
foit dans ce fentiment. Il elt confiant que tous les Grecs d'aujourd'hui
prétendent, que la confécration n'efl fiite qu'après la priere qu'on appelle
l'invocation du St. Efprit, laquelle priere eft rapportée dans la Liturgie enfuite
des paroles où les facrés fymboles font nommés antitypes. Marc d'Ephcfe,
qui étoit Chef de parti contre les Latins dans le Concile de Florence,
(e fert même de cet endroit de la Liturgie, pour prouver que la
confécration ne confifte point dans ces paroles, Ceci eji mon corps , mais
dans la priere ou benedidion que le Prêtre fait enfuite en invoquant le
St. Efprit. Ce zélé défenfeur de la Foi des Grecs s'appuye principalement,
, fur ce que St. Bafile dans fi Liturgie appelle les fymboles (a) antitypes,
, après que le Prêtre a recité ces paroles , Ceci ejî mm corps : d'où il conclut,
qu'ils ne font point encore conlàcrés, puis qu'ils retiennent le nom
, d'ancitypes, ou de figures. Le Patriarche Jeremie parle aulli des antitypes
. de la même maniéré, & il aflure {h) que ceux qui ont appelle le pain
, le vin antitypes, ne leur ont donné ce nom qu'avant la confccration. Ils
, parlent en cela conformément à tous les Auteurs Grecs depuis le VIII.
, Siecle, où cette queftion fut agitée dans le IL Concile de Nicée. Le
, Diacre Epiphane déclara dans un Concile au nom de tous les Evêques,
, que le terme (c) antitypes ne pouvoit s'entendre autrement dans la Litur-
, gie de Sr. Bafile, que pour les dons avant leur confccration, & qu'après
, la confécration ils étoient appellés les véritables Corps & Sang de Jefus
, Chrift. St. Jean de Damas, Nicephore Patriarche de Conrtantinoplc, èc
, en un mot tous les défenfeurs du culte des Images, font de ce fentiment.
& l'oppofent aux Iconoclaftes comme un puiffant argument pour autorifer
l'honneur rendu aux Images, puis que l'on rend i" ' honneurs, difentils,
aux faints dons, lors qu'ils ne font encore qu( des antitypes, ou des
images, avant la confécration. Depuis ce tems-là tous les Grecs parlent
ce même langage, [d] Ceux qui ont néanmoins quelque connoillance des
Peres Grecs, font obligés d'avouer, que les Evêques du Concile de Nicée
fe trompoient dans ce fait-là, & que les anciens Peres ont donné le nom
d'antitypes aux fymboles, même après leur confécration , ne croyant pas
que ce mot contînt en foi rien qui fut oppofé à la vérité du Corps de Jefus
Chrift dans l'Euchariftie. On voit manifçflement par la dilpute qui
étoit entre les Iconoclaftes & les défenfeurs des Images , qu'il n'y avoit
entre eux aucune difficulté touchant le Corps de Jeius Chrift , que les
deux partis reconnoifToient être dans l'Euchariftie après la confécration.
,, ia) Leur
upar is paroleSjenforte qu'ils fini en ^«f/^«?
(a) Il les appelle Antitypes, cemme »'e't.vit pas encore confia
façon ijpe (ß- figure. .
ib) Si ifMClejrtes-lins ont appelle le pain le vin .Antitypes du Corps & du Sang <r, dit ils Seigne
l'ont f.Ut
4vant non aprii la confécration.
{c) Avant U confécration on les nomme antitjpes : après l.t confécration ils font appelle le Corps Q- le
Sang du Seignenr.
(d) Ces paroles, ceux qui ont Scc. font retranche'ês dans la Créance de l'Eglife Orientale Scc. On leur
" fubftinié celk^-ci: „ quelque difficulté qu'il y ait fur le mot d'Antityps , pour favoir Ci quelques
, Peres Grecs l'ont appliqué h l'Euchariftie, il eft conftant que ceux des anciens Docteurs de l ' E g l i -
, f e , qui ont donne le nom d'Antitypes aux Symboles après la confécration, ne croyoient pas que cc
, mot contint & c . •"• J' e ti•r e ce-t te remarque d' e l 'Ext rai t d•»e- la Biblioth. rUrn.:i.v.. -uSbii ff\uipprr..
Tome 111. Part. l.