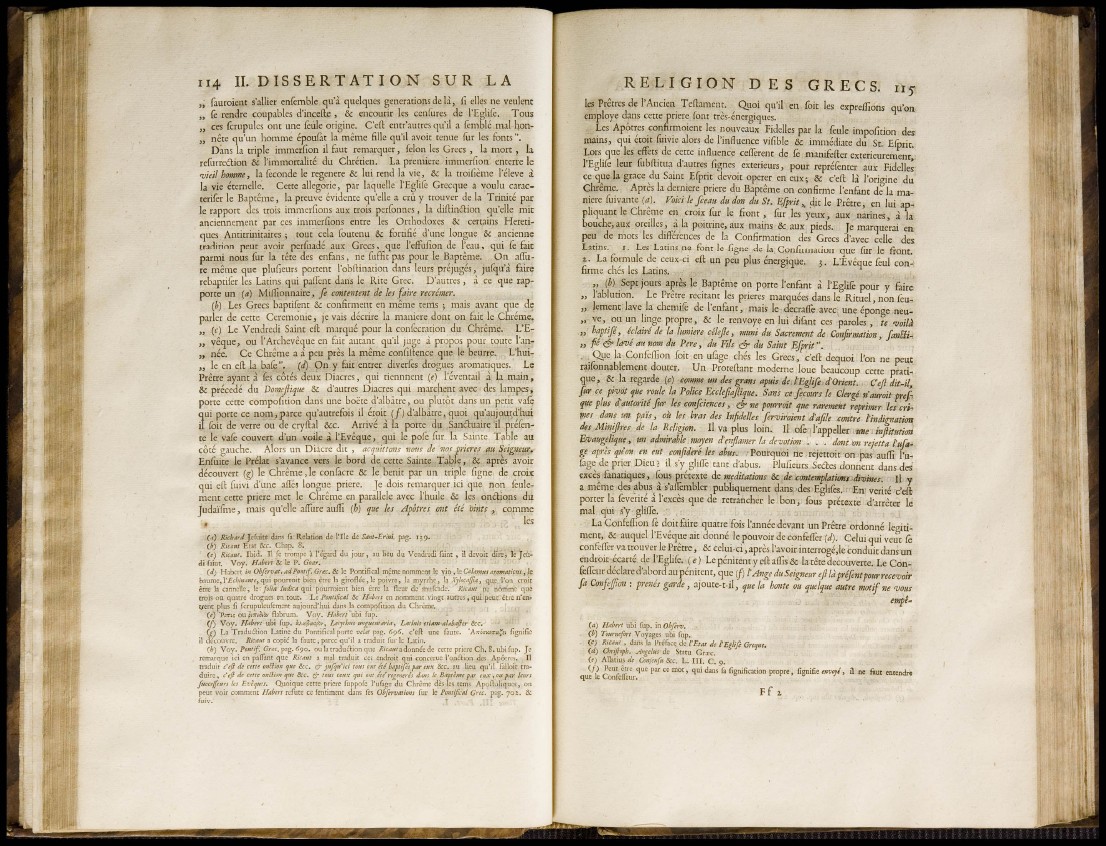
fn m
114 II. D I S S E R T A T I O N SUR LA
„ fauroient s'allier enfemble qu'à quelques generations de là, fi elles ne veulent
„ fe rendre coupables d'incelle , & encourir les cenfures de l'Eglilè. Tous
„ ces fcrupules ont une lèule origine. C'efi: enrr'autres qu'il a lêmblc mal hon-
,, nête qu'un homme époufàt la même fille qu'il avoir tenue (ùr les fonts ".
Dans la triple immerfion il faut remai-quer, felon les Grecs , la mort, la
refurreclion Se l'immortalité du Chrétien. La premiere immerfion enterre le
'vieil homme, la féconde le regcnere & lui rend la vie, & la troilicme l'éleve à
la vie éternelle. Cette allcgorie, par laquelle l'Eglilê Grecque a voulu caracterifer
le Baptême, la preuve évidente qu'elle a crû y trouver de la Trinité par
le rapport des trois immerfions aux trois pcrfonnes, la diftinflion qu'elle mit
anciennement par ces immerfions entre les Orthodoxes & certains Hérétiques
Antitrinitaires ; tout cela (ôutenu & fortifié d'une longue & ancienne
tradition peut avoir perfuadé aux Grecs, que l'efFufion de l'eau, qui fe fait
parmi nous (ùr la tête des enfàns, ne fuffit pas pour le Baptême. On alfure
même que plufieurs portent l'obftination dans leurs préjugés, jufqu'à faire
rebaptilér les Latins qui paffcnt dans le Rite Grec. D'autres, à ce que rapporte
un (a) Milfionnaire, fe cmîentent de les faire recïémer.
(h) Les Grecs bapriient & confirment en même rems ; mais avant que de
parier de cette Ccremonie, je vais décrire la maniéré dont on fait le Chrême.
„ {c) Le Vendredi Saint eft marqué pour la conlècration du Chrême. L'E-
„ vêque, ou l'Archevêque en fait autant qu'il juge à propos pour toute l'.rn-
„ née. Ce Chrême a à peu près la même confiltence que le beurre. L'hui-
„ le en efl: la bafe ". (d] On y Élit entrer diverfes drogues aromatiques. Le
Prêtre ayant à fes côtés deux Diacres, qui tiennnent (e) l'éventail à la main,
& précédé du Domefiqae Se d'autres Diacres qui marchent avec des lampes,
porte cette compofition dans une boete d'albâtre, eu plutôt dans un petit vafe
qui porte ce nom, parce qu'autrefois il étoit (ƒ) d'albâtre, quoi qu'aujotird'hui
il foit de verre ou de cryllal &c. Arrivé à la porte du Sanftuaire il préfente
le vafe couvert d'un voile à l'Evêque, qui le pofe fur la Sainte Table au
côté gauche. Alors un Di.icre dit , ac>j'àttoftî nonr de mç p-ieres au Seigneur.
Enfuite le Prélat s'avance vers le bord de cette Sainte Table, Se après avoir
découvert (g) le Chrême,le conlâcre & le bénit par un triple figne de croix
qui efl; fuivi d'une alTéa longue priere. ]e dois remarquer ici que non ieulement
cette priere met le Chrême en parallèle avec l'huile !c les onébions du
Judaïfme, mais qu'elle afilire aulïï (h) que les Apôtres ont été 'oints , comme
les
C-O Richard Jcfiiite dan^ fa. R e l a t i o n de l ' I l e de Sant-Eritii. pag. 1 5 9.
(b) Sicaut Etat &ir. Cliap. 8.
(1?) Ricnut. Ibid. Il fe trompe à l'e'gard du j o u r , au lieu d u Vendredi faint , il dovoic d i r e , le J e û -
di faiut. V o y . Habert & le P . Goar.
(d) Habert i» Ohfervat. adPonif. Grac. & le Pontifical même nomment le v i n , le Calamus aromaticus, le
b a u m e , q u i pourroit bien être la g i r o f l é e , l e p o i v r e , la m y r r h e , la Xyhcajjitt, que l'on croit
être la cannelle, foUa îndica<\m pourroient bien être h fljur de miifcade. Rkmt ne nOmmc que
trois o a quatre drogues en tout. Le Pomifîcal & H'ikn en nomment vingt a u t r e s , qui peut Être n'entjrent
plus fi fcrupuleufement aujourd'hui dans la compofition d u Chrême.
i e ) 'PiTT«; o u (tviSiàv flabrum. V o y . Hubert *ubi fup.
( f ) V o y . M'ibert ubi fup. h-ct^eijfw, Lecythm ungnewaria, Lmlnh etUm al.éafier Src.
ig) La T r a d u f t i o n Latine d u Pontifical porte vd.it pap. 6<)6. c'eft une faute. 'AZO^KSTU^H fignifîe
il découvre. Ricaut a copié la f a u t e , parce q u ' i l a traduit fur le Latin.
C/j) V o y . Pontif. Grrfir. png. (Î90. ou la t r a d u â i o n q u e /Îic-î«? a donnée de cette priere C h . 8. ubi f u p . Je
remarque ici en paffant que Ricaiit a mal traduit cec endroit qui conceitie l ' o n f i i o n des Apôtrts. Il
traduit c'eji de cette enSlio» que & c . cJ- jtf^ft'ici tous ont (té haptifcs par eux & c . au lieu q u ' i l f i l l o i t trad
u i r e , c'efi de cette onBion (jt/e & c . ^ tout cett.v ejui ont e'te'régénérés d.ms le Baptême par eux, ou par leurs
fucceffeurs Us Evèqufs. Q,uoique cette priere fuppofe l'ufage du Chrême dès les tems A p o f t o j i q u e s , ou
peut v o i r comment Habert refute ce fentiment dans fes Objirvations fur le Poniijïcal Grec. pag. 7 0 1 . &
f u i v .
R E L I G I O N D E S GRECS. 115
les Prêtres de l'Ancien Teftament. Quoi qu'il en foit les expreffions qu'on
employe dans cette priere (ont très-cnergiques.
Les Apôtres confirmoient les nouveaux Fidelles par la feule impofition des
mains, qui étoit fuivie alors de l'influence vifible & immédiate du St. Efptit.
Lors que les effets de cette influence cefferent de fe manifefter exterieuremenr^
l'Eglife leur fubftitua d'autres fignes extérieurs, pour reprcfenter aux Fidelles
ce que la gr.ace du Saint Efptit devoir opérer en eux; & c'eft là l'origine du
Chrême. Après la derniere priere du Baptême on confirme l'enfant de la maniéré
fuivante {al Voici le fceau dudm du St. Efp-itdit le Prêtre, en lui appliquant
le Chrême en croix fur le front, fur les yeux, aux narines, à la
bouche,aux oreilles, â la poitrine, aux mains & aux pieds. Je marquerai en
peu de mots les différences de la Confirmation des Grecs d'avec celle des
Latins, t. Les Latins ne font le figne de la,Confirmation oue fur le front,
t . La formule de ceux-ci eft un peu plus énergique. 3. L'Évêque feul confirme
chés les Latins.
„ (h\ Sept jours après le Baptême on porte l'enfant à l'Eglife pour y faire
„ l'ablution. Le Prêtre récitant les prieres marquées dans le Rituel, non feu-.
„ lement lave la chemife de l'enfant, mais le decraflè avec une éponge neu-
„ ve, ou un linge propre, & le renvoyé en lui difant ces paroles, "te voilà
„ Uftifé, éclairé de la lumitri cékp, muni du Sacrement de Confrmatim, fanSi-
„ fié é' lamé au nom du Pere, du Fi/s é- du Saint Efprit ".
, Que la Confeffion foit en ufage chés les Grecs, c'eft dequoi l'on ne peut
raifonnablement douter. Un Proteftant moderne loue beaucoup cette pratique,
& la regarde (c) comme un des grans apuis de l'Eglife d'Orient. CeJ! dit-il,
fur ce pi'vot que roule la Police Ecclefiafiique. Sans ce fecours k Clergé n'amoit tref
que plus d'autorité fur les confciences, é-ne pourroit que rarement reprimer les crimes
dans wn pais, oh les iras des Infidelles ferniroient d'afile contre l'indinatim
des Minières de la Religion. Il va plus loin. Il ofc l'oppeller me infitutim
Evaagelique, m admirable miyen d'enfamer la devotion . . . dont on rejetta l'ufage
après qttait en eut conftderé les ahus. Pourquoi ne rejettoit on pas auffi l'ufage
de prier Dieu > il s'y gliffe tant d'abus. Plufieurs .Sefles donnent dans des
excès fanatiques, fous prétexte de meditations èc de contemplations é-vines. Il y
a même des abus à s'alTembler publiquement dans des Eglifes.. En' vérité c'eft
porter la feverité à l'excès que de retrancher le bon, fous prétexte d'arrêter le
mal qui s'y glilTe.
La ConfefTion fe doit faire quatre fois l'année devant un Prêtre ordonné légitiment,
& auquel l'Evêque ait donné le pouvoir de confelfer (</). Celui qui veut fe
confelfer va trouver le Prêtre, & celui-ci, après l'avoir interrogé,le conduit dans un
endroit écarté de l'Eglife. (e) Le pénitent y eft afl:is& latêtedecouverte. Le Confetfeur
déclared'abord au pénitent, que (ƒ)/'/ÏHg,
fa Confefjim : preîiés garde, ajoute-t-il, que la hante cm quelque autre motif ne 'vous
U) Halfert ubi fup. in Olfferv.
Ci) Tmrnrfort Voyages ubi fup.
Ce) Riaitt , dans la Préface de [E,at di tErlifi Crtm,.
( J ) Chripfh. ^ngil^yie Statu G r a c.
Cî) Allatius dt Cminfi. Sic. L. I I I , c . 9.
q u c ' ' l i & n f e l è u r ' ' " ° " "S""''^"'''" ^ ^ ^ entendre
F f 1
1 rt