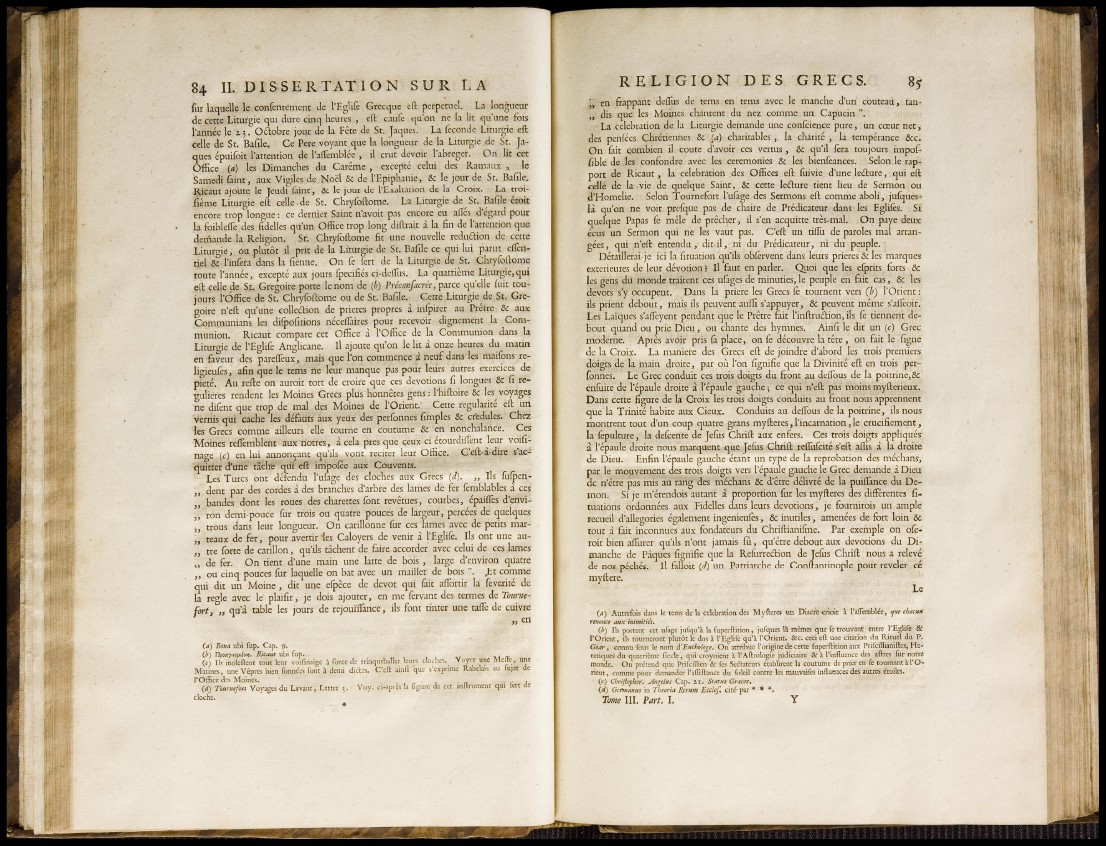
iîfr ;
84 II. D I S S E R T A T I O N SUR LA
far laquelle le confcnrtmcnt de l'Eglife Grecque cft perpétuel. La longueur
de cette Liturgie qui dure cinq heures , efl: caufe qu'on ne la lit qu'une fois
l'année le z 5. Oftobre jour de la Fête de St. Jaques. La fécondé Liturgie eft
celle de St. Bafile. Ce Pere voyant que la longueur de la Liturgie de St. Jaques
epuifoit l'attention de raffemblce , il crut devoir l'abréger. On lit cet
Office (d) les Dimanches du Carême , excepté celui des Ramaux le
Samedi faint, aux Vigiles de Noël & de l'Epiphanie, & le jour de St. Bafile.
Ricaut ajoute le Jeudi faint, & le jour de l'Exaltation de la Croix. La troifième
Liturgie ell celle.de St. Chryfoftome. La Liturgie de St. Bafile étoit
encore trop"longue: ce dernier Saint n'avoit pas encore eu aCfcs d'égard pour
la foiblelTe des fidelles qu'un OfEce trop long diftrait à la fin de l'attention que
deriiande la Religion. St. Chryfoltome fit une nouvelle reduaion de cette
Liturgie, ou plutôt il prit de la Liturgie de St. Bafile ce qui lui parut elTeritiel
& l'infera dans la fienne. On fe îcrt de la Liturgie de St. Chryfollome
toute l'année, excepté aux jours fpecifics ci-deûtis. La quatrième Liturgie,qui
e a celle de St. Gregoire porte le nom de (S) Précanficrée, parce qu'elle fuit toujours
l'Office de St. Chryfoftome ou de St. Bafile.^ Cette Liturgie de St. Gregoire
n'eft qu'une colleftion de prieres propres à infpirer au Prêtre & aux
Communians les difpofitions nécefTaires pour recevoir dignement la Communion.
Ricaut compare cet Office à l'Office de la Communion dans la
Liturgie de l'Eglife Anglicane. Il ajoute qu'on le lit à onze heures du matia
en &veur des pareiïèux, mais que l'on commence à neuf dans les maifons religieufes,
afin que le tems ne leur manque pas pour leurs autres exercices de
pieté. Au refle on auroit tort de croire que ces devotions fi longues & fi régulières
rendent les Moines Grecs plus honnêtes gens : l'hiftoire & les voyages
ne difent que trop de mal des Moines de l'Orient. Cette régularité efl: un
vernis qui cache les défauts aux yeux des perfonnes fimples & crtdules. Chez
les Grecs comme ailleurs elle tourne en coutume & en nonchalance. Ces
Moines reffemblent aux nôtres, à cela près que ceux-ci étourdilîent leur voifinage
(c) en lui annonçant qu'ils vont reciter leur Office. C'efl-à-dire s'acquitter
d'une tâche qui efl: inipofée aux Couvents.
Les Turcs ont défendu l'uCige des cloches aux Grecs (</). „ Us fulpen-
„ dent par des cordes à des branches d'arbre des lames de fer femblables à ces
„ bandes dont les roues des charettes font revêtues, courbes, épaiffes d'envi-
„ ron demi pouce fur trois ou quatre pouces de largeur, percées de quelques
„ trous dans leur longueur. On carillonne fur ces lames avec de petits mar-
„ teaux de f e r , pour avertir 'les Caloyers de venir à l'Eglife. Ils ont une au-
„ tre forte de carillon, qu'ils tâchent de faire accorder avec celui de ces lames
„ de fer. On tient d'une main une latte de bois , large d'environ quatre
„ ou cinq pouces fur laquelle on bat avec un maillet de bois ". f t comme
qui dit un Moine , dit une efpcce de dévot qui fait affortir la feverité de
la regie avec le plaifir, je dois ajouter, en me fervant des termes de Toamefort,
„ qu'à table les jours de rejouïffance, ils font tinter une talfe de cuivre
„ en
U) Boita iibi fup. Cap. 9.
(l>) npoa^tç/iÉïi). Ricanl ubi fup. , ,, w-
(£) lU moleftent tout leur voifinaige à forcc de trinqiicballer leurs cloches. Voyre une Melle, une
Matines, une Vêpres bien fonn&s font à demi diûes. C'ett jinfi que s'cxpnmc Rabelais au fujet de
l ' O f f i c e des Moines. • r j
(d) Tcumtfm Voyages du Levant, Lettre v Voy. ci-iprès la ligure de cet inftrument qui fert de
cloche.
R E L I G I O N DES GRECS.
en fi:appant deffus de tems en tems avec le manche d'un couteau, tan-
„ dis que les Moines chantent du nez comme un Capucin ".
La celebration de la Liturgie demande une confcience pure, un coeur net,
des penfces Chrétiennes & \a) charitables , la charité , la tempérance &c.
On fait combien il coûte d'avoir ces vertus, &: qu'il fera toujours impof^
fible de les confondre avec les ceremonies & les bienfeances. Selon le rapport
de Ricaut, la celebration des Offices efl: fuivie d'une leûure, qui eft
celle de la-vie de quelque Saint, & cette lefture tient lieu de Sermon ou
d'Homelie. Selon 'Tournefort l'ufage des Sermons eft comme aboli, jufqueslà
qu'on ne voit prelque pas de chaire de Prédicateur dans les Eglifes. Si
quelque Papas fe mêle de prêcher, il s'en acquitte très-mal. On paye deux
écus un Sermon qui ne les vaut pas. C'eft un riffu de paroles mal arrangées,
qui n'eft entendu, dit-il, ni du Prédicateur, ni du peuple.
Detaillerai-je ici la fituation qu'ils oblèrvent dans leurs prieres & les marques
extérieures de leur dévotion ? Il faut en parler. Qiioi que les efprits forts &
les gens du monde traitent ces ufagcs de minuties, le peuple en fait cas, & les
dévots s'y occupent. Dans la priere les Grecs fè tournent vers (h) l'Orient ;
ils prient debout, mais ils peuvent audi s'appuyer, & peuvent même s'afléoir.
Les Laïques s'afleyent pendant que le Prêtre fait l'inftruîlion, ils fè tiennent debout
quand ou prie Dieu, ou chante des hymnes. Ainfi le dit un {c) Grec
moderne. Après avoir pris fà place, on fè décotivre la tête , on fait le figne
de la Croix. La maniéré des Grecs eft de joindre d'abord les trois premiers
doigts de la main droite, par où l'on fignifie que la Divinité eft en trois perfonnes.
Le Grec conduit ces trois doigts du front au defibus de la poitrine,&
enfuite de l'épaule droite à l'épaule gauche ; ce qui n'eft pas moins myfl:erieux.
Dans cette figure de la Croix les trois doigts conduits au front nous apprennent
que la Trinité habite aux Cieux. Conduits au deffous de la poitrine, ils nous
montrent tout d'un coup quatre grans myfl:eres, l'incarnation, le crucifiement,
la fèpulture, la defcente de Jefus Chrift aux enfers. Ces trois doigts appliqués
à l'épaule droite nous marquent que Jefus Chrift relTafcité s'eft alTis à la droite
de Dieu. Enfin l'épaule gauche étant un type de la reprobation des méchans,
par le mouvement des trois doigts vers l'épaule gauche le Grec demande à Dieu
mon.
tuations ordonnées aux Fidelles dans leurs devotions, je fournirois un ample
recueil d'allcgories également ingenieufes, & inutiles, amenées de fort loin &
tout à fait inconnues aux fondateurs du Chriftianidne. Par exemple on oferoit
bien aflurer qu'ils n'ont jamais f û , qu'être debout aux devotions du Dimanche
de Pâques fignifie que la Refurredion de Jefus Chrift nous a relevé
de nos péchés. Il felloic (d) un Patriarche de Conllantinople
nyftere.
: pour reveler
Le
(a) Autrefois dans le tems de la cclcbration des Myfteres un Diâcrè<rioit l l'alTemblée, chacipt
renonce aux inimitiés.
(è) Ils portent cet ufage jufqu'à la fuperftition, jufques là mêmes que fe trouvant entre l'Eglife Si
l'Orient, ils tourneront plutôt le dos à l ' E g l i f e qu'à l'Orient. &c. ceci eft une citation du Rituel du P.
Goar, connu fous le nom d'Euchologe. On attribue l'origine de cette fuperftition aux Prifcillianiftes, H e -
retiques du quatrième fiecle, qui croyoient à l'Aftrologie judiciaire & à l'influence des aftres fur notre
monde. On pretend que Prifcillien & fes Seâateurs établirent la coutume de prier en fe tournant à l ' O -
rient , comme pour demander l'alTiftance du foleil contre les mauvaifes influences des autres étoiles,
(c) Chrijiophor. ^n^elus Cap. z i . SmtHs Gracdr.
(.d) Gcrmanifs in Theoria Rtram Ecclcf. cité par * »
Tome m . Part. 1. Y