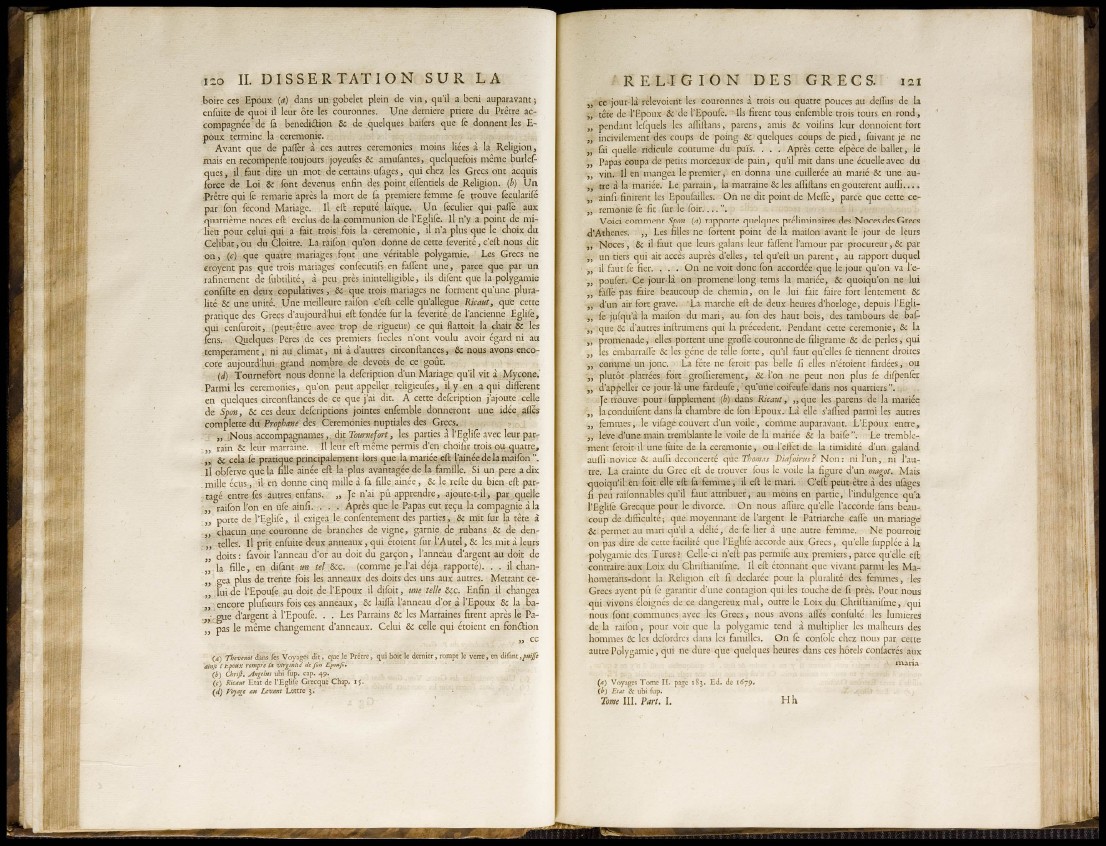
no II. D I S S E R T A T I O N SUR LA
boirc ces Epoux (a) dans un gobelet plein de vin, qu'il a bcni auparavant ;
enfuite de quoi il leur ôte les couronnes. Une dernicre priere du Prêtre accompagnée
de (à benediaion Se de quelques baifers que fe donnent les Epoux
termine la cerenionie.
Avant que de paflèr à ces autres ceremonies moins lices à la Religion,
mais en recompenfe toujours joyeufes 6c amufantes, quelquefois même burlefques,
il faut dire un mot de certains ufagcs, qui chez les Grecs ont acquis
force de Loi & font devenus enfin des point elTentiels de Religion. (S) Un
Prêtre qui le remarie après la mort de là premiere femme fe trouve fccularifc
par fon fécond Mariage. Il ell réputé laïque. Un feculier qui palfc aux
quatrième noces eft exclus de la communion de l'Eglifc. Il n'y a point de milieu
pour celui qui a fait trois fois la ceremonie, il n'a plus que le choix du
Célibat, ou du Cloitre. La raifon qu'on donne de cette feverité, c'efl; nous die
o n , (c) que quatre mariages font une véritable polygamie. Les Grecs ne
croyant pas que trois mariages confecutifs en faffent une, parce que par un
rafinement de fubtilité, à peu près inintelligible, ils difcnt qite la polygamie
confifte en deux copulatives, Se que trois mariages ne forment qu'une pluralité
Se une unité. Une meilleure raifon c'eft celle qu'allégué Ricaut, que cette
pratique des Grecs d'aujourd'hui efl: fondée fur la feverité de l'ancienne Eglife,
tmi cenfuroit, (peut être avec trop de rigueur) ce qui flattoit la chair Se les
fens. Quelques Peres de ces premiers fiecles n'ont voulu avoir égard ni au
temperament, ni au climat, ni à d'airtres circonlhnces, &; nous avons encocore
aujourd'hui grand nombre de dévots de ce goiit.
(et) Tournefort nous donne la defcription d'un Mariage qu'il vit à Mycone.
Parmi les ceremonies, qu'on peut appeller religieufes, il y en a qui different
en quelques circonftances de ce que j'ai dit. A cette defcription j'ajoute celle
de Spon, & ces deux defcriptions jointes enfemble donneront une idée ailés
complette du Prophane des Ceremonies nuptiales des Grecs.
„ Nous accompagnames,. dit roarae/ort, les parties à l'Eglife avec leur par-
„ rain & leur marraine. Il leur efl: même permis d'en choifir trois ou quatre,
„ & cela le pratique principalement lors que la mariée eft l'aînée de la maifon".
Il obferve que la frlle ainée eft la plus avantagée de la famille. Si un pere a dix
mille écus, il en donne cinq mille à fa fille ainée, & le refte du bien eft partagé
entre fes autres enfans. „ Je n'ai pû apprendre, ajoure-t-il, par quelle
raifon l'on en ufe ainfi. . . . Après que le Papas eut reçu la compagnie à la
„ porte de l'Eglife, il exigea le confentcment des parties, & mit fur la tête à
„ chacun une couronne de branches de vigne, garnie de rubans Se de den-
„ telles. Il prit enfuite deux anneaux, qui étoient fur l'Autel, & les mit à leurs
doits : favoir l'anneau d'or au doit du garçon, l'anneau d'argent au doit de
, la fille, en difant un tel &c. (comme je.l'ai déjà rapporté). . . il chan-
„ gea plus de trente fois les anneaux des doits des uns aux autres. Mettant ce-
„ lui de l'Epoufe au doit de l'Epoux il difoit, une telle &c. Enfin il changea
„ encore plufieurs fois ces anneaux, Se Kiiffa l'anneau d'or a l'Epoux Se la ba-
.„• gue d'argent à l'Epoulè. . . Les Parrains & les Marraines firent après le Pa-
„ pas le même changement d'anneaux. Celui Se celle qui étoient en fonélion
„ ce
(a) rhevenot dans fes Voyages d i t , cjuc le Prêtre, qui boit !e dernier, rompt le verre, en difant
ithtft i'Epmx rompre il virginité di fa» Epoufe.
(l>) CljriJÎ. ^»gtitts ubi fup. cap. 49.
(c) RkaM Etat de l'Egliie Grecque Chap. JJ.
{d) ^rt^ff »1« Livitut Lettre 3.
R E L I G I O N DES GRECS. 121
„ ce jour- là relevoicnt les couronnes à trois ou quatre pouces au delTiis de la
„ tête de l'Epoux de l'Epoule. lis firent cous enfemble trois tours en rond,
,, pendant le(quels les alîHlans, parens, amis ôc voifins leur donnoient fore
„ incivilcment des coups de poing èc quelques coups de pied, fuivant je ne
j, {ài quelle ridicule coutume du païs. . . . Après cette eipèce de ballet, le
„ Papas coupa de petits morceaux de pain, qu'il mit dans une écuelleavec du
„ vin. Il en mangea le premier, en donna une cuillerée au marié & une au-
„ tre à la mariée. Le parram, la marraine & les aflilbns en gouterenc a u l l i . . ..
„ ainfi finirent les Epoufàilles. On ne dit point de Meflè, parce que cette ceremonie
le fit fur le f o i r . . . . ".
Voici comment Spo7i (a) rapporte quelques préliminaires des Noces des Grecs
d'Athènes. ,, Les filles ne fortenc point de la mailon avant le jour de leurs
,, Noces, & il fiiut que leurs galans leur fàflènt l'amour par procureur, & par
,, un tiers qui ait accès auprès d'elles, tel qu'ell un parent, au rapport duquel
„ il faut (è fier. . . . On ne voit donc (on accordée que le jour qu'on va l'e-
5, poufer. Ce jour-là on promene long tems la mariée, & quoiqu'on ne lui
„ fifTe pas faire beaucoup de chemin, on le lui fiiit Êiire fort lentement &
„ d'un air fort grave. La marche eil de deux heures d'horloge, depuis l'Egli-
,, fe ju^qu'à la maifon du mari, au Ion des haut bois, des tambours de baf-
,, que & d'autres inlh'umens qui la précèdent. Pendant cette ceremonie, &: la
, , promenade, elles portent une groflé couronne de fîligrame 6c de perles, qui
,, les embarrafle & les géne de telle forte, qu'il faut qu'elles Ce tiennent droites
„ comme un jonc. La fête ne {èroit pas belle G elles n'étoient fardées, ou
„ plutôt plâtrées fort grolTierement, & l'on ne peut non plus fe di^penfer
3, d'appeller ce jour-là une fardeu{ê, qu'une coifeufe dans nos quartiers".
Te trouve pour fupplement {b) dans Ricauî, „ que les parens de la mariée
laconduifent dans la chambre de (on Epoux. Là elle s'aflîed parmi les autres
„ femmes, le vifage couvert d'un voile, comme auparavant. L'Epoux entre,
„ leve d'une main tremblante le voile de la mariée & la baife Le tremblement
feroit-il une fuite de la ceranonie, o u i ' e t i e t d e la timidité d'un galand
aullî novice aullî dcconcerté que Thomas Viafoirus? Non; ni l'un, ni l'autre.
La crainte du Grec eil de trouver lôus le voile la figure d'un magot. Mais
tjuoiqu'il en foit elle eft: (à femme, il eft le mari. C'eft peut-être à des ufàges
fi peu raifonnables qu'il faut attribuer, au moins en partie, l'indulgence qu'a
l'Eglife Grecque pour le divorce. On nous afitire qu'elle l'accorde lans beaucoup
de difficulté; que moyennant de l'argent le Patriarche caffe un mariage
permet au mari qu'il a délié, de fe lier à une autre femme. Ne pourroic
on pas dire de cette i-acilité que l'Eglife accorde aux Grecs, qu'elle fuppléeà la
polygamie des Turcs? Celle-ci n'elt pas permife aux premiers,parce qu'elle eil
contraire aux Loix du Chnilianifme. Il ell étonnant que vivant parmi les Mahometans
dont la Religion eft fî declarée pour la pluralité des femmes, les
Grecs ayent pu (ê garantir d'une contagion qui les touche de fî près. Pour nous
qui vivons éloignés de ce dangereux mal, outre le Loix du ChriilianifÎTie, qui
nous font communes avec les Grecs, nous avons aflés coniulté les lumieres
de la raifon, pour voir que la polygamie tend à multiplier les malheurs des
hommes les delbrdres dans les familles. On fê confoli; chez nous par cette
autre Polygamie, qui ne dure que quelques heures dans ces hôtels confàcrés aux
maria-
(>«) Voyages Tome IT. page 183. Ed. de i i J y j.
ib) Etat & iibi fup.
Tome IIL Part. L H h