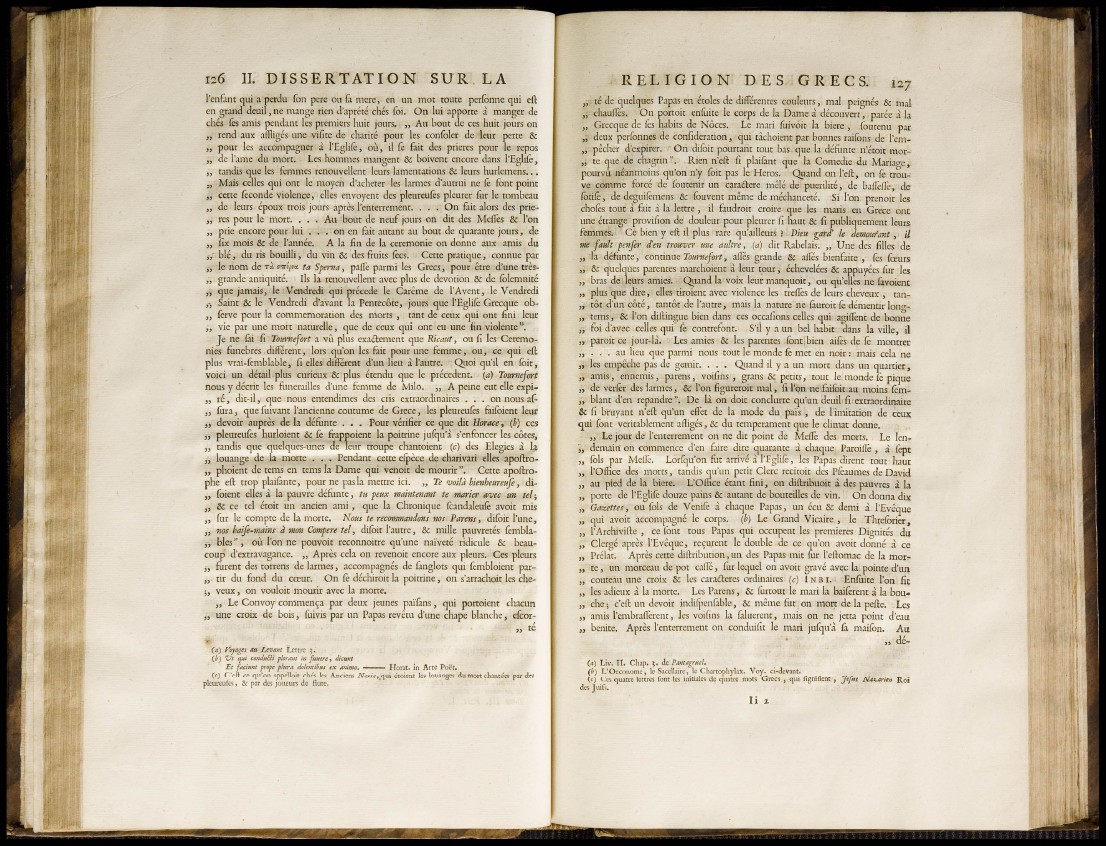
t i « t . J
126 II. D I S S E R T A T I O N SUR LA
I'en&nt qiii a perdu foil pcre 011 fa mere, en un mot route perfcnne qui eft
en grand deuil, ne mange rien d'aprété ches foi. On lui apporte à manger de
chés fes amis pendant les premiers huit jours. „ Au bout de ces huit jours on
„ rend aux affliges une vifite de charité pour les confolcr de leur perte &
„ pour les accompagner à l'Eglifè, où, il fe Elit des prieres pour le repos
„ de lame du mort. Les hommes mangent & boivent encore dans l'Eglifè,
3, tandis que les femmes renouvellent leurs lamentations & leurs hurlemens...
j, Mais celles qui ont le moyen d'acheter les larmes dautrui ne fe font point
„ cette fécondé violence, elles envoyent des pleureufes pleurer fur le tombeau
3, de leurs époux trois jours après l'enterrement. . . . On fait alors des prie-
3, res pour le mort, . . . Au bout de neuf jours on dit des Melles & l'on
„ prie encore pour lui . . . on en fait autant au bout de quarante jours, de
3, Îîx mois & de l'année. A la fin de la ceremonie on donne aux amis du
3, blé, du ris bouilli, du vin & des fruits fècs. Cette pratique, connue par
j, le nom de raff^lpy«. ta Sperna, pafle parmi les Grecs, pour ctre d'une très-
„ grande antiquité. Us la renouvellent avec plus de devotion & de folemnité
que jamais, le Vendredi qui precede le Carême de l'Avent, le Vendredi
Saint & le Vendredi d'avant la Pentecôte, jours que l'Eglile Grecque obferve
pour la commemoration des morts , tant de ceux qui ont fini leur
, , vie par une mort naturelle, que de ceux qui ont eu une fin violente".
J e ne (ai fi Toumefort a vû plus exactement que Ricauty ou fi les Ceremonies
fîinebres différent, lors qu'on les fiîit pour une femme, ou, ce qui eft
plus vrai-femblable, fi elles différent d'un lieu à l'autre. Qiioi qu'il en foie,
voici un détail plus curieux & plus étendu que le precedent, {a) Toumefort
nous y décrit les funérailles d'une femme de Milo. ,, A peine eut elle expi-
3, ré, dit-il, que nous entendîmes des cris extraordinaires . . . on nous af-
3, fura, quefuivant l'ancienne coutume de Grece, les pleureulès feifoient leur
5, devoir auprès de la défunte . . . Pour vérifier ce que dit Horace, (h) ces
„ pleureufes hurloient & fe fiappoienc la poitrine jufqu'à s'enfoncer les cotes',
3, tandis que quelques-unes de leur troupe chantoient (c) des Elegies à la
3, louange de la morte . . . Pendant cette elpèce de charivari elles apoftro-
, , phoient de tems en tems la Dame qui venoit de mourir ". Cette apoflrophe
eft trop plailânte, pour ne pas la mettre ici. ,, Te 'voilâ hienheareufe, di-
5, f o i e n c elles à la p a u v r e d é f i i n t e , îu peux maintefiant te marier a^vec m tel-,
„ & ce tel ctoit un ancien a m i , que la Chronique Icandaleufè avoit mis
„ (lir le compte de la morte. Hous te recommandons nos Parens, difoit l'une,
„ nos baife-mams à mofi Compere tel, dilbit l'autre, & mille pauvretés fembla-
„ bles", où l'on ne pouvoir reconnoitre qu'une naïveté ridicule & beaucoup
d'extravagance. „ Après cela on revenoit encore aux pleurs. Ces pleurs
„ furent des torrens de larmes, accompagnes de fânglots qui fembloient parj,
tir du fond du coeur. On fè déchiroit la poitrine, on s'arrachoit les chej,
veux, on vouloit mourir avec la morte.
„ Le Convoy commença par deux jeunes paifàns, qui portoient chacun
„ une croix de bois, fuivis par un Papas revécu d'une chape blanche, cicor-
(a) Forages a» Levant Lettre 5.
ib) Vt ^ui conduÜi ploraut in funtre., Jicunt
Et faciHHt prope pliira dolcwibHs ex ammo. Horat. in Arte Poct.
{c) C'crt ce qu'on appelloit chés les Anciens ctoienc les louanges du mort chantées par des
pkui-eufes, par des joueurs de flute.
R E L I G I O N DES GRECS. 127
„ té de quelques Papas en étoles de difFércntes couleurs, mal peignes & mal
„ cliaulfés. On portoit enfuite le corps de la Dame à découvert, parée à l.i
„ Grecque de fa habits de Nôces. Le mari fuivoit la biere , foutenu par
„ deux perfonnes de confideration, qui t.îchoient par bonnes raifons de l'em-
„ pêcher d'expirer. On difoit pourtant tout b.ns que la défunte netoit mor-
„ te que de chagrin ". Rien n'eft fl pl,li(ànt que la Comedie du Mariage,
pourvu néanmoins qu'on n'y foit pas le Héros. Quand on l'eft, on fe trouve
comme force de foutenir un caradlere mêlé de puérilité, de baflèflè, de
fotifc, de deguifemeus & fouvent même de méchanceté. Si l'on prenoit les
choies tout à fait .à la lettre , il faudroit croire que les maris en Grece ont
une étrange provifjon de douleur pour pleurer fi haut & fi publiquement leurs
femmes. Ce bien y eft il plus rare qu'ailleurs ? Dieu gavd' k dermurant, il
me fault pmfer d'en trouver me aultre, [a) dit R a b e l a i s . „ U n e des filles de
„ la défunte, continue Toumefort, affés grande & aflés bien&ite , fes fcurs
„ & quelques parentes marchoient à leur tour, échevelces &c appuyées fur les
,, bras de leurs amies. Quand la voix leur manquoit, ou qu'elles ne lâvoient
„ plus que dire, elles tiroient avec violence les treflès de leurs cheveux , tan-
„ tôt d'un côté, tantôt de l'autre, mais la nature ne fâuroit fe démentir long-
„ tems, & l'on diftingue bien dans ces occaiions celles qui agiflènt de bonne
„ foi d'avec celles qui fe contrefont. S'il y a un bel habit dans la ville, il
„ paroit ce jour-là. Les amies &: les parentes {bnt:bien aifes de fe montrer
, , . . . au lieu que parmi nous tout le monde (è met en noir : mais cela ne
„ les empêche pas de gémir. . . . Q_uand il y a un mort dans un quartier,
„ amis, ennemis, parens, voifins , grans & petits, tout le monde le pique
„ de verier des larmes, l'on figureroit mal, li l'on ne faifoit au moins fèm-
„ blant d'en repandre ". De là on doit conclurre qtr'un deuil fi extraordinaire
&c Cl bruyant n'eft qu'un effet de la mode du pais , de l'imitation de ceux
qui font véritablement afligés, de du temperament que le climat donne.
„ Le jour de l'enterrement on ne dit point de Mefiê des morts. Le len-
'„ demain on commence d'en faire dire quarante à chaque Paroiflè , à lëpt
3, fols par Melll\ Lorfqu'on fut arrive à I'Fglifc, les P.apas dirent tout haut
„ l'Office des morts, tandis qu'un petit Clerc reciroit des Pièaumes de David
„ au pied de la biere. L'Office étant fini, on diftribuoir à des pauvres à la
„ porte de l'Eglilê douze pains &: autant de bouteilles de vin. On donna dix
„ Gazettes, ou fols de 'Venife à chaque Papas, un écu & demi à l'Evêque
„ qui avoit accompagné le corps, (h) Le Grand Vicaire , le Threforier,
„ l'Archivifte , ce font tous Pap.is qui occupent les premieres Dignités du
„ Clergé après l'Evêque, reçurent le double de ce qu'on avoit donné à ce
3, PréLit. Après cette diilribution, un des Papas mit lut l'eftomac de la mor-
„ te, un morcc.au de pot cafte, for lequel on avoit gr.avé avec la pointe d'un
„ couteau une croix ô c les car.i£teres ordinaires (c) I n b i . Enfuite l'on fie
„ les adieux à la morte. Les Parens, Se furtout le mari la bailêrent à la bou-
„ che ; c'eft un devoir indifpenfable, Se même fut on mort de la pefte. Les
„ amis l'embraftèrent, les voifins la faluerent, mais on ne jetta point d'eau
„ benite. Après l'enterrement on conduifit le mari jufqu'à fâ m.iifon. Au
„ dé-
(4) Liv. î ï . Cliap. î . de PMtagrue!.
(l>) L'Oeconome, le Saccllaire, le Cliartopliykx. Voy. ci-devant.
(c) Ces quatre lettres font les initiales de quatre mots Grecs , qni figuifient , Jefm l^A^ttrm Roi
des Jnifs.
l i i
* L
^ il