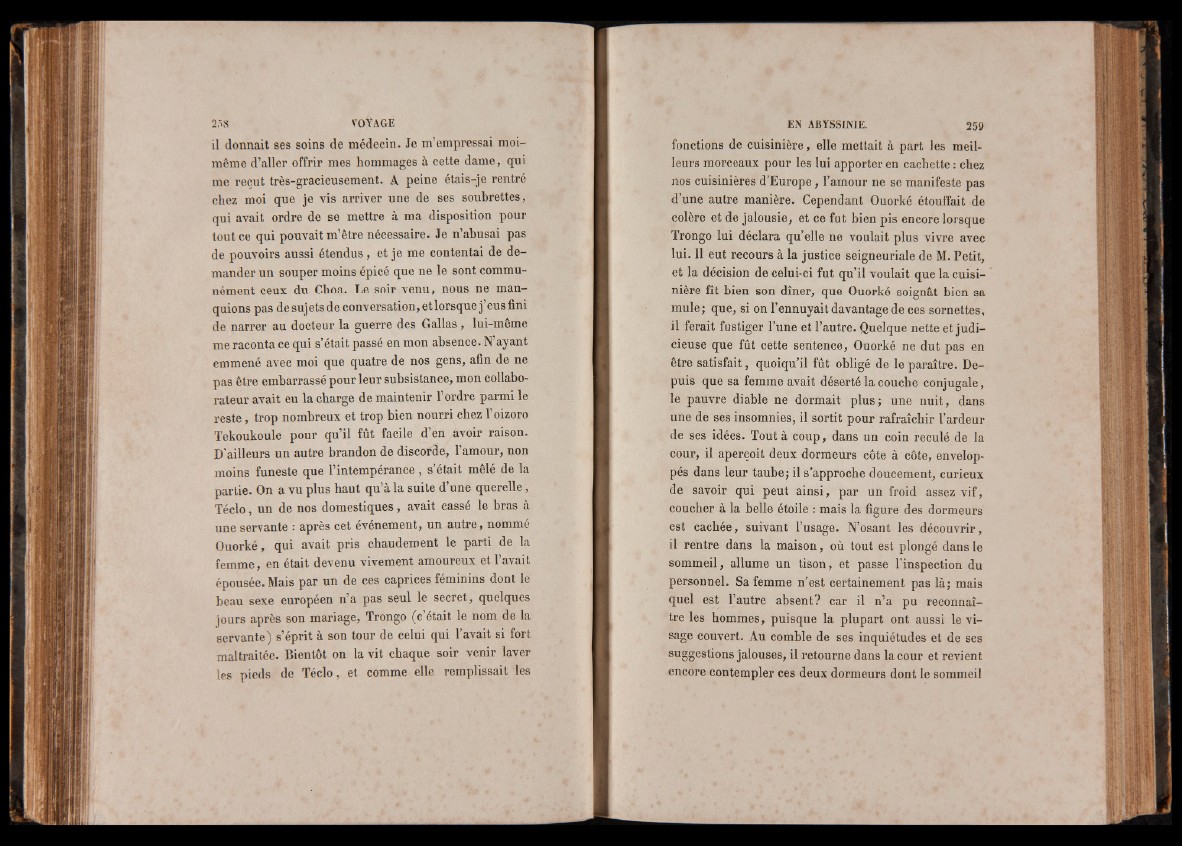
il donnait ses soins de médecin. Je m’empressai moi-
même d’aller offrir mes hommages à cette dame, qui
me reçut très-gracieusement. A peine étais-je rentré
chez moi que je vis arriver une de ses soubrettes,
qui avait ordre de se mettre à ma disposition pour
tout ce qui pouvait m’être nécessaire. Je n’abusai pas
de pouvoirs aussi éten dus, et je me contentai de demander
un souper moins épicé que ne le sont communément
ceux du Choa. Le soir venu, nous ne manquions
pas desujets de conversation, etlorsque j’eus fini
de narrer au docteur la guerre des Gallas, lui-même
me raconta ce qui s’était passé en mon absence. N’ayant
emmené avec moi que quatre de nos gens, afin de ne
pas être embarrassé pour leur subsistance, mon collaborateur
avait eu la charge de maintenir l’ordre parmi le
r e ste , trop nombreux et trop bien nourri chez l’oizoro
Tekoukoule pour qu’il fût facile d’en avoir raison.
D’ailleurs un autre brandon de discoïde, l’amour, non
moins funeste que l’intempérance, s’était mêlé de la
partie. On a vu plus haut qu’à la suite d’une querelle,
Téclo, un de nos domestiques, avait cassé le bras à
une servante : après cet événement, un autre, nommé
Ouorké, qui avait pris chaudement le parti de la
femme, en était devenu vivement amoureux et 1 avait
épousée. Mais par un de ces caprices féminins dont le
beau sexe européen n’a pas seul le secret, quelques
jours après son mariage, Trongo (c’était le nom de la
servante) s’éprit à son tour de celui qui l ’avait si fort
maltraitée. Bientôt on la vit chaque soir venir laver
les pieds de Téclo, et comme elle remplissait les
fonctions de cuisinière, elle mettait à part les meilleurs
morceaux pour les lui apporter en cachette : chez
nos cuisinières d’Europe, l’amour ne se manifeste pas
d’une autre manière. Cependant Ouorké étouffait de
colère et de jalousie, et ce fut bien pis encore lorsque
Trongo lui déclara qu’elle ne voulait plus vivre avec
lui. Il eut recours à la justice seigneuriale de M. Petit,
et la décision de celui-ci fut qu’il voulait que la cuisinière
fît bien son dîner, que Ouorké soignât bien sa
mule; que, si on l ’ennuyait davantage de ces sornettes,
il ferait fustiger l ’une et l’autre. Quelque nette et judicieuse
que fût cette sentence, Ouorké ne dut pas en
être satisfait, quoiqu’il fût obligé de le paraître. Depuis
que sa femme avait déserté la couche conjugale,
le pauvre diable ne dormait plus; une n u it, dans
une de ses insomnies, il sortit pour rafraîchir l ’ardeur
de ses idées. Tout à coup, dans un coin reculé de la
cour, il aperçoit deux dormeurs côte à côte, enveloppés
dans leur taube; il s ’approche doucement, curieux
de savoir qui peut a in si, par un froid assez v if,
coucher à la belle étoile : mais la figure des dormeurs
est cachée, suivant l’usage. N’osant les découvrir,
il rentre dans la maison, où tout est plongé dans le
sommeil, allume un tison, et passe l’inspection du
personnel. Sa femme n’est certainement pas là; mais
quel est l’autre absent? car il n’a pu reconnaître
les hommes, puisque la plupart ont aussi le visage
couvert. Au comble de ses inquiétudes et de ses
suggestions jalouses, il retourne dans la cour et revient
encore contempler ces deux dormeurs dont le sommeil