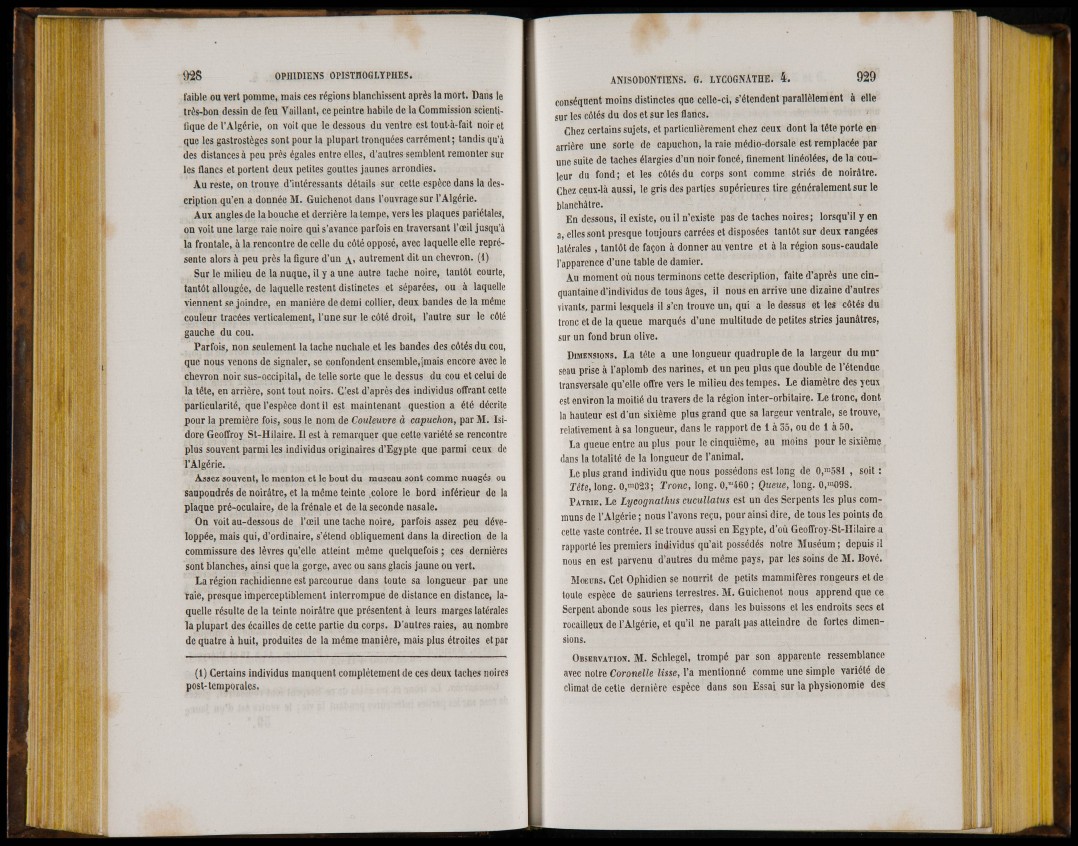
1)28 OPHIDIENS OPISTHOGLYPHES.
faible ou vert pomme, mais ces régions blanchissent après la mor t . Dans le
très-bon dessin de feu Vaillant, ce peintre habile de la Commission scientilique
de l'Algérie, on voit que le dessous du ventre est tout à-fait noir et
que les gastrostèges sont pour la plupart tronquées carrément; tandis qu'à
des distances à peu près égales enlre elles, d'autres semblent remonter sur
les flancs et portent deux petites gouttes jaunes arrondies.
A.U reste, on trouve d'intéressants détails sur cette espèce dans la description
qu'en a donnée M. Guichenot dans l'ouvrage sur l'Algérie.
Aux angles de la bouche et derrière la tempe, vers les plaques pariétales,
on voit une large raie noire qui s'avance parfois en traversant l'oeil jusqu'à
la frontale, à la rencontre de celle du côté opposé, avec laquelle elle représente
alors à peu près la figure d'un a . autrement dit un chevron. (1)
Sur le milieu de la nuque, il y a une autre tache noire, tantôt courte,
tantôt allougée, de laquelle restent distinctes et séparées, ou à laquelle
viennent se joindre, en manière de demi collier, deux bandes de la même
couleur tracées verticalement, l'une sur le côté droit, l'autre sur le côté
gauche du cou.
Parfois, non seulement la tache nuohale et les bandes des côtés d u cou,
que nous venons de signaler, se confondent ensemble,¡mais encore avec le
chevron noir sus-occipital, de telle sorte que le dessus du cou et celui de
la tête, en arrière, sont tout noirs. C'est d'après des individus offrant cette
particularité, que l'espèce dont il est maintenant question a été décrite
pour la première fois, sous le nom de Couleuvre à capuchon, par M. Isidore
Geoffroy St-Hilaire. Il est à remarquer que cette variété se rencontre
plus souvent parmi les individus originaires d'Egypte que parmi ceux de
l'Algérie.
Assez souvent, le menton et le bout du museau sont comme nuagés ou
saupoudrés de noirâtre, et la même teinte .colore le bord inférieur de la
plaque pré-oculaire, de la frênaie et de la seconde nasale.
On voit au-dessous de l'oeil une tache noire, parfois assez peu développée,
mais qui, d'ordinaire, s'étend obliquement dans la direction de la
commissure des lèvres qu'elle atteint même quelquefois ; ces dernières
sont blanches, ainsi que la gorge, avec ou sans glacis jaune ou vert.
La région rachidienne est parcourue dans toute sa longueur par une
raie, presque imperceptiblement interrompue de distance en distance, laquelle
résulte de la teinte noirâtre que présentent à leurs marges latérales
l a plupart des écailles de cette partie du corps. D'autres raies, au nombre
de quatre à huit, produites de la même manière, mais plus étroites et par
(1) Certains individus manquent complètement de ces deux taches noires
post- temporales.
ANISODONTIENS, G. LYCOGNATHE. 4. 92 9
conséquent moins distinctes que celle-ci, s'étendent parallèlement à elle
sur les côtés du dos et sur les flancs.
Chez certains sujets, et particulièrement chez ceux dont la tête porte en
arrière une sorte de capuchon, la raie médio-dorsale est remplacée par
une suite de taches élargies d'un noir foncé, finement linéolées, de la couleur
du fond; et les côtés du corps sont comme striés de noirâtre.
Chez ceux-là aussi, le gris des parties supérieures tire généralement sur le
blanchâtre.
En dessous, il existe, ou il n'existe pas de taches noires; lorsqu'il y en
a, elles sont presque toujours carrées et disposées tantôt sur deux rangées
latérales , tantôt de façon à donner au ventre et à la région sous-caudale
l'apparence d'une table de damier.
Au moment où nous terminons cette description, faite d'après une cinquantaine
d'individus de tous âges, il nous en arrive une dizaine d'autres
vivants, parmi lesquels il s'en trouve un, qui a le dessus et les côtés du
tronc et de la queue marqués d'une multitude de petites stries jaunâtres,
sur un fond brun olive.
DIMENSIONS. La tôle a une longueur quadruple de la largeur du mn"
seau prise à l'aplomb des narines, et un peu plus que double de l'étendue
transversale qu'elle offre vers le milieu des tempes. Le diamètre des yeux
est environ la moitié du travers de la région inter-orbitaire. Le tronc, dont
la hauteur est d'un sixième plus grand que sa largeur ventrale, se trouve,
relativement à sa longueur, dans le rapport de 1 à 35, ou de 1 à 50.
La queue entre au plus pour le cinquième, au moins pour le sixième
dans la totalité de la longueur de l'animal.
Le plus grand individu que nous possédons est long de 0,m581 , soit :
Tête, long. 0,™023; Tronc, long. 0,"460 ; Queue, long. 0,™098.
PATRIE. Le Lycognathus cucullatus est un des Serpents les plus communs
de l'Algérie ; nous l'avons reçu, pour ainsi dire, de tous les points de
celte vaste contrée. Il se trouve aussi en Egypte, d'où Geofl'roy-St-Hilaire a
r a p p o r t é les premiers individus qu'ait possédés notre Muséum; depuis il
nous en est parvenu d'autres du même pays, par les soins de M. Bové.
MOEDBS. Cet Ophidien se nourrit de petits mammifères rongeurs et de
toule espèce de sauriens terrestres. M. Guichenot nous apprend que ce
Serpent abonde sous les pierres, dans les buissons et les endroits secs et
rocailleux de l'Algérie, et qu'il ne parait pas at teindre de fortes dimensions.
OBSERVATION. M. Schlegel, trompé par son apparente ressemblance
avec notre Coronelle lisse, l'a mentionné comme une simple variété de
climat de cette dernière espèce dans son Essai sur la physionomie des
l i