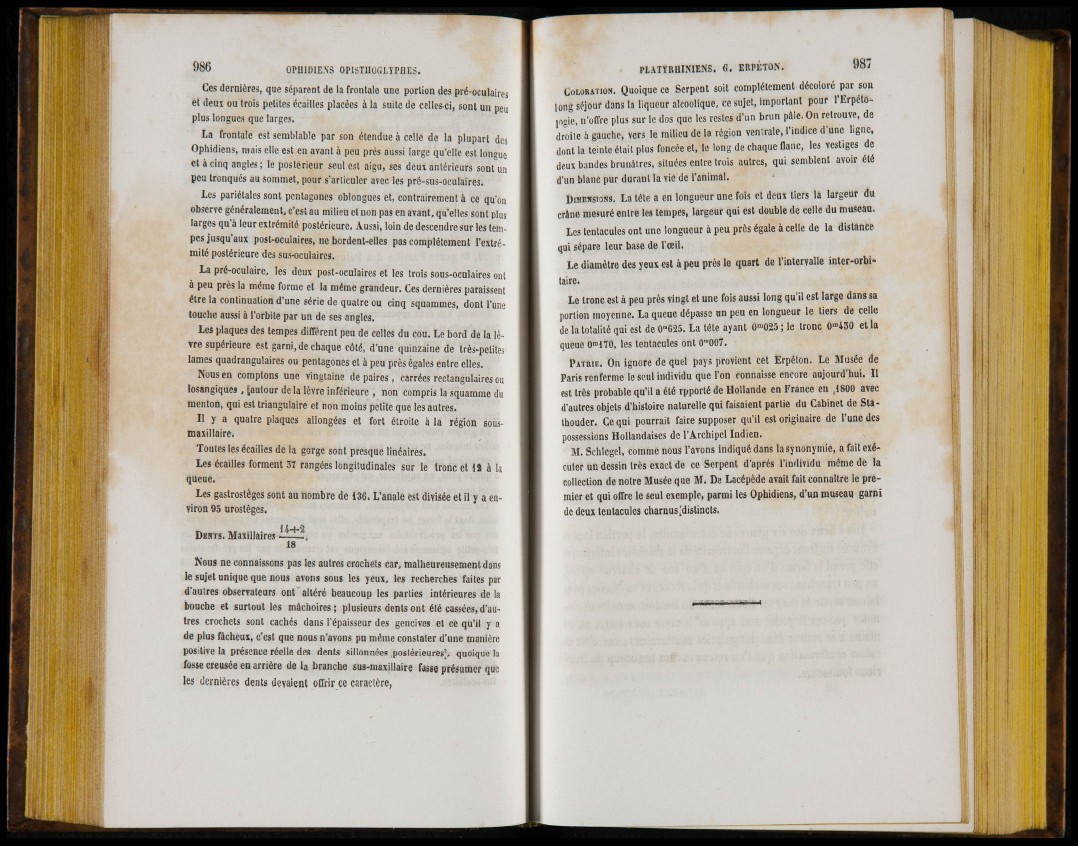
i.(l! i Ij-I "I
î
' I .1
•h,
• V li
|', î1l it 4= :
i
'. •i 1 J it . ' :
:i l
i ijl ' .
i' j!':!
M'î
. i:il„;
iPiM' ''M
9B6 OPHIDIENS OPISTIIOGLYPHES.
Ces dernières, que séparent de la frontale une portion des pré-oculaires
et deux ou trois petites écailles placées à la suite de celles-ci, sont un peu
plus longues que larges.
La frontale est semblable par son étendue à celle de la plupart des
Ophidiens, mais elle est en avant à peu prés aussi large qu'elle est longue
et à cinq angles ; le postérieur seul est aigu, ses deux antérieurs sont un
pea tronqués au sommet, pour s'articuler avec les pré-sus-oculaires.
Les pariétales sont pentagones oblongues et, contrairement à ce qu'on
observe généralement, c'est au milieu et non pas en avant, qu'elles sont plus
larges qu'à leur extrémité postérieure. Aussi, loin de descendre sur les tempes
jusqu'aux post-oculaires, ne bordent-elles pas complètement l'extrémité
postérieure des sus-oculaires.
La pré-oculaire, les deux post-ocnlaires et les trois sous-oculaires ont
à peu près la même forme et la même grandeur. Ces dernières paraissent
être la continuation d'une série de quatre ou cinq squammes, dont l'une
touche aussi à l'orbite par un de ses angles.
Les plaques des tempes diffèrent peu de celles du cou. Le bord de la lèvre
supérieure est garni, de chaque côté, d'une quinzaine de très-petites
lames quadrangulaires ou pentagones et à peu près égales entre elles.
Nous en comptons une vingtaine de paires, carrées rectangulaires ou
losangiques , [autour de la lèvre inférieure , non compris la squamme du
menton, qui est triangulaire et non moins petite que les autres.
Il y a quatre plaques allongées et fort étroite à la région sousmaxillaire.
Toutes les écailles de la gorge sont presque linéaires.
Les écailles forment 57 rangées longitudinales sur le tronc et 12 à la
queue.
Les gastrostèges sont au nombre de Î36. L'anale est divisée et il y a environ
95 urostèges.
DENTS. Maxillaires
18
Nous ne connaissons pas les autres crochets car, malheureusement dans
le sujet unique que nous avons sous les yeux, les recherches faites par
d'autres observateurs ont'altéré beaucoup les parties intérieures de la
bouche et surtout les mâchoires; plusieurs dents ont été cassées,d'autres
crochets sont cachés dans l'épaisseur des gencives et ce qu'il y a
de plus fâcheux, c'est que nous n'avons pu môme constater d'une manière
positive la présence réelle des dents sillonnées .postérieures], quoique la
fosse creusée en arrière de la branche sus-maxillaire fasse présumer que
les dernières dents devaient offrir ce caraclère,
PLATYRIIIMENS. fl. EBPÉTON. 98 7
COLORATION. Quoique ce Serpent soit complètement décoloré par sou
long séjour dans la liqueur alcoolique, ce sujet, important pour l'Erpétologie,
n'offre plus sur le dos que les restes d'un brun pâle, On retrouve, de
droite à gauche, vers le milieu de la région venlrale, l'indice d'une ligne,
dont la teinte était plus foncée et, le long de chaque nanc, les vestiges de
deux bandes brunâtres, situées entre trois autres, qui semblent avoir été
d'un blanc pur durant la vie de l'animal.
DIMENSIONS. La tête a en longueur une fois et deux tiers la largeur du
crâne mesuré entre les tempes, largeur qui est double de celle du museau.
Les tentacules ont une longueur à peu près égale à celle de la distance
qui sépare leur base de l'oeil.
Le diamètre des yeux est à peu près le quart de l'intervalle inter-orbitaire.
Le tronc est à peu près vingt et une fois aussi long qu'il est large dans sa
portion moyenne. La queue dépasse un peu en longueur le tiers de celle
de la totalité qui est de 0-625. La tête ayant 0"025 ; le tronc 0"=450 et la
queue O-^nO, les tentacules ont 0"'007.
PATRIE. On ignore de quel pays provient cet Erpéton. Le Musée de
P a r i s renferme le seul individu que l'on connaisse encore aujourd'hui. Il
est très probable qu'il a été rpporté de Hollande en France en ,1800 avec
d'autres objets d'histoire naturelle qui faisaient partie du Cabinet de Stathouder.
Ce qui pourrait faire supposer qu'il est originaire de l'une des
possessions Hollandaises de l'Archipel Indien.
M. Schlegel, comme nous l'avons indiqué dans la synonymie, a fait exécuter
un dessin très exact de ce Serpent d'après l'individu môme de la
collection de notre Musée que M. De Lacépède avait fait connaître le premier
et qui offre le seul exemple, parmi les Ophidiens, d'un museau garni
de deux tentacules charnus ¡distincts,