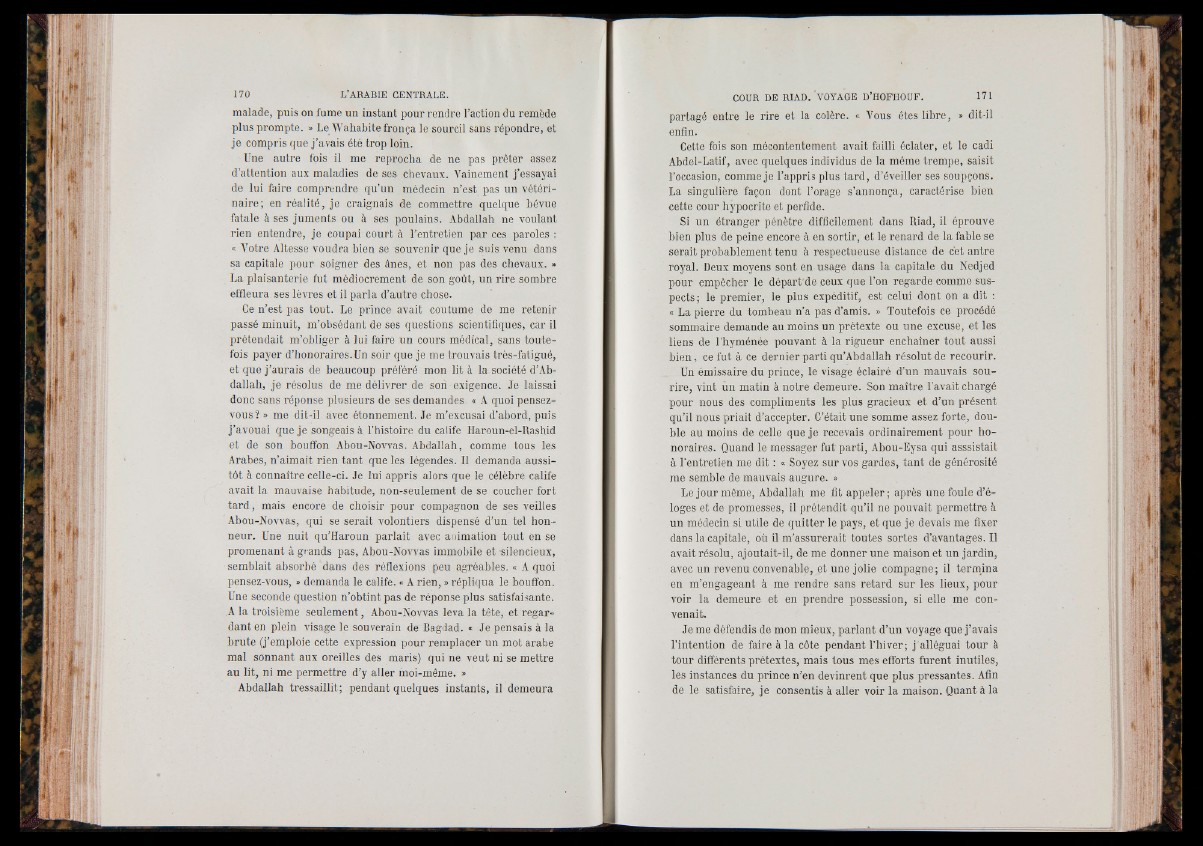
malade, puis on fume un instant pour rendre l’action du remède
plus prompte. » Le Wahabite fronça le sourcil sans répondre, et
je compris que j ’avais été trop loin.
Une autre fois il me reprocha de ne pas prêter assez
d’attention aux maladies de ses chevaux. Vainement j’essayai
de lui faire comprendre qu’un médecin n’est pas un vétérinaire;
en réalité, je craignais de commettre quelque bévue
fatale à ses juments ou à ses poulains. Abdallah ne voulant
rien entendre, je coupai court à l’entretien par ces paroles :
« Votre Altesse voudra bien se souvenir que je suis venu dans
sa capitale pour soigner des ânes, et non pas des chevaux. »
La plaisanterie fut médiocrement de son goût, un rire sombre
effleura ses lèvres et il parla d’autre chose.
Ce n’est pas tout. Le prince avait coutume de me retenir
passé minuit, m’obsédant de ses questions scientifiques, car il
prétendait m’obliger à lui faire un cours médical, sans toutefois
payer d’honoraires.Un soir que je me trouvais très-fatigué,
et que j ’aurais de beaucoup préféré mon lit à la société d’Abdallah,
je résolus de me délivrer de son exigence. Je laissai
donc sans réponse plusieurs de ses demandes. « A quoi pensez-
vous ? » me dit-il avec étonnement. Je m’excusai d’abord, puis
j ’avouai que je songeais à l’histoire du calife Haroun-el-Rashid
et de son bouffon Abou-Nowas. Abdallah, comme tous les
Arabes, n’aimait rien tant que les légendes. Il demanda aussitôt
à connaître celle-ci. Je lui appris alors que le célèbre calife
avait la mauvaise habitude, non-seulement de se coucher fort
tard, mais encore de choisir pour compagnon de ses veilles
Abou-Nowas, qui se serait volontiers dispensé d’un tel honneur.
Une nuit qu’Haroun parlait avec animation tout en se
promenant à grands pas, Abou-Novvas immobile et silencieux,
semblait absorbé dans des réflexions peu agréables. « A quoi
pensez-vous, » demanda le calife. « A rien, » répliqua le bouffon.
Une seconde question n’obtînt pas de réponse plus satisfaisante.
A la troisième seulement, Abou-Novvas leva la tête, et regardant
en plein visage le souverain de Bagdad. « Je pensais à la
brute (j’emploie cette expression pour remplacer un mot arabe
mal sonnant aux oreilles des maris) qui ne veut ni se mettre
au lit, ni me permettre d’y aller moi-même. »
Abdallah tressaillit; pendant quelques instants, il demeura
partagé entre le rire et la colère. « Vous êtes libre, » dit-il
enfin.
Cette fois son mécontentement avait failli éclater, et le cadi
Abdel-Latif, avec quelques individus de la même trempe, saisit
l’occasion, comme je l’appris plus tard, d’éveiller ses soupçons.
La singulière façon dont l’orage s’annonça, caractérise bien
cette cour hypocrite et perfide.
Si un étranger pénètre difficilement dans Riad, il éprouve
bien plus de peine encore à en sortir, et le renard de la fable se
serait probablement tenu à respectueuse distance de cet antre
royal. Deux moyens sont en usage dans la capitale du Nedjed
pour empêcher le départ'de ceux que l’on regarde comme suspects;
le premier, le plus expéditif, est celui dont on a dit :
« La pierre du tombeau n’a pas d’amis. » Toutefois ce procédé
sommaire demande au moins un prétexte ou une excuse, et les
liens de l’hyménée pouvant à la rigueur enchaîner tout aussi
bien, ce fut à ce dernier parti qu’Abdallah résolut de recourir.
Un émissaire du prince, le visage éclairé d’un mauvais sourire,
vint ùn matin à notre demeure. Son maître l’avait chargé
pour nous des compliments les plus gracieux et d’un présent
qu’il nous priait d’accepter. C’était une somme assez forte, double
au moins de celle que je recevais ordinairement pour honoraires.
Quand le messager fut parti, Abou-Eysa qui asssistait
à l’entretien me dit : « Soyez sur vos gardes, tant de générosité
me semble de mauvais augure. »
Le jour même, Abdallah me fit appeler; après une foule d’éloges
et de promesses, il prétendit qu’il ne pouvait permettre à
un médecin si utile de quitter le pays, et que je devais me fixer
dans la capitale, où il m’assurerait toutes sortes d’avantages. Il
avait résolu, ajoutait-il, de me donner une maison et un jardin,
avec un revenu convenable, et une jolie compagne; il termina
en m’engageant à me rendre sans retard sur les lieux, pour
voir la demeure et en prendre possession, si elle me convenait.
Je me défendis de mon mieux, parlant d’un voyage que j’avais
l’intention de faire à la côte pendant l’hiver; j'alléguai tour à
tour différents prétextes, mais tous mes efforts furent inutiles,
les instances du prince n’en devinrent que plus pressantes. Afin
de le satisfaire, je consentis à aller voir la maison. Quant à la