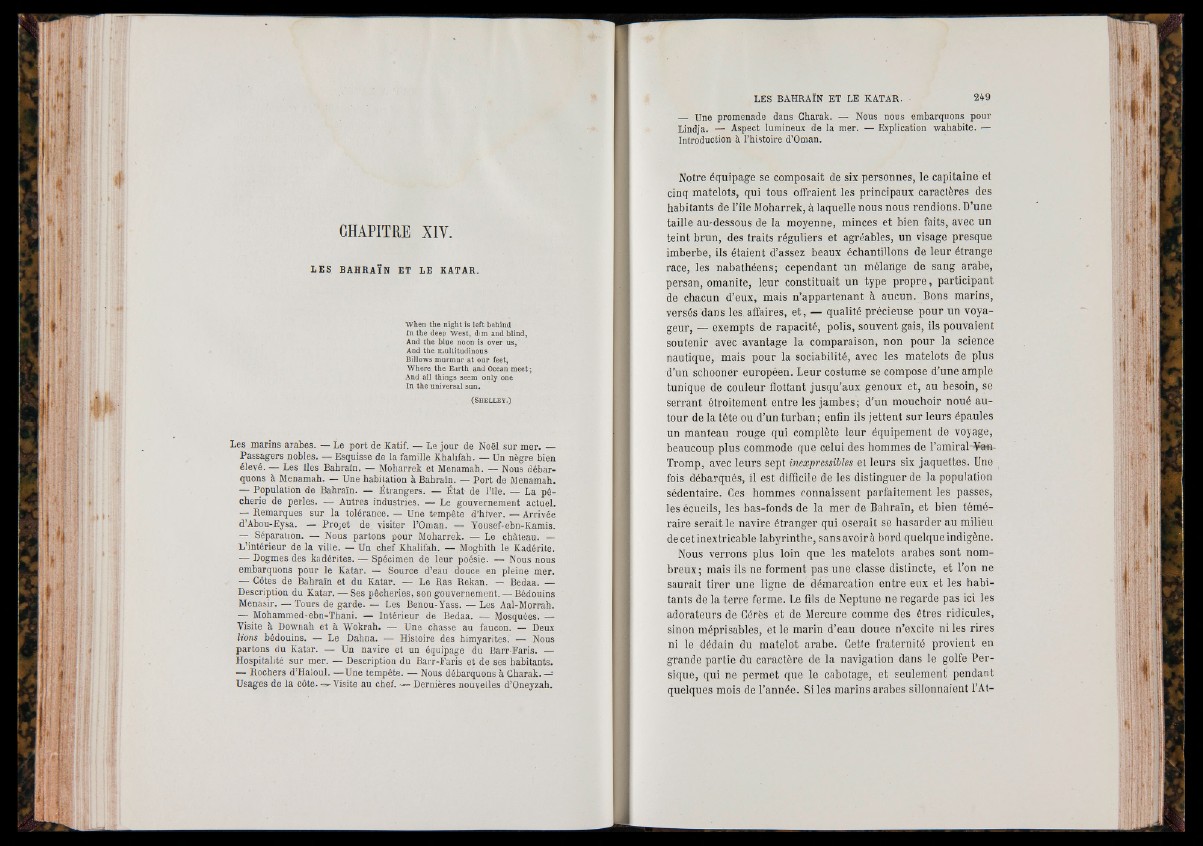
CHAPITRE X1Y.
L ES BAHRAÏN ET LE KATAR.
W h e n th e n ig h t is left b e h in d
I n th e deep W e s t, dim a n d b lin d ,
And th e b in e n o o n is o v er u s ,
And th e m u ltitu d in o u s
Biilows m u rm u r a t o u r feet,
W h e re th e E a r th an d Ocean m e e t ;
And a ll th in g s seem o n ly one
I n th e u n iv e rs a l s u n .
(S h e l l e y .)
Les marins arabes. — Le port de Katif. — Le jour de Noël sur mer. —
Passagers nobles. — Esquisse de la famille Khalifah. — Un nègre bien
élevé.11- Les lies Bahrain. — Moharrek et Menamah. — Nous débarquons
à Menamah. — Une habitation à Bahrain. — Port de Menamah.
— Population de Bahrain. — Étrangers. — État- de l’Ile. — La pêcherie
de perles. — Autres industries. — Le gouvernement actuel.
— Remarques sur la tolérance. — Une tempête d’hiver. — Arrivée
d’Abou-Eysa. — Projet de visiter l’Oman. —• Yousef-ebn-Kamis.
— Séparation, fe - Nous partons pour Moharrek. — Le châte auBB
L’intérieur de la ville. — Un chef Khalifah, — Moghith le Kadérite.
H Dogmes des kadérites. Spécimen de leur poésie. — Nous nous
embarquons pour le Katar. — Source d’eau douce en pleine mer.
— Côtes de Bahrain et du Katar. — Le Ras Rekan. — Bedaa. —
Description du Katar. — Ses pêcheries, son gouvernement.-— Bédouins
Menasir. — Tours de garde. — Les Benou-Yass. — Les Aal-Morrah.
— Mohammed-ebn-Thani. — Intérieur de Bedaa. — Mosquées. —
Visite à Downah et à Wokrah. Une chasse au faucon. — Deux
lions bédouins. — Le Dahna. 5 - Histoire des himyarites. — Nous
partons du Katar. — Un navire et un équipage du Barr-Faris.
Hospitalité sur mer. — Description du Barr-Faris et de ses habitants.
— Rochers d’Haloul. -—Une tempête. — Nous débarquons à Charak. —
Usages de la côte.-^-Visite au chef. — Dernières nouvelles d’Oneyzah.
— Une promenade dans Charak. — Nous nous embarquons pour
Lindja. — Aspect lumineux de la mer. — Explication wahabite. —
Introduction à l’histoire d’Oman.
Notre équipage se composait de six personnes, le capitaine et
cinq matelots, qui tous offraient les principaux caractères des
habitants de l’île Moharrek, à laquelle nous nous rendions. D’une
taille au-dessous de la moyenne, minces et bien faits, avec un
teint brun, des traits réguliers et agréables, un visage presque
imberbe, ils étaient d’assez beaux échantillons de leur étrange
race, les nabathéens; cependant un mélarige de sang arabe,
persan, omanite, leur constituait un type propre, participant
de chacun d’eux, mais n’appartenant à aucun. Bons marins,
versés dans les.affaires, et, — qualité précieuse pour un voyageur,
— exempts de rapacité, polis, souvent gais, ils pouvaient
soutenir avec avantage la comparaison, non pour la science
nautique, mais pour la sociabilité, avec les matelots de plus
d’un schooner européen. Leur costume se compose d’une ample
tunique de couleur flottant jusqu’aux genoux et, au besoin, se
serrant étroitement entre les jambes; d’un mouchoir noué autour
de la téte ou d’un turban; enfin ils jettent sur leurs épaules
un manteau rouge qui complète leur équipement de voyage,
beaucoup plus commode que celui des hommes de l’amiral-¥afL
Tromp, avec leurs sept inexpressibles et leurs six jaquettes. Une
fois débarqués, il est difficile de les distinguer de la population
sédentaire. Ces hommes connaissent parfaitement les passes,
les écueils, les bas-fonds de la mer de Bahraïn, et bien téméraire
serait le navire étranger qui oserait se hasarder au milieu
de cet inextricable labyrinthe, sans avoir à bord quelque indigène.
Nous verrons plus loin que les matelots arabes sont nombreux;
mais ils ne forment pas une classe distincte, et l’on ne
saurait tirer une ligne de démarcation entre eux et les habitants
de la terre ferme. Le fils de Neptune ne regarde pas ici les
adorateurs de Cérès et de Mercure comme des êtres ridicules,
sinon méprisables, et le marin d’eau douce n’excite ni les rires
ni le dédain du matelot arabe. Cette fraternité provient en
grande partie du caractère de la navigation dans le golfe Per-
sique, qui ne permet que le cabotage, et seulement pendant
quelques mois de l’année. Si les marins arabes sillonnaient l’At