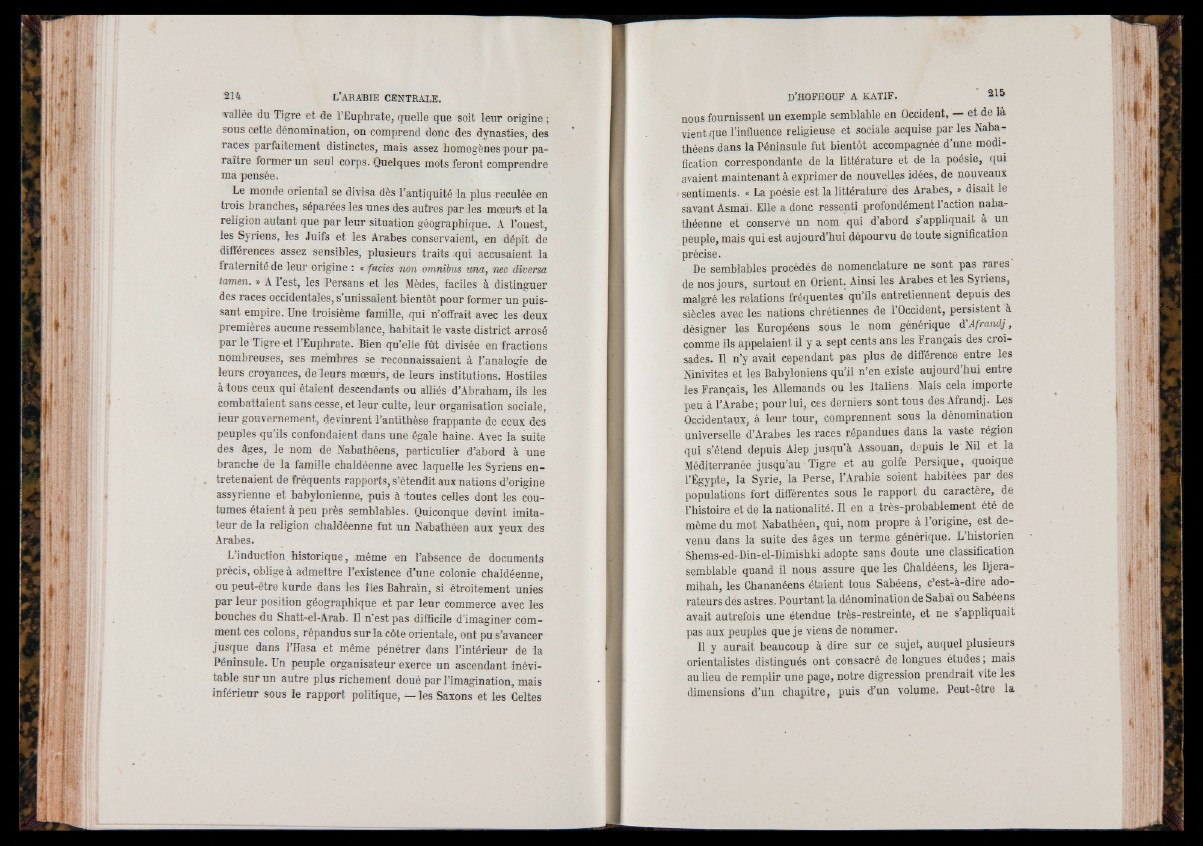
vallée du Tigre et de l’Euphrate, quelle que soit leur origine ;
sous cette dénomination, on comprend donc des dynasties, des
races parfaitement distinctes, mais assez homogènes pour paraître
former un seul corps. Quelques mots feront comprendre
mà pensée.
Le monde oriental se divisa dès l’antiquité la plus reculée en
trois branches, séparées les unes des autres par les moeui% et la
religion autant que par leur situation géographique. A l’ouest,
les Syriens, les Juifs et les Arabes conservaient, en dépit de
différences assez sensibles, plusieurs traits qui accusaient la
fraternité de leur origine : « faciès non omnibus una, nec diversa
tamen. » A 1 est, les Persans et les Mèdes, faciles à distinguer
des races occidentales, s’unissaient bientôt pour former un puissant
empire. Une troisième famille, qui n’offrait avec les deux
premières aucune ressemblance, habitait le vaste district arrosé
par le Tigre et l’Euphrate. Bien qu’elle fût divisée en fractions
nombreuses, ses membres se reconnaissaient à l’analogie de
leurs croyances, de leurs moeurs, de leurs institutions. Hostiles
à tous ceux qui étaient descendants ou alliés d’Abraham, ils les
combattaient sans cesse, et leur culte, leur organisation sociale,
leur gouvernement, devinrent l’antithèse frappante de ceux des
peuples qu ils confondaient dans une égale haine. Avec la suite
des âges, le nom de Nabathéens, particulier d’abord à une
branche de la famille chaldéenne avec laquelle les Syriens entretenaient
de fréquents rapports, s’étendit aux nations d’origine
assyrienne et babylonienne, puis à toutes celles dont les coutumes
étaient à peu près semblables. Quiconque devint imitateur
de la religion chaldéenne fut un Nabathéen aux yeux des
Arabes.
L’induction historique, même en l’absence de documents
précis, oblige à admettre l’existence d’une colonie chaldéenne,
ou peut-être kurde dans les îles Bahraïn, si étroitement unies
par leur position géographique et par leur commerce avec les
bouches du Shatt-el-Arab. Il n’est pas difficile d’imaginer comment
ces colons, répandus sur la côte orientale, ont pu s’avancer
jusque dans l’Hasa et même pénétrer dans l’intérieur de la
Péninsule. Un peuple organisateur exerce un ascendant inévitable
sur un autre plus richement doué par l’imagination, mais
inférieur sous le rapport politique, — les Saxons et les Celtes
nous fournissent un exemple semblable en Occident, — et de là
vient que l’influence religieuse et sociale acquise par les Nabathéens
dans la Péninsule fut bientôt accompagnée d’une modification
correspondante de la littérature et de la poésie, qui
avaient maintenant à exprimer de nouvelles idées, de nouveaux
sentiments. « La poésie est la littérature des Arabes, » disait le
savant Asmaï. Elle a donc ressenti profondément l’action nabathéenne
et conservé un nom qui d’abord s’appliquait à un
peuple, mais qui est aujourd’hui dépourvu de toute signification
précise.
De semblables procédés de nomenclature ne sont pas rares
de nos jours, surtout en Orient. Ainsi les Arabes et les Syriens,
malgré les relations fréquentes' qu’ils entretiennent depuis des
siècles avec les nations chrétiennes de l’Occident, persistent à
désigner les Européens sous le nom générique d'Afrandj,
comme ils appelaient il y a sept cents ans les Français des croisades.
Il n’y avait cependant pas plus de différence entre les
Ninivites et les Babyloniens qu’il n’en existe aujourd’hui entre
les Français, les Allemands ou les Italiens. Mais cela importe
peu à l’Arabe; pour lui, ces derniers sont tous des Afrandj. Les
Occidentaux, à leur tour, comprennent sous la dénomination
universelle d’Arabes les races répandues dans la vaste région
qui s’étend depuis Alep jusqu’à Assouan, depuis le Nil et la
Méditerranée jusqu’au Tigre et au golfe Persique, quoique
l’Ëgypte, la Syrie, la Perse, l’Arabie soient habitées par des
populations fort différentes sous le rapport du caractère, de
l’histoire et de la nationalité. Il en a très-probablement été de
même du mot Nabathéen, qui, nom propre à l’origine, est devenu
dans la suite des âges un terme générique. L’historien
Shems-ed-Din-el-Dimishki adopte sans doute une classification
semblable quand il nous assure que les Chaldéens, les Djera-
mihah, les Chananéens étaient tous Sabéens, c’est-à-dire adorateurs
des astres. Pourtant la dénomination de Sabaï ou Sabéens
avait autrefois une étendue très-restreinte, et ne s appliquait
pas aux peuples que je viens de nommer.
Il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet, auquel plusieurs
orientalistes distingués ont consacré de longues études ; mais
au lieu de remplir une page, notre digression prendrait vite les
dimensions d’un chapitre, puis d’un volume. Peut-être la