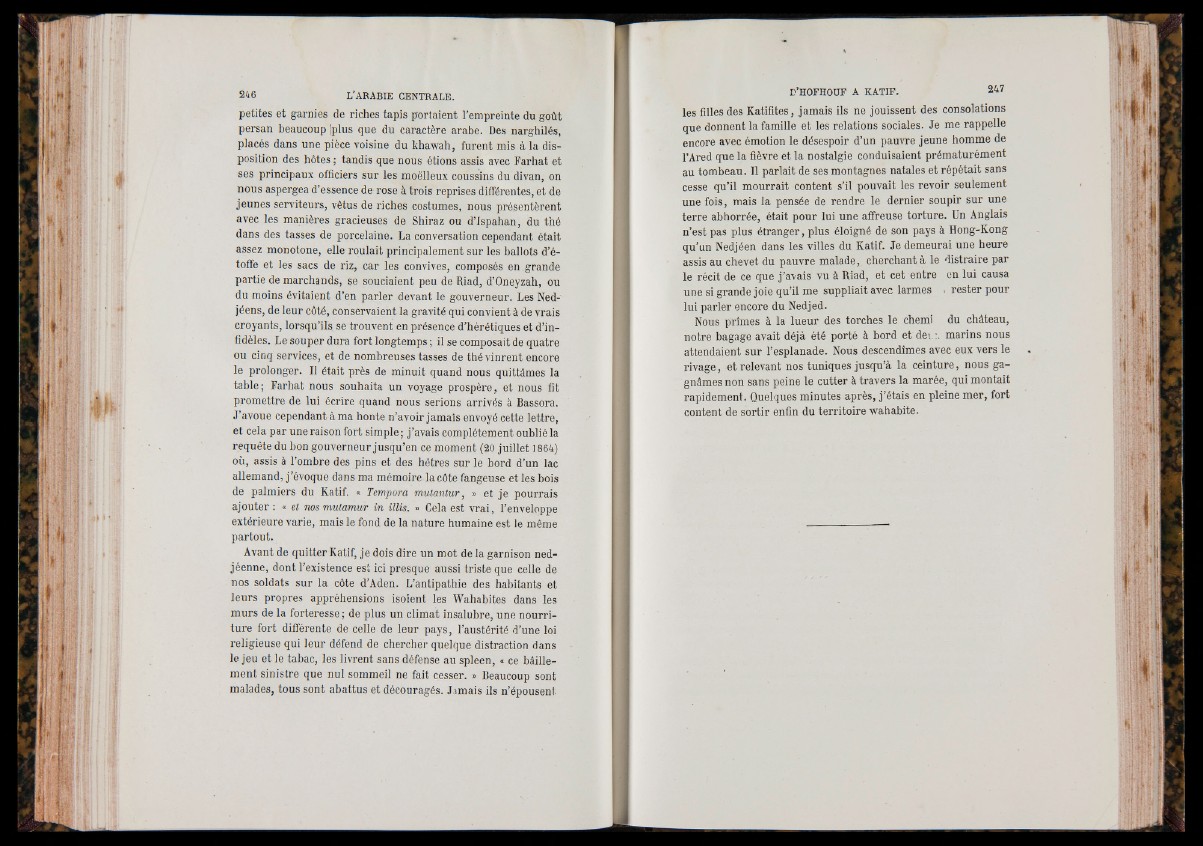
petites et garnies de riches tapis portaient l’empreinte du goût
persan beaucoup [plus que du caractère arabe. Des narghilés,
placés dans une pièce voisine du khawah, furent mis à la disposition
des hôtes ; tandis que nous étions assis avec Parhat et
ses principaux officiers sur les moelleux coussins du divan, on
nous aspergea d’essence de rose à trois reprises différentes, et de
jeunes serviteurs, vêtus de riches costumes, nous présentèrent
avec les manières gracieuses de Shiraz ou d’fspahan, du thé
dans des tasses de porcelaine. La conversation cependant était
assez monotone, elle roulait principalement sur les ballots d’étoffe
et les sacs de riz, car les convives, composés en. grande
partie de marchands, se souciaient peu de Riad, d’Oneyzah, ou
du moins évitaient d’en parler devant le gouverneur. Les Ned-
jéens, de leur côté, conservaient la gravité qui convient à de vrais
croyants, lorsqu'ils se trouvent en présence d’hérétiques et d’infidèles.
Le souper dura fort longtemps ; il se composait de quatre
ou cinq services, et de nombreuses tasses de thé vinrent encore
le prolonger. Il était près de minuit quand nous quittâmes la
table ; Parhat nous souhaita un voyage prospère, et nous fit
promettre de lui écrire quand nous serions arrivés à Bassora.
J’avoue cependant à ma honte n’avoir jamais envoyé cette lettre,
et cela par une raison fort simple; j ’avais complètement oublié la
requête du bon gouverneur jusqu’en ce moment (20 juillet 1864)
où, assis à l’ombre des pins et des hêtres sur le bord d’un lac
allemand, j ’évoque dans ma mémoire la côte fangeuse et les bois
de palmiers du Katif. « Tempora mutantur, » et je pourrais
ajouter : * et nos mutamur in illis. » Cela est vrai, l’enveloppe
extérieure varie, mais le fond de la nature humaine est le même
partout.
Avant de quitter Katif, je dois dire un mot de la garnison ned-
jéenne, dont l’existence est ici presque aussi triste que celle de
nos soldats sur la côte d’Aden. L’antipathie des habitants et
leurs propres appréhensions isolent les Wahabites dans les
murs de la forteresse; de plus un climat insalubre, une nourriture
fort différente de celle de leur pays, l’austérité d’une loi
religieuse qui leur défend de chercher quelque distraction dans
le jeu et le tabac, les livrent sans défense au spleen, * ce bâillement
sinistre que nul sommeil ne fait cesser. » Beaucoup sont
malades, tous sont abattus et découragés. Jamais ils n’épousent
les filles des Katifites, jamais ils ne jouissent des consolations
que donnent la famille et les relations sociales. Je me rappelle
encore avec émotion le désespoir d’un pauvre jeune homme de
l’Ared que la fièvre et la nostalgie conduisaient prématurément
au tombeau. Il parlait de ses montagnes natales et répétait sans
cesse qu’il mourrait content s’il pouvait les revoir seulement
une fois, mais la pensée de rendre le dernier soupir sur une
terre abhorrée, était pour lui une affreuse torture. Un Anglais
n’est pas plus étranger, plus éloigné de son pays à Hong-Kong
qu’un Nedjéen dans les villes du Katif. Je demeurai une heure
assis au chevet du pauvre malade, cherchant à le distraire par
le récit de ce que j ’avais vu à Riad, et cet entre en lui causa
une si grande joie qu’il me suppliait avec larmes . rester pour
lui parler encore du Nedjed.
Nous prîmes à la lueur des torches le chemi du château,
notre bagage avait déjà été porté à bord etdei.:. marins nous
attendaient sur l’esplanade. Nous descendîmes avec eux vers le
rivage, et relevant nos tuniques jusqu’à la ceinture, nous gagnâmes
non sans peine le cutter à travers la marée, qui montait
rapidement. Quelques minutes après, j ’étais en pleine mer, fort-
content de sortir enfin du territoire wahabite.