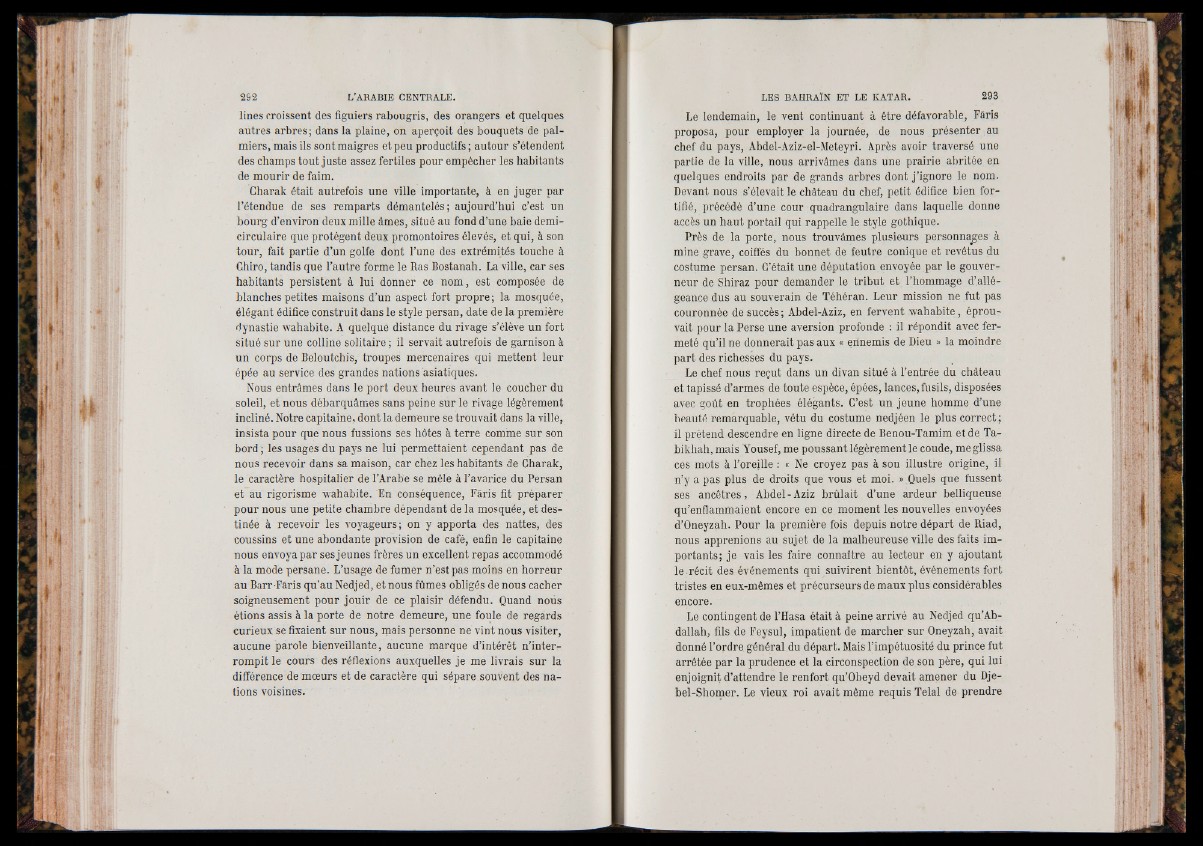
lines croissent des figuiers rabougris, des orangers et quelques
autres arbres; dans la plaine, on aperçoit des bouquets de palmiers,
mais ils sont maigres et peu productifs ; autour s’étendent
des champs tout juste assez fertiles pour empêcher les habitants
de mourir de faim.
Charak était autrefois une ville importante, à en juger par
l’étendue de ses remparts démantelés; aujourd’hui c’est un
bourg d’environ deux mille âmes, situé au fond d’une baie demi-
circulaire que protègent deux promontoires élevés, et qui, à son
tour, fait partie d’un golfe dont l’une des extrémités touche à
Chiro, tandis que l’autre forme le Ras Bostanah. La ville, car ses
habitants persistent à lui donner ce nom, est composée de
blanches petites maisons d’un aspect fort propre; la mosquée,
élégant édifice construit dans le style persan, date de la première
dynastie wahabite. A quelque distance du rivage s’élève un fort
situé sur une colline solitaire ; il servait autrefois de garnison à
un corps de Beloutchis, troupes mercenaires qui mettent leur
épée au service des grandes nations asiatiques.
Nous entrâmes dans le port deux heures avant le coucher du
soleil, et nous débarquâmes sans peine sur le rivage légèrement
incliné. Notre capitaine, dont la demeure se trouvait dans la ville,
insista pour que nous fussions ses hôtes à terre comme sur son
bord ; les usages du pays ne lui permettaient cependant pas de
nous recevoir dans sa maison, car chez les habitants de Charak,
le caractère hospitalier de l’Arabe se mêle à l’avarice du Persan
et au rigorisme wahabite. En conséquence, Fâris fit préparer
pour nous une petite chambre dépendant de la mosquée, et destinée
à recevoir les voyageurs; on y apporta des nattes, des
coussins et une abondante provision de café, enfin le capitaine
nous envoya par ses jeunes frères un excellent repas accommodé
à la mode persane. L’usage de fumer n’est pas moins en horreur
au Barr Paris qu’au Nedjed, et nous fûmes obligés de nous cacher
soigneusement pour jouir de ce plaisir défendu. Quand noüs
étions assis à la porte de notre demeure, une foule de regards
curieux se fixaient sur nous, mais personne ne vint nous visiter,
aucune parole bienveillante, aucune marque d’intérêt n’interrompit
le cours des réflexions auxquelles je me livrais sur la
différence de moeurs et de caractère qui sépare souvent des nations
voisines.
Le lendemain, le vent continuant à être défavorable, Fâris
proposa, pour employer la journée, de nous présenter au
chef du pays, Abdel-Aziz-el-Meteyri. Après avoir traversé une
partie de la ville, nous arrivâmes dans une prairie abritée en
quelques endroits par de grands arbres dont j ’ignore le nom.
Devant nous s’élevait le château du chef, petit édifice bien fortifié,
précédé d’une cour quadrangulaire dans laquelle donne
accès un haut portail qui rappelle le style gothique.
Près de la porte, nous trouvâmes plusieurs personnages à
mine grave, coiffés du bonnet de feutre conique et revêtus du
costume persan. C’était une députation envoyée par le gouverneur
de Shiraz pour demander le tribut et l’hommage d’allégeance
dus au souverain de Téhéran. Leur mission ne fut pas
couronnée de succès; Abdel-Aziz, en fervent wahabite, éprouvait
pour la Perse une aversion profonde : il répondit avec fermeté
qu’il ne donnerait pas aux « ennemis de Dieu » la moindre
part des richesses du pays.
Le chef nous reçut dans un divan situé à l’entrée du château
et tapissé d’armes de toute espèce, épées, lances, fusils, disposées
avec goût en trophées élégants. C’est un jeune homme d’une
beauté remarquable, vêtu du costume nedjéen le plus correct;
il prétend descendre en ligne directe de Benou-Tamim et de Ta-
bikhah, mais Yousef, me poussant légèrement le coude, me glissa
ces mots à l’oreille : « Ne croyez pas à son illustre origine, il
n’y a pas plus de droits que vous et moi. » Quels que fussent
ses ancêtres, Abdel-Aziz brûlait d’une ardeur belliqueuse
qu’enflammaient encore en ce moment les nouvelles envoyées
d’Oneyzah. Pour la première fois depuis notre départ de Riad,
nous apprenions au sujet de la malheureuse ville des faits importants;
je vais les faire connaître au lecteur en y ajoutant
le.récit des événements qui suivirent bientôt, événements fort
tristes en eux-mêmes et précurseurs de maux plus considérables
encore.
Le contingent de l’Hasa était à peine arrivé au Nedjed qu’Ab-
dallah, fils de Peysul, impatient de marcher sur Oneyzah, avait
donné l’ordre général du départ. Mais l’impétuosité du prince fut
arrêtée par la prudence et la circonspection de son père, qui lui
enjoignit d’attendre le renfort qu’Obeyd devait amener du Dje-
bel-Shomer. Le vieux roi avait même requis Telal de prendre