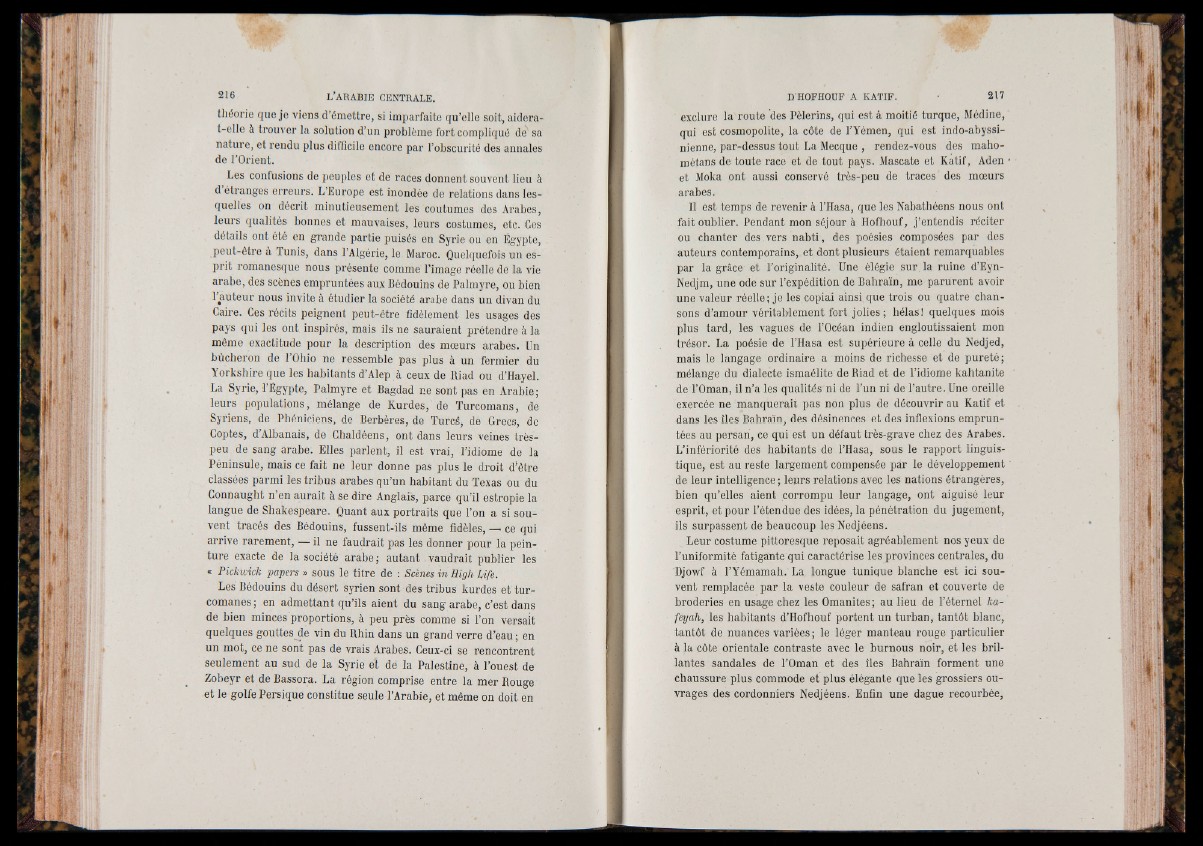
théorie que je viens d’émettre, si imparfaite qu’elle soit, aidera-
t-elle à trouver la solution d’un problème fort compliqué de1 sa
nature, et rendu plus difficile encore par l’obscurité des annales
de l’Orient.
Les confusions de peuples et de races donnent souvent lieu à
d étranges erreurs. L’Europe est inondée de relations dans lesquelles
on décrit minutieusement les coutumes des Arabes,
leurs qualités bonnes et mauvaises, leurs costumes, etc. Ces
détails ont été en grande partie puisés en Syrie ou en Egypte,
peut-être à Tunis, dans l’Algérie, le Maroc. Quelquefois un esprit
romanesque nous présente comme l’image réelle de la vie
arabe, des scènes empruntées aux Bédouins de Palmyre, ou bien
1 auteur nous invite à étudier la société arabe dans un divan du
Caire. Ces récits peignent peut-être fidèlement les usages des
pays qui les ont inspirés, mais ils ne sauraient prétendre à la
même exactitude pour la description des moeurs arabes. Un
bûcheron de l’Ohio ne ressemble pas plus à un fermier du
Yorkshire que les habitants d’Alep à ceux de Riad ou d’Hayel.
La Syrie, l’Egypte, Palmyre et Bagdad ne sont pas en Arabie ;
leurs populations, mélange de Kurdes, de Turcomans, de
Syriens, de Phéniciens, de Berbères, de TurcS, de Grecs, de
Coptes, d Albanais, de Chaldéens, ont dans leurs veines très-
peu de sang arabe. Elles parlent, il est vrai, l’idiome de la
Péninsule, mais ce fait ne leur donne pas plus le droit d’être
classées parmi les tribus arabes qu’un habitant du Texas ou du
Connaught n’en aurait à se dire Anglais, parce qu’il estropie la
langue de Shakespeare. Quant aux portraits que l’on a si souvent
tracés des Bédouins, fussent-ils même fidèles, — ce qui
arrive rarement, — il ne faudrait pas les donner pour la peinture
exacte de la société arabe ; autant vaudrait publier les
« Pickwick papers » sous le titre de : Scènes in High life.
Les Bédouins du désert syrien sont des tribus kurdes et tur-
comanes ; en admettant qu’ils aient du sang arabe, c’est dans
de bien minces proportions, à peu près comme si l’on versait
quelques gouttes_de vin du Rhin dans un grand verre d’eau ; en
un mot, ce ne sont pas de vrais Arabes. Ceux-ci se rencontrent
seulement au sud de la Syrie et de la Palestine, à l’ouest de
Zobeyr et de Bassora. La région comprise entre la mer Rouge
et le golfe Persique constitue seule l’Arabie, et même on doit en
exclure la route des Pèlerins, qui est à moitié turque, Médine,
qui est cosmopolite, la côte de l’Yémen, qui est indo-abyssinienne,
par-dessus tout La Mecque , rendez-vous des maho-
métans de toute race et de tout pays. Mascate et Katif, Aden
et Moka ont aussi conservé très-peu de traces' des moeurs
arabes.
Il est temps de revenir à l’Hasa, que les Nabathéens nous ont
fait oublier. Pendant mon séjour à Hofhouf, j ’entendis réciter
ou chanter des . vers nabti, des poésies composées par des
auteurs contemporains, et dont plusieurs étaient remarquables
par la grâce-et l’originalité. Une élégie sur la ruine d’Eyn-
Nedjm, une ode sur l’expédition de Bahraïn, me parurent avoir
une valeur réelle ; j e les copiai ainsi que trois ou quatre chansons
d’amour véritablement fort jolies; hélas! quelques mois
plus tard, les vagues de l’Océan indien engloutissaient mon
trésor. La poésie de l’Hasa est supérieure à celle du Nedjed,
mais le langage ordinaire a moins de richesse et de pureté;
mélange du dialecte ismaélite' de Riad et de l’idiome kahtanite
de l’Oman, il n’a les qualités ni de l’un ni de l’autre. Une oreille
exercée ne manquerait pas non plus de découvrir au Katif et
dans les îles Bahraïn, des désinences et des inflexions empruntées
au persan, ce qui est un défaut très-grave chez des Arabes.
L’infériorité des habitants de l’Hasa, sous le rapport linguistique,
est au reste largement compensée par le développement
de leur intelligence; leurs relations avec les nations étrangères,
bien qu’elles aient corrompu leur langage, ont aiguisé leur
esprit, et pour l’étendue des idées, la pénétration du jugement,
ils surpassent de beaucoup les Nedjéens.
Leur costume pittoresque reposait agréablement nos yeux de
l’uniformité fatigante qui caractérise les provinces centrales, du
Djowf à l’Yémamah. La longue tunique blanche est ici souvent
remplacée par la veste couleur de safran et couverte de
broderies en usage chez les Omanites ; au lieu de l’éternel ka-
feyah, les habitants d’Hofhouf portent un turban, tantôt blanc,
tantôt de nuances variées ; le léger manteau rouge particulier
à la côte orientale contraste avec le burnous noir, et les brillantes
sandales de l’Oman et des îles Bahraïn forment une
chaussure plus commode et plus élégante que les grossiers ouvrages
des cordonniers Nedjéens. Enfin une dague recourbée,