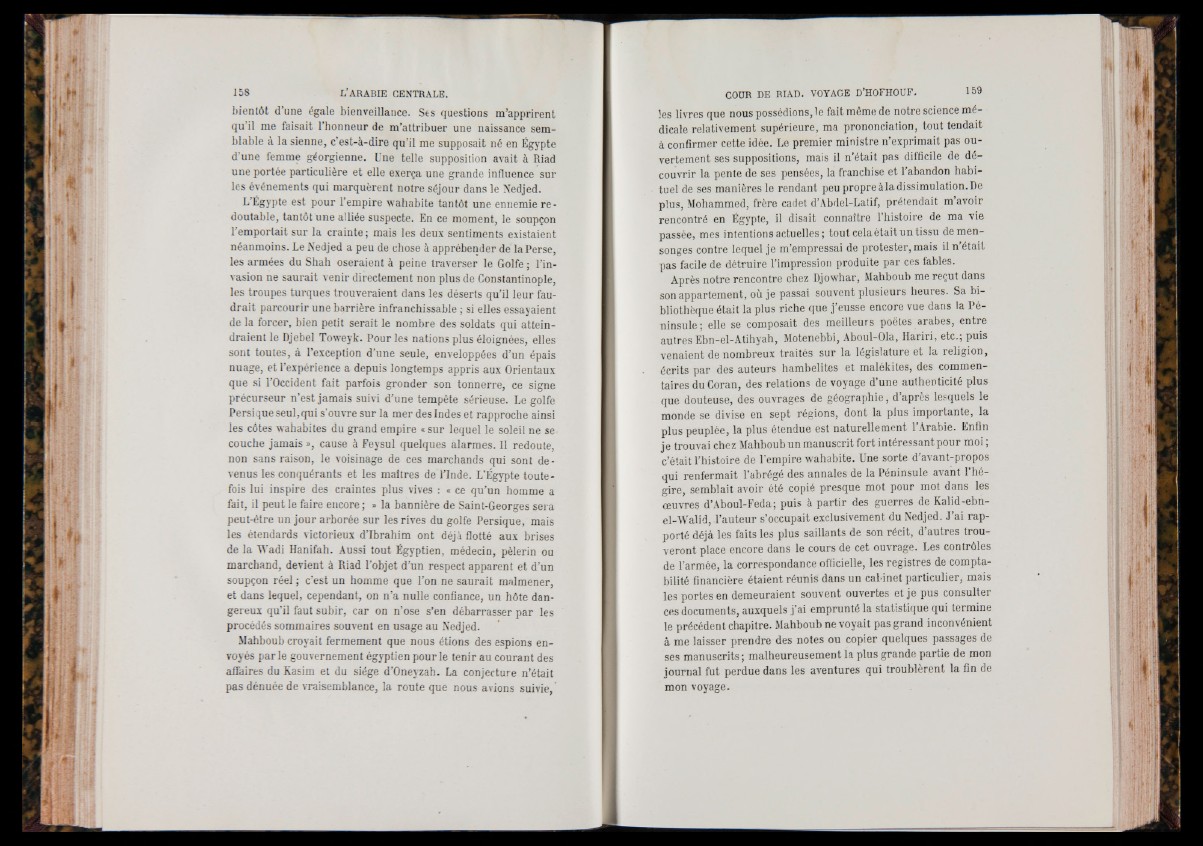
bientôt d’une égale bienveillance. Ses questions m’apprirent
qu’il me faisait l’honneur de m’attribuer une naissance semblable
à la sienne, c’est-à-dire qu’il me supposait né en Egypte
d’une femme géorgienne. Une telle supposition avait à Riad
une portée particulière et elle exerça une grande influence sur
les événements qui marquèrent notre séjour dans le Nedjed.
L’Egypte est pour l’empire wahabite tantôt une ennemie r e doutable,
tantôt une alliée suspecte. En ce moment, le soupçon
l’emportait sur la crainte; mais les deux sentiments existaient
néanmoins. Le Nedjed a peu de chose à appréhender de la Perse,
les armées du Shah oseraient à peine traverser le Golfe ; l’invasion
ne saurait venir directement non plus de Constantinople,
les troupes turques trouveraient dans les déserts qu’il leur faudrait
parcourir une barrière infranchissable ; si elles essayaient
de la forcer, bien petit serait le nombre des soldats qui atteindraient
le Djebel Toweyk. Pour les nations plus éloignées, elles
sont toutes, à l’exception d’une seule, enveloppées d’un épais
nuage, et l’expérience a depuis longtemps appris aux Orientaux
que si l’Occident fait parfois gronder son tonnerre, ce signe
précurseur n’est jamais suivi d’une tempête sérieuse. Le golfe
Persique seul,qui s’ouvre sur la mer des Indes et rapproche ainsi
les côtes wahabites du grand empire « sur lequel le soleil ne se
couche jamais », cause à Peysul quelques alarmes. Il redoute,
non sans raison, le voisinage de ces marchands qui sont de -
venus les conquérants et les maîtres de l’Inde. L’Égypte toutefois
lui inspire des craintes plus vives : « ce qu’un homme a
fait, il peut le faire encore ; » la bannière de Saint-Georges sera
peut-être un jour arborée sur les rives du golfe Persique, mais
les étendards victorieux d’Ibrahim ont déjà flotté aux brises
de la Wadi Hanifah. Aussi tout Égyptien, médecin, pèlerin ou
marchand, devient à Riad l’objet d’un respect apparent et d’un
soupçon réel ; c’est un homme que l’on ne saurait malmener,
et dans lequel, cependant, on n’a nulle confiance, un hôte dangereux
qu’il faut subir, car on n’ose s’en débarrasser par les
procédés sommaires souvent en usage au Nedjed.
Mahboub croyait fermement que nous étions des espions envoyés
parle gouvernement égyptien pour le tenir au courant des
affaires du Kasim et du siège d’Oneyzah. La conjecture n’était
pas dénuée de vraisemblance, la route que nous avions suivie,
les livres que nous possédions, le fait même de notre science médicale
relativement supérieure, ma prononciation, tout tendait
à confirmer cette idée. Le premier ministre n’exprimait pas ouvertement
ses suppositions, mais il n’était pas difficile de découvrir
la pente de ses pensées, la franchise et l’abandon habituel
de ses manières le rendant peupropreàladissimulation.De
plus, Mohammed, frère cadet d’Abdel-Latif, prétendait m’avoir
rencontré en Egypte, il disait connaître l’histoire de ma vie
passée, mes intentions actuelles; tout cela était un tissu de mensonges
contre lequel je m’empressai de protester, mais il n’était
pas facile de détruire l’impression produite par ces fables.
Après notre rencontre chez Djowhar, Mahboub me reçut dans
son appartement, où je passai souvent plusieurs heures. Sa bibliothèque
était la plus riche que j’eusse encore vue dans la Péninsule;
elle se composait des meilleurs poètes arabes, entre
autres Ebn-el-Atihyah, Motenebbi, Aboul-Ola, Hariri, etc.; puis
venaient de nombreux traités sur la législature et la religion,
écrits par des auteurs hambelites et malékites, des commentaires
du Coran, des relations de voyage d’une authenticité plus
que douteuse, des ouvrages de géographie, d’après lesquels le
monde se divise en sept régions, dont la plus importante, la
plus peuplée, la plus étendue est naturellement l’Arabie. Enfin
je trouvai chez Mahboub un manuscrit fort intéressant pour moi;
c’était l’histoire de l’empire wahabite. Une sorte d’avant-propos
qui renfermait l’abrégé des annales de la Péninsule avant l’hégire,
semblait avoir été copié presque mot pour mot dans les
oeuvres d’Aboul-Feda; puis à partir des guerres de Kalid-ebn-
el-Walid, l’auteur s’occupait exclusivement du Nedjed. J’ai rapporté
déjà les faits les plus saillants de son récit, d’autres trouveront
place encore dans le cours de cet ouvrage. Les contrôles
de l’armée, la correspondance officielle, les registres de comptabilité
financière étaient réunis dans un cabinet particulier, mais
les portes en demeuraient souvent ouvertes et je pus consulter
ces documents, auxquels j’ai emprunté la statistique qui termine
le précédent chapitre. Mahboub ne voyait pas grand inconvénient
à me laisser prendre des notes ou copier quelques passages de
ses manuscrits ; malheureusement la plus grande partie de mon
journal fut perdue dans les aventures qui troublèrent la fin de
mon voyage.