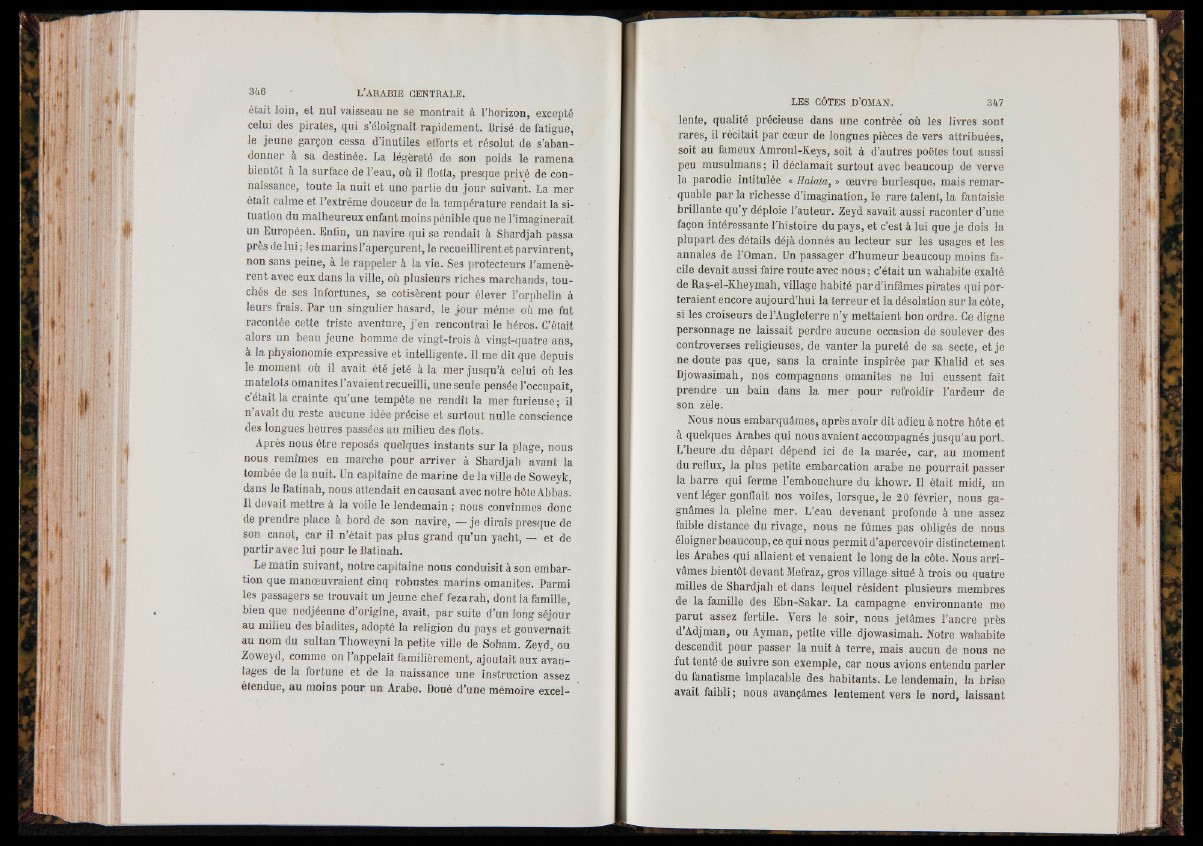
était loin, et nul vaisseau ne se montrait à l’horizon, excepté
celui des pirates, qui s’éloignait rapidement. Brisé de fatigue,
le jeune garçon cessa d’inutiles efforts et résolut de s’abandonner
à sa destinée. La légèreté de son poids le ramena
bientôt à la surface de l’eau, où il flotta, presque privé de connaissance,
toute la nuit et une partie du jour suivant. La mer
était calme et l’extrême douceur de la température rendait la situation
du malheureux enfant moins pénible que ne l’imaginerait
un Européen. Enfin, un navire qui se rendait à Shardjah passa
près de lui ; les marins l’aperçurent, le recueillirent et p arvinrent,
non sans peine, à le rappeler à la vie. Ses protecteurs l’amenèrent
avec eux dans la ville, où plusieurs riches marchands, touchés
de ses infortunes, se cotisèrent pour élever l’orphelin à
leurs frais. Par un singulier hasard, le jour même où me fut
racontée cette triste aventure, j’en rencontrai le héros. C’était
alors un beau jeune homme de vingt-trois à vingt-quatre ans,
à la physionomie expressive et intelligente. Il me dit que depuis
le moment où il avait été jeté à la mer jusqu’à celui où les
matelots omanites 1 avaient recueilli, une seule pensée l’occupait,
c était la crainte qu une tempête ne rendît la mer furieuse ; il
n avait du reste aucune idée précise et surtout nulle conscience
des longues heures passées au milieu des flots.
Après nous être reposés quelques instants sur la plage, nous
nous remîmes en marche pour arriver à Shardjah avant la
tombée de la nuit. Un capitaine de marine de la ville de Soweyk,
dans le Batinah, nous attendait en causant avec notre hôte Abbas.
U devait mettre à la voile le lendemain ; nous convînmes donc
de prendre place à bord de son navire, — je dirais presque de
son canot, car il n’était pas plus grand qu’un yacht, — et de
partir avec lui pour le Batinah.
Le matin suivant, notre capitaine nous conduisit à son embar-
tion que manoeuvraient cinq robustes marins omanites. Parmi
les passagers se trouvait un jeune chef fezarah, dont la famille,
bien que nedjéenne d’origine, avait, par suite d’un long séjour
au milieu des biaditës, adopté la religion du pays et gouvernait
au nom du sultan Thoweyni la petite ville de Soham. Zeyd, ou
Zoweyd, comme on l’appelait familièrement, ajoutait aux avantages
de la fortune et de la naissance une instruction assez
étendue, au moins pour un Arabe. Doué d’une mémoire excellente,
qualité précieuse dans une contrée où les livres sont
rares, il récitait par coeur de longues pièces de vers attribuées,
soit au fameux Amroul-Keys, soit à d’autres poètes tout aussi
peu musulmans ; il déclamait surtout avec beaucoup de verve
la parodie intitulée « Halata, » oeuvre burlesque, mais remarquable
par la richesse d’imagination, le rare talent, la fantaisie
brillante qu’y déploie l’auteur. Zeyd savait aussi raconter d’une
façon intéressante l’histoire du pays, et c’est à lui que je dois la
plupart des détails déjà donnés au lecteur sur les usages et les
annales de l’Oman. Un passager d’humeur beaucoup moins facile
devait aussi faire route avec nous ; c’était un wahabite exalté
de Ras-el-Kheymah, village habité par d’infâmes pirates qui porteraient
encore aujourd’hui la terreur et la désolation sur la côte,
si les croiseurs de l’Angleterre n’y mettaient bon ordre. Ce digne
personnage ne laissait perdre aucune occasion de soulever des
controverses religieuses, de vanter la pureté de sa secte, et je
ne doute pas que, sans la crainte inspirée par Khalid et ses
Djowasimah, nos compagnons omanites ne lui eussent fait
prendre un bain dans la mer pour refroidir l’ardeur de
son zèle.
Nous nous embarquâmes, après avoir dit'adieu à notre hôte et
à quelques Arabes qui nous avaient accompagnés jusqu’au port.
L’heure .du départ dépend ici de la marée, car, au moment
du reflux, la plus petite embarcation arabe ne pourrait passer
la barre qui ferme l’embouchure du khowr. Il était midi, un
vent léger gonflait nos voiles, lorsque, le 20 février, nous gagnâmes
la pleine mer. L’eau devenant profonde à une assez
faible distance du rivage, nous ne fûmes pas obligés de nous
éloigner beaucoup, ce qui nous permit d’apercevoir distinctement
les Arabes qui allaient et venaient le long de la côte. Nous arrivâmes
bientôt devant Mefraz, gros village situé à trois ou quatre
milles de Shardjah et dans lequel résident plusieurs membres
de la famille des Ebn-Sakar. La campagne environnante me
parut assez fertile. Yers le soir, nous jetâmes l’ancre près
d Adjman, ou Ayman, petite ville djowasimah. Notre wahabite
descendit pour passer la nuit à terre, mais aucun de nous ne
fut tenté de suivre son exemple, car nous avions entendu parler
du fanatisme implacable des habitants. Le lendemain, la brise
avait faibli ; nous avançâmes lentement vers le nord, laissant