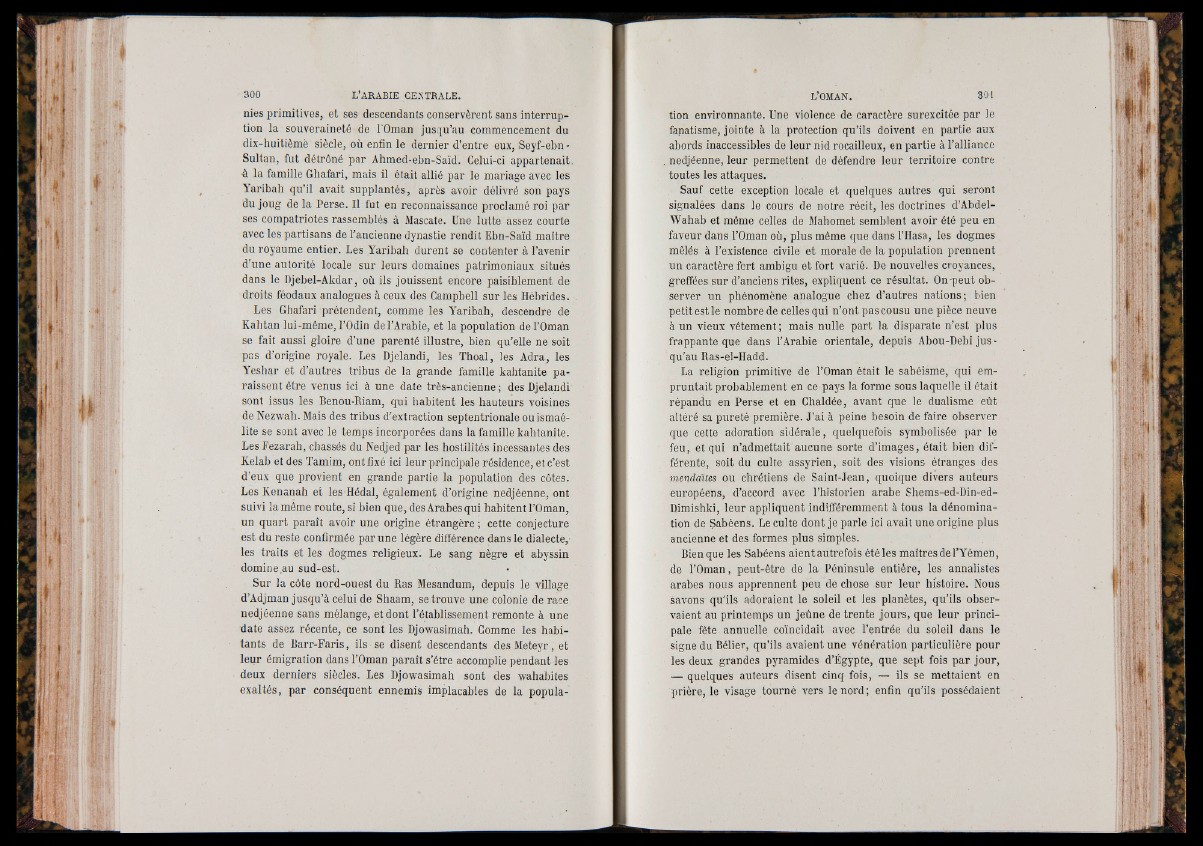
nies primitives, et ses descendants conservèrent sans interruption
la souveraineté de l'Oman jusqu’au Commencement du
dix-huitièmè siècle, où enfin le dernier d’entre eux, Seyf-ebn-
Sultan, fut détrôné par Ahmed-ebn-Saïd. Celui-ci appartenait,
à la famille Ghafari, mais il était allié par le mariage avec les
Yaribah qu’il avait supplantés, après avoir délivré son pays
du joug de la Perse. Il fut en reconnaissance proclamé roi par
ses compatriotes rassemblés à Mascate. Une lutte assez courte
avec les partisans de l’ancienne dynastie rendit Ebn-Saïd maître
du royaume entier. Les Yaribah durent se contenter à l’avenir
d’une autorité locale sur leurs domaines patrimoniaux situés
dans le Djebel-Akdar, où ils jouissent encore paisiblement de
droits féodaux analogues à ceux des Campbell sur lès Hébrides.
Les Ghafari prétendent, comme les Yaribah, descendre de
Kahtan lui-même, l’Odin de l’Arabie, et la population de l’Oman
se fait aussi gloire d’une parenté illustre, bien qu’elle ne soit
pas d’origine royale. Les Djelandi, les Thoal, les Adra, les
Yeshar et d’autres tribus de la grande famille kahtanite paraissent
être venus ici à une date très-ancienne ; des Djelandi
sont issus les Benou-Riam, qui habitent les hauteurs voisines
de Nezwah. Mais des tribus d’extraction septentrionale ou ismaélite
se sont avec le temps incorporées dans la famille kahtanite.
Les Fezarah, chassés du Nedjed par les hostilités incessantes des
Kelab et des Tamim, ont fixé ici leur principale résidence, et c’est
d’eux que provient en grande partie la population des côtes.
Les Kenanah et les Hédal, également d’origine nedjéenne, ont
suivi la même route, si bien que, des Arabes qui habitent l’Oman,
un quart paraît avoir une origine étrangère ; cette conjecture
est du reste confirmée par une légère différence dans le dialecte,'
les traits et les dogmes religieux. Le sang nègre et abyssin
domine.au sud-est. -
Sur la côte nord-ouest du Ras Mesandum, depuis le village
d’Adjman jusqu’à celui de Shaam, se trouve une colonie de race
nedjéenne sans mélange, et dont l’établissement remonte à une
date assez récente, ce sont les Djowasimah. Gomme les habitants
de Barr-Fâris, ils se disent descendants desMeteyr, et
leur émigration dans l’Oman paraît s’être accomplie pendant les
deux derniers siècles. Les Djowasimah sont des wahabites
exaltés, par conséquent ennemis implacables de la population
environnante. Une violence de caractère surexcitée par le
fapatisme, jointe à la protection qu’ils doivent en partie aux
abords inaccessibles de leur nid rocailleux, en partie à l’alliance
nedjéenne, leur permettent de défendre leur territoire contre
toutes les attaques.
. Sauf cette exception locale et quelques autres qui seront
signalées dans le cours de notre récit, les doctrines d’Abdel-
Wahab et même celles de Mahomet semblent avoir été peu en
faveur dans l’Oman où, plus même que dans l’Hasa, les dogmes
mêlés à l’existence civile et morale de la population prennent
un caractère fort ambigu et fort varié. De nouvelles croyances,
greffées sur d’anciens rites, expliquent ce résultat. On-peut observer
un phénomène analogue chez d’autres nations; bien
petit est le nombre de celles qui n’ont pas cousu une pièce neuve
à un vieux vêtement ; mais nulle part la disparate n’est plus
frappante que dans l’Arabie orientale, depuis Abou-Debi ju squ’au
Ras-el-Hadd.
La religion primitive de l’Oman était le sabéisme, qui empruntait
probablement en ce pays la forme sous laquelle il était
répandu en Perse et en Ghaldée, avant que le dualisme eût
altéré sa pureté première. J’ai à peine besoin de faire observer
que cette adoration sidérale, quelquefois symbolisée par le
feu, et qui n’admettait aucune sorte d’images, était bien différente,.
soit du culte assyrien, soit des visions étranges des
mendaües ou chrétiens de Saint-Jean, quoique divers auteurs
européens, d’accord avec l’historien arabe Shems-ed-Din-ed-
Dimishki, leur appliquent indifféremment à tous la dénomination
de Sabéens. Le culte dont je parle ici avait une origine plus
ancienne et des formes plus simples.
Bien que les Sabéens aient autrefois été les maîtres de l’Yémen,
de l’Oman, peut-être de la Péninsule entière, les annalistes
arabes nous apprennent peu de chose sur leur histoire. Nous
savons qu’ils adoraient le soleil et les planètes, qu’ils observaient
au printemps un jeûne de trente jours, que leur principale
fête annuelle coïncidait avec l’entrée du soleil dans le
signe du Bélier, qu’ils avaient une vénération particulière pour
les deux grandes pyramides d’Ëgypte, que sept fois par jour,
— quelques auteurs disent cinq fois, — ils se mettaient en
prière, le visage tourné vers le nord; enfin qu’ils possédaient