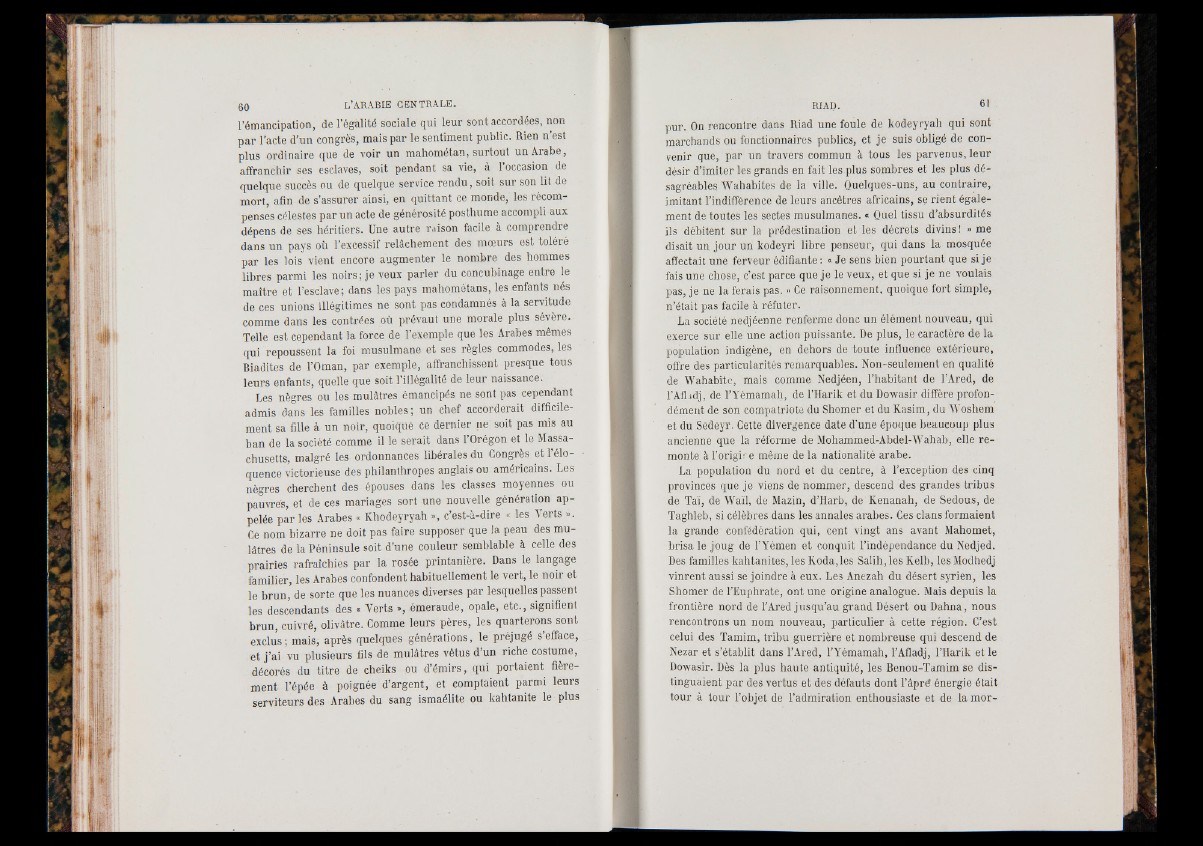
l’émancipation, de l’égalité sociale qui leur sont accordées, non
par l’acte d’un congrès, mais par le sentiment public. Rien n’est
plus ordinaire que de voir un mahométan, surtout un Arabe,
affranchir ses esclaves, soit pendant sa vie, à l’occasion de
quelque succès ou de quelque service rendu, soit sur son lit de
mort, afin de s’assurer ainsi, en quittant ce monde, les récompenses
célestes par un acte de générosité posthume accompli aux
dépens de ses héritiers. Une autre raison facile à comprendre
dans un pays où l’excessif relâchement des moeurs est toléré
par les lois vient encore augmenter le nombre des hommes
libres parmi les noirs; je veux parler du concubinage entre le
maître et l’esclave; dans les pays mahométans, les enfants nés
de ces unions illégitimes ne sont pas condamnés à la servitude
comme dans les contrées où prévaut une morale plus sévère.
Telle est cependant la force de l’exemple que les Arabes mêmes
qui repoussent la foi musulmane et ses règles commodes, les
Biadites de l’Oman, par exemple, affranchissent presque tous
leurs enfants, quelle que soit l’illégalité de leur naissance.
Les nègres ou les mulâtres émancipés ne sont pas cependant
admis dans les familles nobles; un chef accorderait difficilement
sa fille à un noir, quoique ce dernier ne soit pas mis au
ban de la société comme il le serait dans l’Orégon et le Massachusetts,
malgré les ordonnances libérales du Congrès et l’éloquence
victorieuse des philanthropes anglais ou américains. Les
nègres cherchent des épouses dans les classes moyennes ou
pauvres, et de ces mariages sort une nouvelle génération appelée
par les Arabes « Khodeyryah », c’est-à-dire « les Yerts ».
Ce nom bizarre ne doit pas faire supposer que la peau des mulâtres
de la Péninsule soit d’une couleur semblable à celle des
prairies rafraîchies par la rosée printanière. Dans le langage
familier, les Arabes confondent habituellement le vert, le noir et
le brun, de sorte que les nuances diverses par lesquelles passent
les descendants des « Verts », émeraude, opale, etc., signifient
brun, cuivré, olivâtre. Comme leurs pères, les quarterons sont
exclus ; mais, après quelques générations, le préjugé s efface,
et j ’ai vu plusieurs fils de mulâtres vêtus d’un riche costume,
décorés du titre de cheiks ou d’émirs, qui portaient fièrement
l’épée à poignée d’argent, et comptaient parmi leurs
serviteurs des Arabes du sang ismaélite ou kahtanite le plus
pur. On rencontre dans Riad une foule de kodeyryah qui sont
marchands ou fonctionnaires publics, et je suis obligé de convenir
que, par un travers commun à tous les parvenus, leur
désir d’imiter les grands en fait les plus sombres et les plus désagréables
Wahabites de la ville. Quelques-uns, au contraire,
imitant l’indifférence de leurs ancêtres africains, se rient également
de toutes les sectes musulmanes. « Quel tissu d’absurdités
ils débitent sur la prédestination et les décrets divins! » me
disait un jour un kodeyri libre penseur, qui dans la mosquée
affectait une ferveur édifiante : « Je sens bien pourtant que si je
fais une chose, c’est parce que je le veux, et que si je ne voulais
pas, je ne la ferais pas. » Ce raisonnement, quoique fort simple,
n’était pas facile à réfuter.
La société nedjéenne renferme donc un élément nouveau, qui
exerce sur elle une action puissante. De plus, le caractère de la
population indigène, en dehors de toute influence extérieure,
offre des particularités remarquables. Non-seulement en qualité
de Wahabitc, mais comme Nedjéen, l’habitant de l’Ared, de
l’Afbdj, de l’Yémamah, de l’Harik et du Dowasir diffère profondément
de son compatriote du Shomer et du Kasim, du Woshem
et du Sedeyr. Cette divergence date d’une époque beaucoup plus
ancienne que la réforme de Mohammed-Abdel-Wahab, elle remonte
à l ’origire même de la nationalité arabe.
La population du nord et du centre, à l’exception des cinq
provinces que je viens de nommer, descend des grandes tribus
de Taï, de Waïl, de Mazin, d’Harb, de Kenanah, de Sedous, de
Taghleb, si célèbres dans les annales arabes. Ces clans formaient
la grande confédération qui, cent vingt ans avant Mahomet,
brisa le joug de l’Yémen et conquit l’indépendance du Nedjed.
Des familles kahtanites, les Koda,les Salih,les Kelb, lesModhedj
vinrent aussi se joindre à eux. Les Anezah du désert syrien, les
Shomer de l’Euphrate, ont une origine analogue. Mais depuis la
frontière nord de l’Ared jusqu’au grand Désert ou Dahna, nous
rencontrons un nom nouveau, particulier à cette région. C’est
celui des Tamim, tribu guerrière et nombreuse qui descend de
Nezar et s’établit dans l’Ared, l’Yémamah, l’Afladj, l’Harik et le
Dowasir. Dès la plus haute antiquité, les Benou-Tamim se distinguaient
par des vertus et des défauts dont l’âprd énergie était
tour à tour l’objet de l’admiration enthousiaste et de la mor