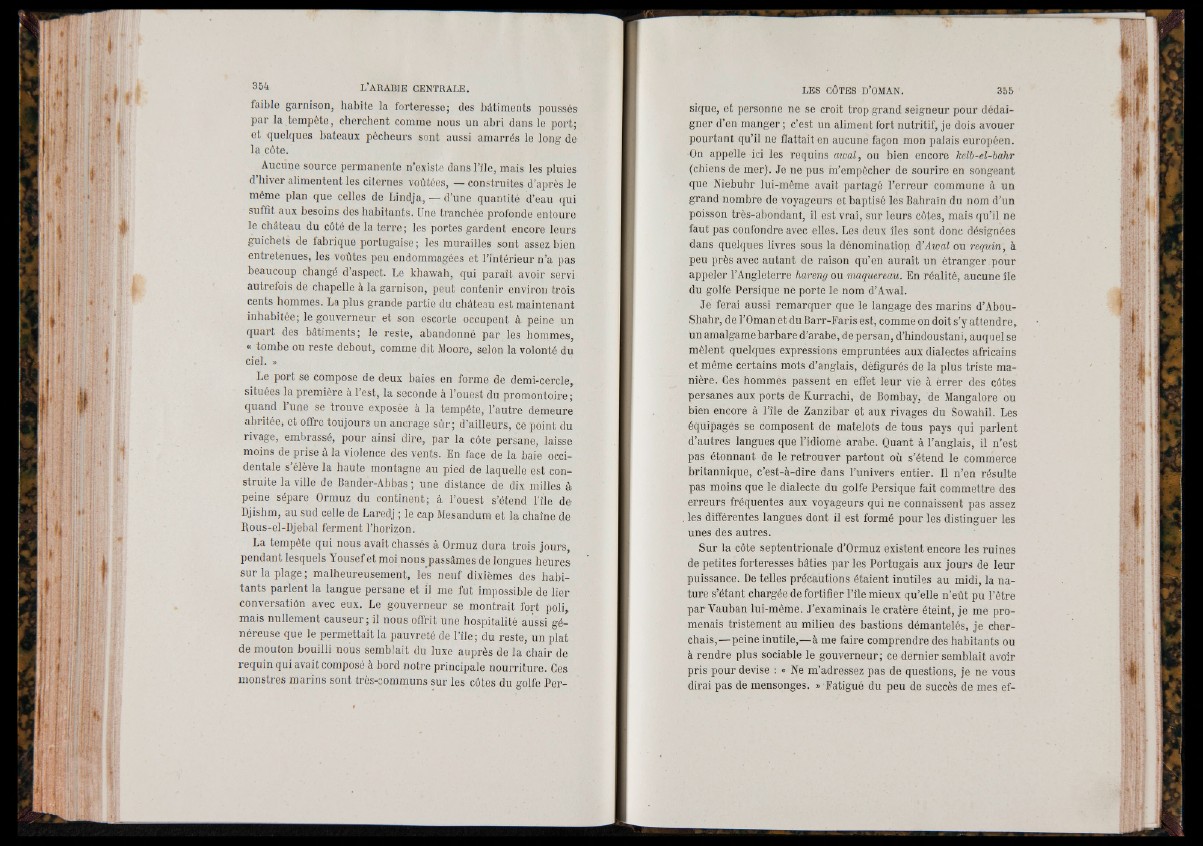
faible garnison, habite la forteresse; des bâtiments poussés
par la tempête, cherchent comme nous un abri dans le port;
et quelques bateaux pêcheurs sont aussi amarrés le long de
la côte.
Aucune source permanente n’existe dans l’île, mais les pluies
d’hiver alimentent les citernes voûtées, — construites d’après le
même plan que celles de Lindja, — d’une quantité d’eau qui
suffit aux besoins des habitants. Une tranchée profonde entoure
le château du côté de la terre; les portes gardent encore leurs
guichets de fabrique portugaise ; les murailles sont assez bien
entretenues, les voûtes peu endommagées et l’intérieur n ’a pas
beaucoup changé d’aspect. Le khawah, qui paraît avoir servi
autrefois de chapelle à la garnison, peut contenir environ trois
cents hommes. La plus grande partie du château est maintenant
inhabitée; le gouverneur et son escorte occupent à peine un
quart des bâtiments; le reste, abandonné par les hommes,
« tombe ou reste debout, comme dit Moore, selon la volonté du
ciel. »
Le port se compose de deux baies en forme de demi-cercle,
situées la première à 1 est, la seconde à l’ouest du promontoire ;
quand l’une se trouve exposée à la tempête, l’autre demeure
abritée, et offre toujours un ancrage sûr; d’ailleurs, ce point du
rivage, embrassé, pour ainsi dire, par la côte persane, laisse
moins de prise à la violence des vents. En face de la baie occidentale
s’élève la haute montagne au pied de laquelle est construite
la ville de Bander-Abbas ; une distance de dix milles à
peine sépare Ormuz du continent; à l’ouest s’étend l'île de
Djishm, au sud celle de Laredj ; le cap Mesandum et la chaîne de
Rous-el-Djebal ferment l’horizon.
La tempête qui nous avait chassés à Ormuz dura trois jours,
pendant lesquels Yousef et moi nous passâmes de longues heures
sur la plage ; malheureusement, les neuf dixièmes des habitants
parlent la langue persane et il me fut impossible de lier
conversatiôn avec eux. Le gouverneur se montrait fort poli,
mais nullement causeur; il nous offrit une hospitalité aussi généreuse
que le permettait la pauvreté de l’île; du reste, un plat
de mouton bouilli nous semblait du luxe auprès de la chair de
requin qui avait composé à bord notre principale nourriture. Ces
monstres marins sont très-communs sur les côtes du golfe Persique,
et personne ne se croit trop grand seigneur pour dédaigner
d’en manger ; c’est un aliment fort nutritif, je dois avouer
pourtant qu’il ne flattait en aucune façon mon palais européen.
On appelle ici les requins awal, ou bien encore kelb-el-bahr
(chiens de mer). Je ne pus m’empêcher de sourire en songeant
que Niebuhr lui-même avait partagé l’erreur commune à un
grand nombre de voyageurs et baptisé les Bahraïn du nom d’un
poisson très-abondant, il est vrai, sur leurs côtes, mais qu’il ne
faut pas confondre avec elles. Les deux îles sont donc désignées
dans quelques livres sous la dénomination d’Awal ou requin, à
peu près avec autant de raison qu’en aurait un étranger pour
appeler l’Angleterre hareng ou maquereau. En réalité, aucune île
du golfe Persique ne porte le nom d’Awal.
Je ferai aussi remarquer que le langage des marins d’Abou-
Shahr, de l’Oman et du Barr-Faris est, comme on doit s’y attendre,
un amalgame barbare d’arabe, de persan, d’hindoustani, auquel se
mêlent quelques expressions empruntées aux dialectes africains
et même certains mots d’anglais, défigurés de la plus triste manière.
Ces hommes passent en effet leur vie à èrrer des côtes
persanes aux ports de Kurrachi, de Bombay, de Mangalore ou
bien encore à l’île de Zanzibar et aux rivages du Sowahil. Les
équipages se composent de matelots de tous pays qui parlent
d’autres langues que l’idiome arabe. Quant à l’anglais, il n’est
pas étonnant de le retrouver partout où s’étend le commerce
britannique, c’est-à-dire dans l’univers entier. Il n’en résulte
pas moins que le dialecte du golfe Persique fait commettre des
erreurs fréquentes aux voyageurs qui ne connaissent pas assez
les différentes langues dont il est formé pour les distinguer les
unes des autres.
Sur la côte septentrionale d’Ormuz existent encore les ruines
de petites forteresses bâties par les Portugais aux jours de leur
puissance. De telles précautions étaient inutiles au midi, la nature
s’étant chargée de fortifier l’île mieux qu’elle n’eût pu l’être
par Vauban lui-même. J’examinais le cratère éteint, je me promenais
tristement au milieu des bastions démantelés, je cherchais,—
peine inutile,—à me faire comprendre des habitants ou
à rendre plus sociable le gouverneur; ce dernier semblait avoir
pris pour devise : « Ne m’adressez pas de questions, je ne vous
dirai pas de mensonges. » Fatigué du peu de succès de mes ef