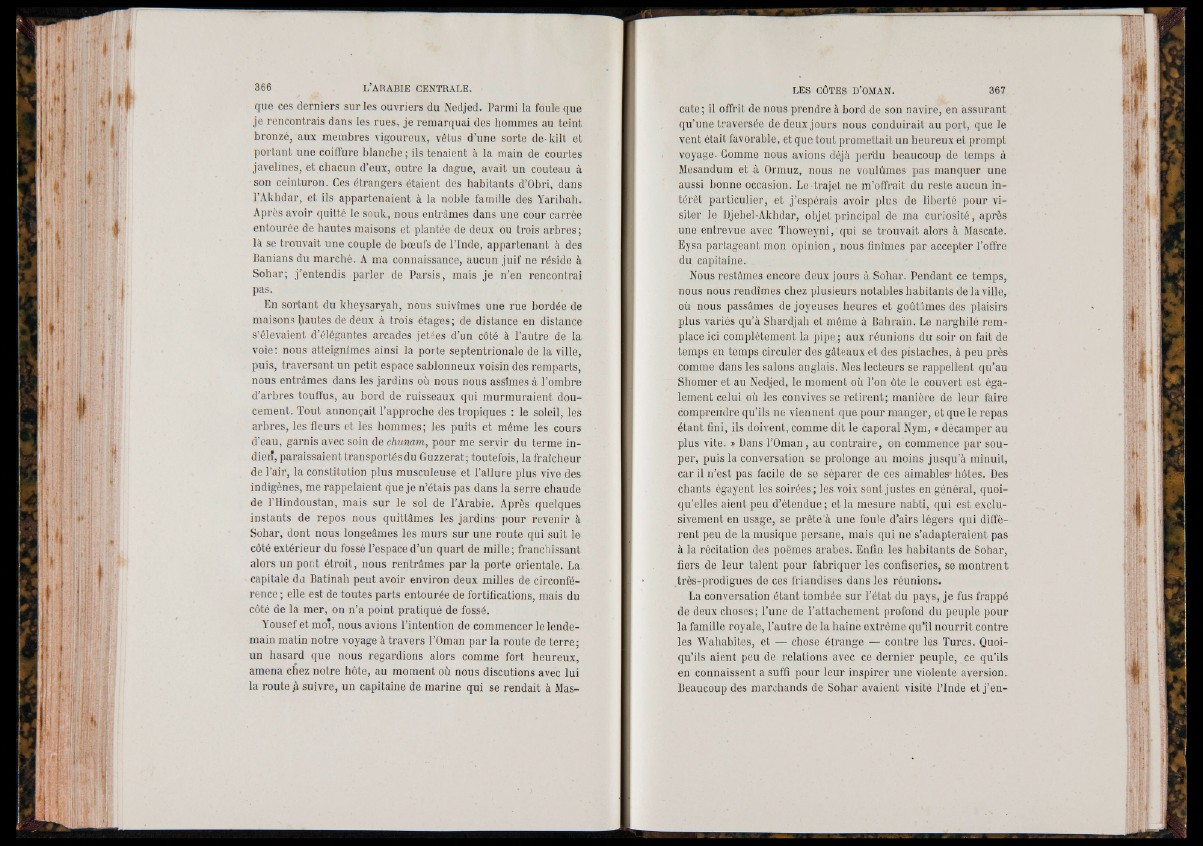
que ces derniers sur les ouvriers du Nedjed. Parmi la foule que
je rencontrais dans les rues, je remarquai des hommes au teint
bronzé, aux membres vigoureux, vêtus d’une sorte de-kilt et
portant une coiffure blanche ; ils tenaient à la main de courtes
javelines, et chacun d’eux, outre la dague, avait un couteau à
■ son ceinturon. Ces étrangers étaient des habitants d’Obri, dans
l’Akhdar, et ils appartenaient à la noble famille des Yaribah.
Après avoir quitté le souk, nous entrâmes dans une cour carrée
entourée de hautes maisons et plantée de deux ou trois arbres ;
là se trouvait une couple de boeufs de l’Inde, appartenant à des
Banians du marché. A ma connaissance, aucun juif ne réside à
Sohar; j’entendis parler de Parsis, mais je n’en rencontrai
pas.
En sortant du kheysaryah, nous suivîmes une rue bordée de
maisons hautes de deux à trois étages ; de distance en distance
s’élevaient d’élégantes arcades jetées d’un côté à l’autre de la
voie: nous atteignîmes ainsi la porte septentrionale de la ville,
puis, traversant un petit espace sablonneux voisin des remparts,
nous entrâmes dans les jardins où nous nous assîmes à l’ombre
d’arbres touffus, au bord de ruisseaux qui murmuraient doucement.
Tout annonçait l’approche des tropiques : le soleil, les
arbres, les fleurs et les hommes; les puits et même les cours
d’eau, garnis avec soin de chunam, pour me servir du terme indien,
paraissaient transportés du Guzzerat; toutefois, la fraîcheur
de l’air, la constitution plus musculeuse et l’allure plus vive des
indigènes, me rappelaient que je n’étais pas dans la serre chaude
de l’Hindoustan, mais sur le sol de l’Arabie. Après quelques
instants de repos nous quittâmes les jardins pour revenir à
Sohar, dont nous longeâmes les murs sur une route qui suit le
côté extérieur du fossé l’espace d’un quart de mille ; franchissant
alors un pont étroit, nous rentrâmes par la porte orientale. La-
capitale du Batinah peut avoir environ deux milles de circonférence
; elle est de toutes parts entourée de fortifications, mais du
côté de la mer, on n’a point pratiqué de fossé.
Yousef et moi, nous avions l’intention de commencer le lendemain
matin notre voyage à travers l’Oman par la route de terre ;
un hasard que nous regardions alors comme fort heureux,
amena chez notre hôte, au moment où nous discutions avec lui
la route ,à suivre, un capitaine de marine qui se rendait à Mascate;
il offrit de nous prendre à bord de son navire, en assurant
qu’une traversée de deux jours nous conduirait au port, que le
vent était favorable, et que tout promettait un heureux et prompt
voyage. Comme nous avions déjà perdu beaucoup de temps à
Mesandum et à Ormuz, nous ne voulûmes pas manquer une
aussi bonne occasion. Le trajet ne m’offrait du reste aucun intérêt
particulier, et j ’espérais avoir plus de liberté pour visiter
le Djebel-Akhdar, objet principal de ma curiosité, après
une entrevue avec Thoweyni,'qui se trouvait alors à Mascate.
Eysa partageant mon opinion, nous finîmes par accepter l’offre
du capitaine.
Nous restâmes encore deux jours à Sohar. Pendant ce temps,
nous nous rendîmes chez plusieurs notables habitants de la ville,
où nous passâmes de joyeuses heures et goûtâmes des plaisirs
plus variés qu’à Shardjah et même à Bahraïn. Le narghilé remplace
ici complètement La pipe ; aux réunions du soir on fait de
temps en temps circuler des gâteaux et des pistaches, à peu près
comme dans les salons anglais. Mes lecteurs se rappellent qu’au
Shomer et au Nedjed, le moment ou l’on ôte le couvert est également
celui où les convives se retirent; manière de leur faire
comprendre qu’ils ne viennent que pour manger, et que le repas
étant fini, ils doivent, comme dit le caporal Nym, <r décamper au
plus vite. » Dans l’Oman, au contraire, on commence par souper,
puis la conversation se prolonge au moins jusqu’à minuit,
car il n’est pas facile de se séparer de ces aimables* hôtes. Des
chants égayent les soirées; les voix sont justes en général, quoiqu’elles
aient peu d’étendue ; et la mesure nabti, qui est exclusivement
en usage, se prête "à une foule d’airs légers qui diffèrent
peu de la musique persane, mais qui ne s’adapteraient pas
à la récitation des poèmes arabes. Enfin les habitants de Sohar,
fiers de leur talent pour fabriquer les confiseries, se montrent
très-prodigues de ces friandises dans les réunions.
La conversation étant tombée sur l’état du pays, je fus frappé
de deux choses; l’une de l’attachement profond du peuple pour
là famille royale, l’autre de la haine extrême qu’il nourrit contre
les Wahabites, et — chose étrange — contre les Turcs. Quoiqu’ils
aient peu de relations avec ce dernier peuple, ce qu’ils
en connaissent a suffi pour leur inspirer une violente aversion.
Beaucoup des marchands de Sohar avaient visité l’Inde et j’en