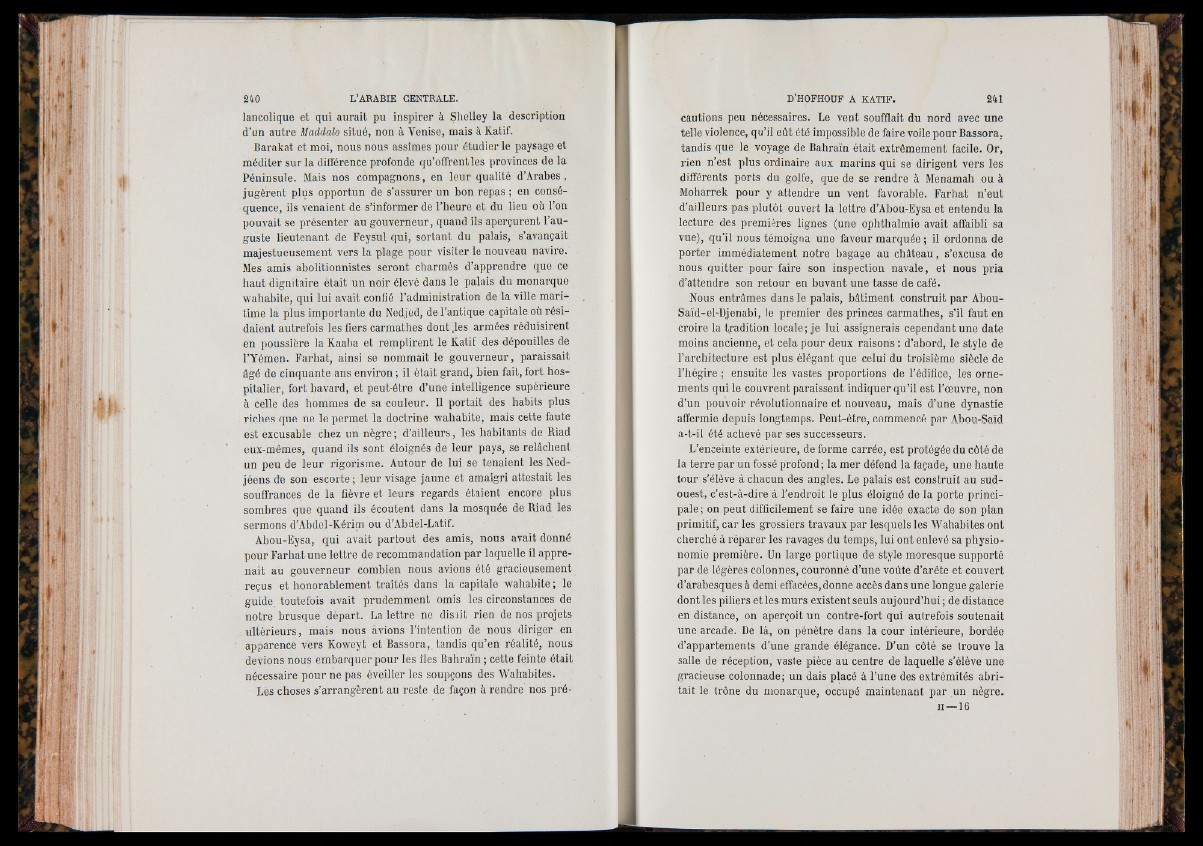
lancolique et qui aurait pu inspirer à Shelley la description
d’un autre Maddalo situé, non à Venise, mais à Katif.
Barakat et moi, nous nous assîmes pour étudier le paysage et
méditer sur la différence profonde qu’offrent les provinces de la
Péninsule. Mais nos compagnons, en leur qualité d’Arabes,
jugèrent plus opportun de s’assurer un bon repas ; en conséquence,
ils venaient de s’informer de l’heure et du lieu oh l’on
pouvait se présenter au gouverneur, quand ils aperçurent l’auguste
lieutenant de Feysul qui, sortant du palais, s’avançait
majestueusement vers la plage pour visiter le nouveau navire.
Mes amis abolitionnistes seront charmés d’apprendre que ce
haut dignitaire était un noir élevé dans le palais du monarque
wahabite, qui lui avait confié l’administration de la ville maritime
la plus importante du Nedjed, de l’antique capitale où résidaient
autrefois les fiers carmathes dont ;les armées réduisirent
en poussière la Kaaba et remplirent le Katif des dépouilles de
l’Yémen. Farhat, ainsi se nommait le gouverneur, paraissait
âgé de cinquante ans environ ; il était grand, bien fait, fort hospitalier,
fort bavard, et peut-être d’une intelligence supérieure
à celle des hommes de sa couleur. Il portait des habits plus
riches que ne le permet la doctrine wahabite, mais cette faute
est excusable chez un nègre; d’ailleurs, les habitants de Riad
eux-mêmes, quand ils sont éloignés de leur pays, se relâchent
un peu de leur rigorisme. Autour de lui se tenaient les Ned-
jéens de son escorte; leur visage jaune et amaigri attestait les
souffrances de la fièvre et leurs regards étaient encore plus
sombres que quand ils écoutent dans la mosquée de Riad les
sermons d’Abdel-Kérim ou d’Abdel-Latif.
Abou-Eysa, qui avait partout des amis, nous avait donné
pour Farhat une lettre de recommandation par laquelle il apprenait
au gouverneur combien nous avions été gracieusement
reçus et honorablement traités dans la capitale wahabite ; le
guide, toutefois avait prudemment omis les circonstances de
notre brusque départ. La lettre ne disait rien de nos projets
ultérieurs, mais nous avions l’intention de nous diriger en
apparence vers Koweyt et Bassora,, tandis qü’eh réalité, nous
devions nous embarquer pour les îles Bahraïn; cette feinte était
nécessaire pour ne pas éveiller les soupçons des Wahabites.
Lès choses s’arrangèrent au reste de façon à rendre nos précautions
peu nécessaires. Le vent soufflait du nord avec une
telle violence, qu’il eût été impossible de faire voile pour Bassora,
tandis que le voyage de Bahraïn était extrêmement facile. Or,
rien n’est plus ordinaire aux marins qui se dirigent vers les
différents ports du golfe, que de se rendre à Menamah ou à
Moharrek pour y attendre un vent favorable. Farhat n’eut
d’ailleurs pas plutôt ouvert la lettre d’Abou-Eysa et entendu la
lecture des premières lignes (une ophthalmie avait affaibli sa
vue), qu’il nous témoigna une faveur marquée ; il ordonna de
porter immédiatement notre bagage au château, s’excusa de
nous quitter pour faire son inspection navale, et nous pria
d’attendre son retour en buvant une tasse de café.
Nous entrâmes dans le palais, bâtiment construit par Abou-
Saïd-el-Djenabi, le premier des princes carmathes, s’il faut en
croire la tradition locale; je lui assignerais cependant une date
moins ancienne, et cela pour deux raisons : d’abord, le style de
l’architecture est plus élégant que celui du troisième siècle de
l’hégire ; ensuite les vastes proportions de l’édifice, les ornements
qui le couvrent paraissent indiquer qu’il est l’oeuvre, non
d’un pouvoir révolutionnaire et nouveau, mais d’une dynastie
affermie depuis longtemps. Peut-être, commencé par Abou-Saïd
a-t-il été achevé par ses successeurs.
L’enceinte extérieure, de forme carrée, est protégée du côté de
la terre par un fossé profond ; la mer défend la façade, une haute
tour s’élève à chacun des angles. Le palais est construit au sud-
ouest, c’est-à-dire à l’endroit le plus éloigné de la porte principale;
on peut difficilement se faire une idée exacte de son plan
primitif, car les grossiers travaux par lesquels les Wahabites ont
cherché à réparer les ravages du temps, lui ont enlevé sa physionomie
première. Un large portique de style moresque supporté
par de légères colonnes, couronné d’une voûte d’arête et couvert
d’arabesques à demi effacées, donne accès dans une longue galerie
dont les piliers et les murs existent seuls aujourd’hui ; de distance
en distance, on aperçoit un contre-fort qui autrefois soutenait
une arcade. De là, on pénètre dans la cour intérieure, bordée
d’appartements d’une grande élégance. D’un côté se trouve la
salle de réception, vasle pièce au centre de laquelle s’élève une
gracieuse colonnade; un dais placé à l’une des extrémités abritait
le trône du monarque, occupé maintenant par un nègre.
n — 16