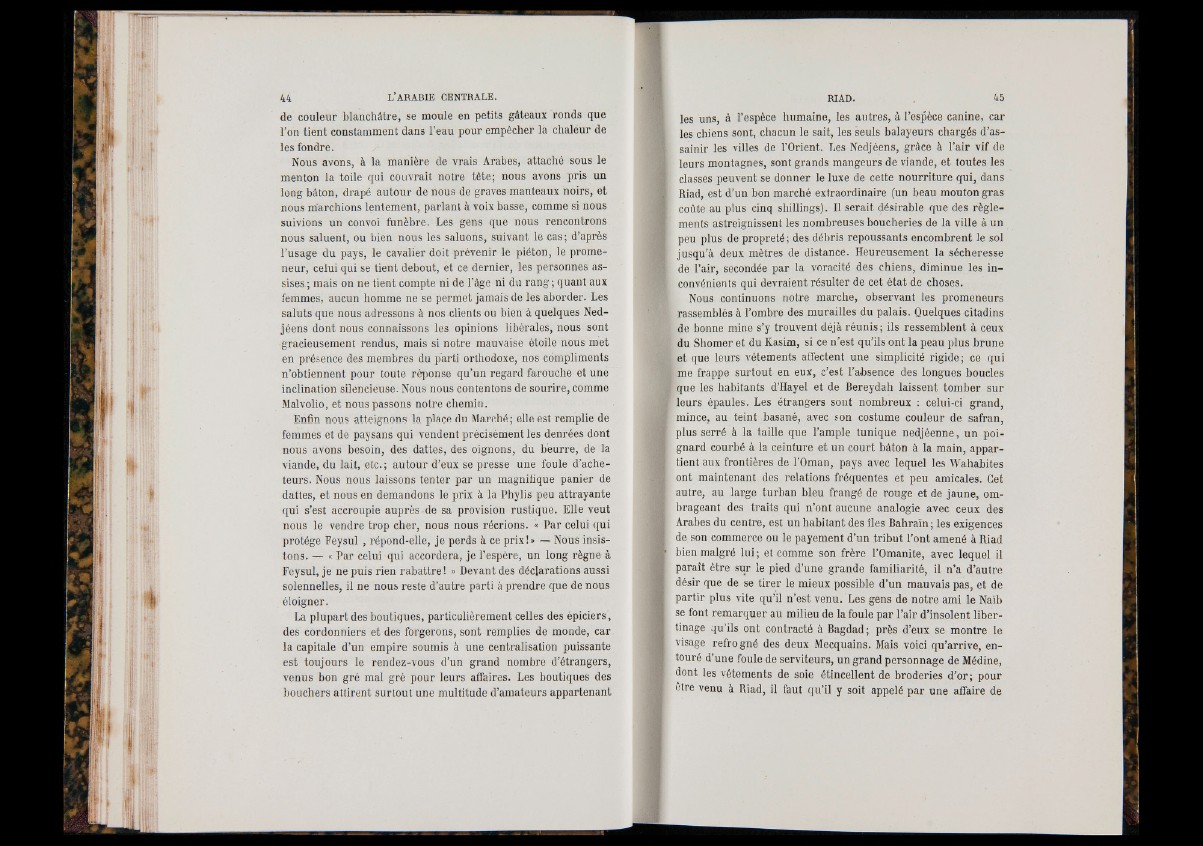
de couleur blanchâtre, se moule en petits gâteaux ronds que
l’on tient constamment dans l’eau pour empêcher la chaleur de
les fondre.
Nous avons, à la manière de vrais Arabes, attaché sous le
menton la toile qui couvrait notre tête; nous avons pris un
long bâton, drapé autour de nous de graves manteaux noirs, et
nous m'archions lentement, parlant à voix basse, comme si nous
suivions un convoi funèbre. Les gens que nous rencontrons
nous saluent, ou bien nous les saluons, suivant le cas ; d’après
l’usage du pays, le cavalier doit prévenir le piéton, le promeneur,
celui qui se tient debout, et ce dernier, les personnes assises.;
mais on ne tient compte ni de l’âge ni du rang ; quant aux
femmes, aucun homme ne se permet jamais de les aborder. Les
saluts que nous adressons à nos clients ou bien à quelques Ned-
jéens dont nous connaissons les opinions libérales, nous sont
gracieusement rendus, mais si notre mauvaise étoile nous met
en présence des membres du parti orthodoxe, nos compliments
n ’obtiennent pour toute réponse qu’un regard farouche et une
inclination silencieuse. Nous nous contentons de sourire, comme
Malvolio, et nous passons notre chemin.
Enfin nous atteignons la place du Marché ; elle est remplie de
femmes et de paysans qui vendent précisément les denrées dont
nous avons besoin, des dattes, des oignons, du beurre, de la
viande, du lait, etc.; autour d’eux se presse une foule d’acheteurs.
Nous nous laissons tenter par un magnifique panier de
dattes, et nous en demandons le prix à la Phylis peu attrayante
qui s’est accroupie auprès,de sa provision rustique. Elle veut
nous le vendre trop cher, nous nous récrions. « Par celui qui
protège Peysul , répond-elle, je perds à ce prix!» — Nous insistons.
— « Par celui qui accordera, je l’espère, un long règne à
Feysul, je ne puis rien rabattre! » Devant des déclarations aussi
solennelles, il ne nous reste d’autre parti à prendre que de nous
éloigner.
La plupart des boutiques, particulièrement celles des épiciers,
des cordonniers et des forgerons, sont remplies de monde, car
la capitale d’un empire soumis à une centralisation puissante
est toujours le rendez-vous d’un grand nombre d’étrangers,
venus bon gré mal gré pour leurs affaires. Les boutiques des
bouchers attirent surtout une multitude d’amateurs appartenant
les uns, à l’espèce humaine, les autres, à l’espèce canine, car
les chiens sont, chacun le sait, les seuls balayeurs chargés d’assainir
les villes de l’Orient. Les Nedjéens, grâce à l’air vif de
leurs montagnes, sont grands mangeurs de viande, et toutes les
classes peuvent se donner le luxe de cette nourriture qui, dans
Riad, est d’un bon marché extraordinaire (un beau mouton gras
coûte au plus cinq shillings). Il serait désirable que des règlements
astreignissent les nombreuses boucheries de la ville à un
peu plus de propreté; des débris repoussants encombrent le sol
jusqu’à deux mètres de distance. Heureusement la sécheresse
de l’air, secondée par la voracité des chiens, diminue les inconvénients
qui devraient résulter de cet état de choses.
Nous continuons notre marche, observant les promeneurs
rassemblés à l’ombre des murailles du palais. Quelques citadins
de bonne mine s’y trouvent déjà réunis; ils ressemblent à ceux
du Shomer et du Kasim, si ce n’est qu’ils ont la peau plus brune
et que leurs vêtements affectent une simplicité rigide; ce qui
me frappe surtout en eux, c’est l’absence des longues boucles
que les habitants d’Hayel et de Bereydah laissent tomber sur
leurs épaules. Les étrangers sont nombreux : celui-ci grand,
mince, au teint basané, avec son costume couleur de safran,
plus serré à la taille que l’ample tunique nedjéenne, un poignard
courbé à la ceinture et un court bâton à la main, appartient
aux frontières de l’Oman, pays avec lequel les Wahabites
ont maintenant des relations fréquentes et peu amicales. Cet
autre, au large turban bleu frangé de rouge et de jaune, ombrageant
des traits qui n’ont aucune analogie avec ceux des
Arabes du centre, est un habitant des îles Bahraïn ; les exigences
de son commerce ou le payement d’un tribut l’ont amené à Riad
bien malgré lui ; et comme son frère l’Omanite, avec lequel il
paraît être sur le pied d’une grande familiarité, il n’a d’autre
désir que de se tirer le mieux possible d’un mauvais pas, et de
partir plus vite qu’il n’est venu. Les gens de notre ami le Naïb
se font remarquer au milieu de la foule par l’air d’insolent libertinage
qu’ils ont contracté à Bagdad; près d’eux se montre le
visage refrogné des deux Mecquains. Mais voici qu’arrive, entouré
d’une foule de serviteurs, un grand personnage de Médine,
dont les vêtements de soie étincellent de broderies d’or; pour
être venu à Riad, il faut qu’il y soit appelé par une affaire de