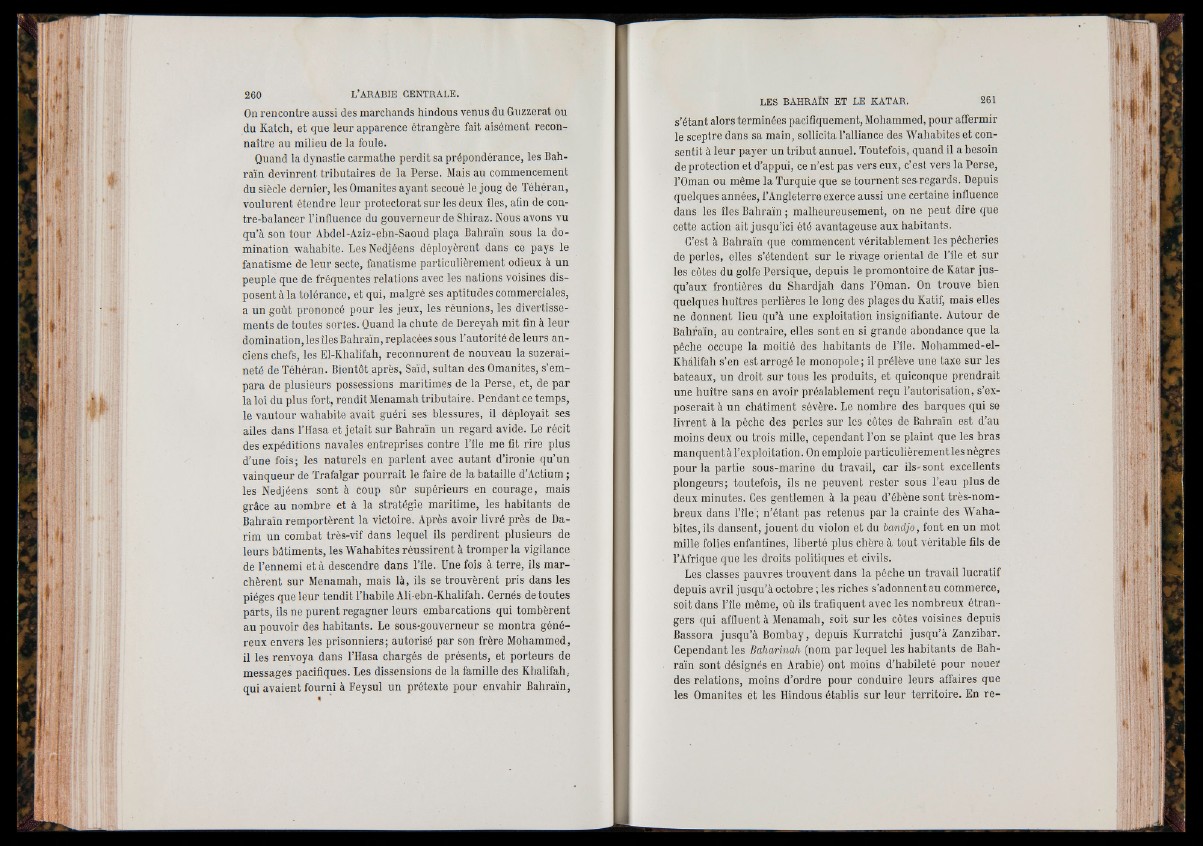
On rencontre aussi des marchands hindous venus du Guzzerat ou
du Katch, et que leur apparence étrangère fait aisément reconnaître
au milieu de la foule.
Quand la dynastie carmathe perdit sa prépondérance, les Bahraïn
devinrent tributaires de la Perse. Mais au commencement
du siècle dernier, les Omanites ayant secoué le joug de Téhéran,
voulurent étendre leur protectorat sur les deux îles, afin de con-
tre-balancer l’influence du gouverneur de Shiraz. Nous avons vu
qu’à son tour Abdel-Aziz-ebn-Saoud plaça Bahraïn sous la domination
wahabite. LesNedjéens déployèrent dans ce pays le
fanatisme de leur secte, fanatisme particulièrement odieux à un
peuple que de fréquentes relations avec les nations voisines disposent
à la tolérance, et qui, malgré ses aptitudes commerciales,
a un goût prononcé pour les jeux, les réunions, les divertissements
de toutes sortes. Quand la chute de Dereyah mit fin à leur
domination, les îles Bahraïn, replacées sous l’autorité de leurs anciens
chefs, les El-Khalifah, reconnurent de nouveau la suzeraineté
de Téhéran. Bientôt après, Saïd, sultan des Omanites, s’empara
de plusieurs possessions maritimes de la Perse, et, de par
la loi du plus fort, rendit Menamah tributaire. Pendant ce temps,
le vautour wahabite avait guéri ses blessures, il déployait ses
ailes dans l’Hasa et jetait sur Bahraïn un regard avide. Le récit
des expéditions navales entreprises contre l’île me fit rire plus
d’une fois; les naturels en parlent avec autant d’ironie qu’un
vainqueur de Trafalgar pourrait le faire de la bataille d’Actium ;
les Nedjéens sont à coup sûr supérieurs en courage, mais
grâce au nombre et à la stratégie maritime, les habitants de
Bahraïn remportèrent la victoire. Après avoir livré près de Da-
rim un combat très-vif dans lequel ils perdirent plusieurs de
leurs bâtiments, les Wahabites réussirent à tromper la vigilance
de l’ennemi et à descendre dans l’île. Une fois à terre, ils marchèrent
sur Menamah, mais là, ils se trouvèrent pris dans les
pièges que leur tendit l’habile Ali-ebn-Khalifah. Cernés de toutes
parts, ils ne purent regagner leurs embarcations qui tombèrent
au pouvoir des habitants. Le sous-gouverneur se montra généreux
envers les prisonniers; autorisé par son frère Mohammed,
il les renvoya dans l’Hasa chargés de présents, et porteurs de
messages pacifiques. Les dissensions de la famille des Khalifah,
qui avaient fourni à Feysul un prétexte pour envahir Bahraïn,
s’étant alors terminées pacifiquement, Mohammed, pour affermir
le sceptre dans sa main, sollicita l’alliance des Wahabites et consentit
à leur payer un tribut annuel. Toutefois, quand il a besoin
de protection et d’appui, ce n’est pas vers eux, c’est vers la Perse,
l’Oman ou même la Turquie que se tournent ses.regards. Depuis
quelques années, l’Angleterre exerce aussi une certaine influence
dans les îles Bahraïn ; malheureusement, on ne peut dire que
cette action ait jusqu’ici été avantageuse aux habitants.
C’est à Bahraïn que commencent véritablement les pêcheries
de perles, elles s’étendent sur le rivage oriental de l’île et sur
les côtes du golfe Persique, depuis le promontoire de Katar jusqu’aux
frontières du Shardjah dans l’Oman. On trouve bien
quelques huîtres perlières le long des plages du Katif, mais elles
ne donnent lieu qu’à une exploitation insignifiante. Autour de
Bahraïn, au contraire, elles sont en si grande abondance que la
pêche occupe la moitié des habitants de l’île. Mohammed-el-
Khàlifah s’en est arrogé le monopole ; il prélève une taxe sur les
bateaux, un droit sur tous les produits, et quiconque prendrait
une huître sans en avoir préalablement reçu l’autorisation, s’exposerait
à un châtiment sévère. Le nombre des barques qui se
livrent à la pêche des perles sur les côtes de Bahraïn est d’au
moins deux ou trois mille, cependant l’on se plaint que les bras
manquent à l’exploitation. On emploie particulièrement les nègres
pour la partie sous-marine du travail, car ils-sont excellents
plongeurs; toutefois, ils ne peuvent rester sous l’eau plus de
deux minutes. Ces gentlemen à la peau d’ébène sont très-nombreux
dans l’île ; n’étant pas retenus par la crainte des Wahabites,
ils dansent, jouent du violon et du bandjo, font en un mot
mille folies enfantines, liberté plus chère à tout véritable fils de
l’Afrique que les droits politiques et civils.
Les classes pauvres trouvent dans la pêche un travail lucratif
depuis avril jusqu’à octobre ; les riches s’adonnent au commerce,,
soit dans l’île même, où ils trafiquent avec les nombreux étrangers
qui affluent à Menamah, soit sur les côtes voisines depuis
Bassora jusqu’à Bombay, depuis Kurratchi jusqu’à Zanzibar.
Cependant les Baharinah (nom par lequel les habitants de Bahraïn
sont désignés en Arabie) ont moins d’habileté pour nouer
des relations, moins d’ordre pour conduire leurs affaires que
les Omanites et les Hindous établis sur leur territoire. En re