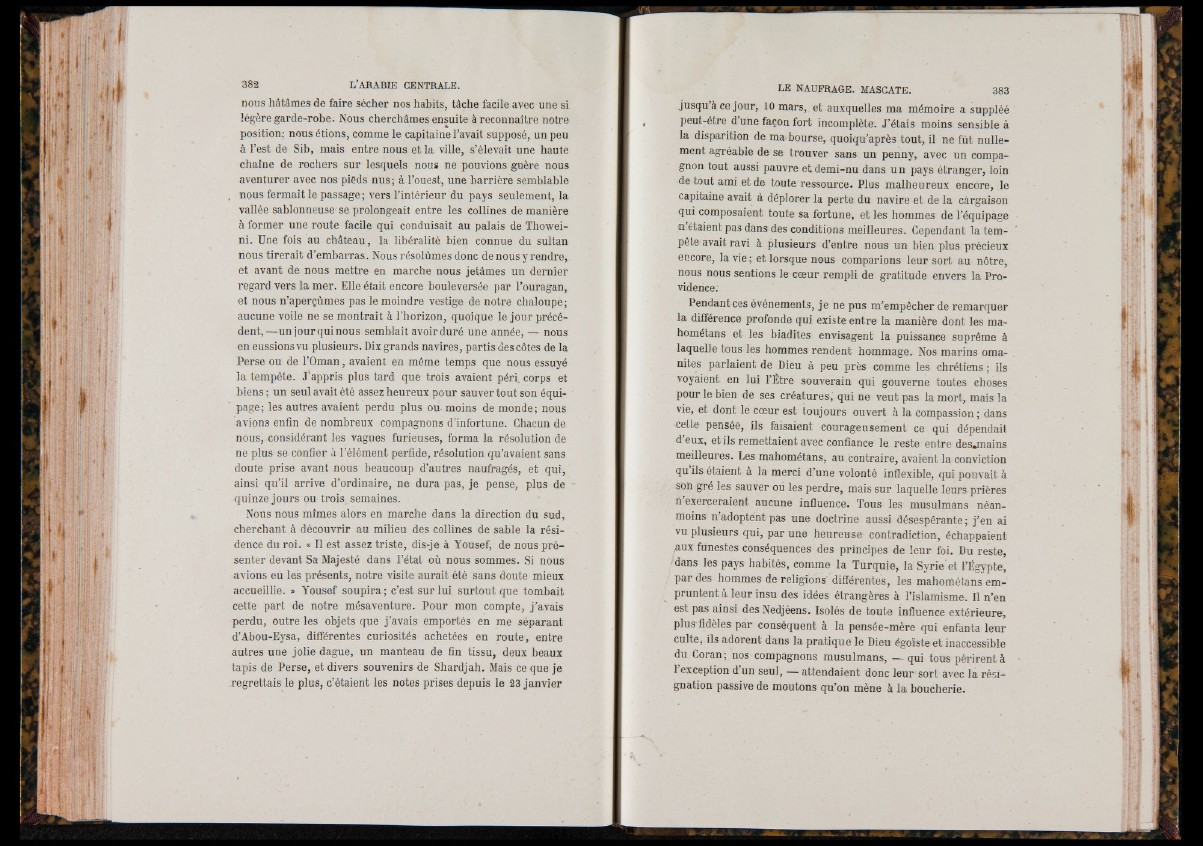
nous hâtâmes de faire sécher nos habits, tâche facile avec une si
légère garde-robe. Nous cherchâmes ensuite * à reconnaître notre
position; nous étions, comme le capitaine l’avait supposé, un peu
à l’est de Sib, mais entre nous et la ville, s’élevait une haute
chaîne de rochers sur lesquels nous ne pouvions guère nous
aventurer avec nos pieds nus; à l’ouest, une barrière semblable
, nous fermait le passage; vers l’intérieur du pays seulement, la
vallée sablonneuse1 se prolongeait entre les collines de manière
à former une route facile qui conduisait au palais de Thowei-
ni. Une fois au château, la libéralité bien connue du sultan
nous tirerait d’embarras. Nous résolûmes donc de nous y rendre,
et avant de nous mettre en marche nous jetâmes un dernier
regard vers la mer. Elle était encore bouleversée par l’ouragan,
et nous n’aperçûmes pas le moindre vestige de notre chaloupe;
aucune voile ne se montrait à l’horizon, quoique le jour précédent,—
un jour qui nous semblait avoir duré une année, — nous
en eussions vu plusieurs. Dix grands navires, partis des côtes de la
Perse ou de l’Oman, avaient en même temps que nous essuyé
la tempête. J ’appris plus tard que trois avaient péri, corps et
biens ; un seul avait été assez heureux pour sauver tout son équipage;
les autres avaient perdu plus ou- moins de monde ; nous
avions enfin de nombreux compagnons d’infortune. Chacun de
nous, considérant les vagues furieuses, forma la résolution de
ne plus se confier à l’élément perfide, résolution qu’avaient sans
doute prise avant nous beaucoup d’autres naufragés, et qui,
ainsi qu’il arrive d’ordinaire, ne dura pas, je pense, plus de
quinze jours ou trois, semaines.
Nous nous mîmes alors en marche dans la direction du sud,
cherchant à découvrir au milieu des collines de sable la résidence
du roi. « Il est assez triste, dis-je à Yousef, de nous présenter
devant Sa Majesté dans l’état où nous sommes. Si nous
avions eù les présents, notre visite aurait été sans doute mieux
accueillie. » Yousef soupira; c’est sur lui surtout que tombait
cette part de notre mésaventure. Pour mon compte, j ’avais
perdu, outre les objets que j ’avais emportés en me séparant
d’Abou-Eysa, différentes curiosités achetées en route, entre
autres une jolie dague, un manteau de fin tissu, deux beaux
tapis de Perse, et divers souvenirs de Shardjah. Mais ce que je
regrettais le plus, c’étaient les notes prises depuis le 23 janvier
jusqu à ce jour, 10 mars, et auxquelles ma mémoire a suppléé
peut-être d une façon fort incomplète. J’étais moins sensible à
la disparition de ma bourse, quoiqu’après tout, il ne fût nullement
agréable de se trouver sans un penny, avec un compagnon
tout aussi pauvre et demi-nu dans u n pays étranger, loin
de tout ami et de toute ressource. Plus malheureux encore, le
capitaine avait à déplorer la perte du navire et de la cargaison
qui composaient toute sa fortune, et les hommes de l’équipage
n étaient pas dans des conditions meilleures. Cependant la tempête
avait ravi à plusieurs d’entre nous un bien plus précieux
encore, la vie ; et lorsque nous comparions leur sort au nôtre,
nous nous sentions le coeur rempli de gratitude envers la Providence;
Pendant ces événements, je ne pus m’empêcher de remarquer
la différence profonde qui existe entre la manière dont les ma-
hométans et les biadites envisagent la puissance suprême à
laquelle tous les hommes rendent hommage. Nos marins oma-
nites parlaient de Dieu à peu près comme les chrétiens ; ils
voyaient en lui l’Être souverain qui gouverne toutes choses
pour le bien de ses créatures, qui ne veut pas la mort, mais la
vie, et dont le coeur est toujours ouvert à la compassion; dans
-cette pensée, ils faisaient courageusement ce qui dépendait
d eux, et ils remettaient avec confiance le reste entre desjnains
meilleures. Les mahométans, au contraire, avaient la, conviction
qu ils étaient à la merci d’une volonté inflexible, qui pouvait à
son gré les sauver ou les perdre, mais sur laquelle leurs prières
n exerceraient aucune influence. Tous les musulmans néanmoins
n adoptent pas une doctrine aussi désespérante ; j’en ai
vu plusieurs qui, par une heureuse contradiction, échappaient
¡aux funestes conséquences des principes de leur foi. Du reste,
•dans les pays habités, comme la Turquie, la Syrie'et l’Égypte,
par des hommes de religions' différentes, les mahométans empruntent
à leur insu des idées étrangères à l’islamisme. Il n’en
est pas ainsi des Nedjéens. Isolés de toute influence extérieure,
plus fidèles par conséquent à la pensée-mère qui enfanta leur
culte, ils adorent dans la pratique le Dieu égoïste et inaccessible
du Coran; nos compagnons musulmans, — qui tous périrent à
1 exception d un seul, — attendaient donc leur sort avec la résignation
passive de moutons qu’on mène à la boucherie.