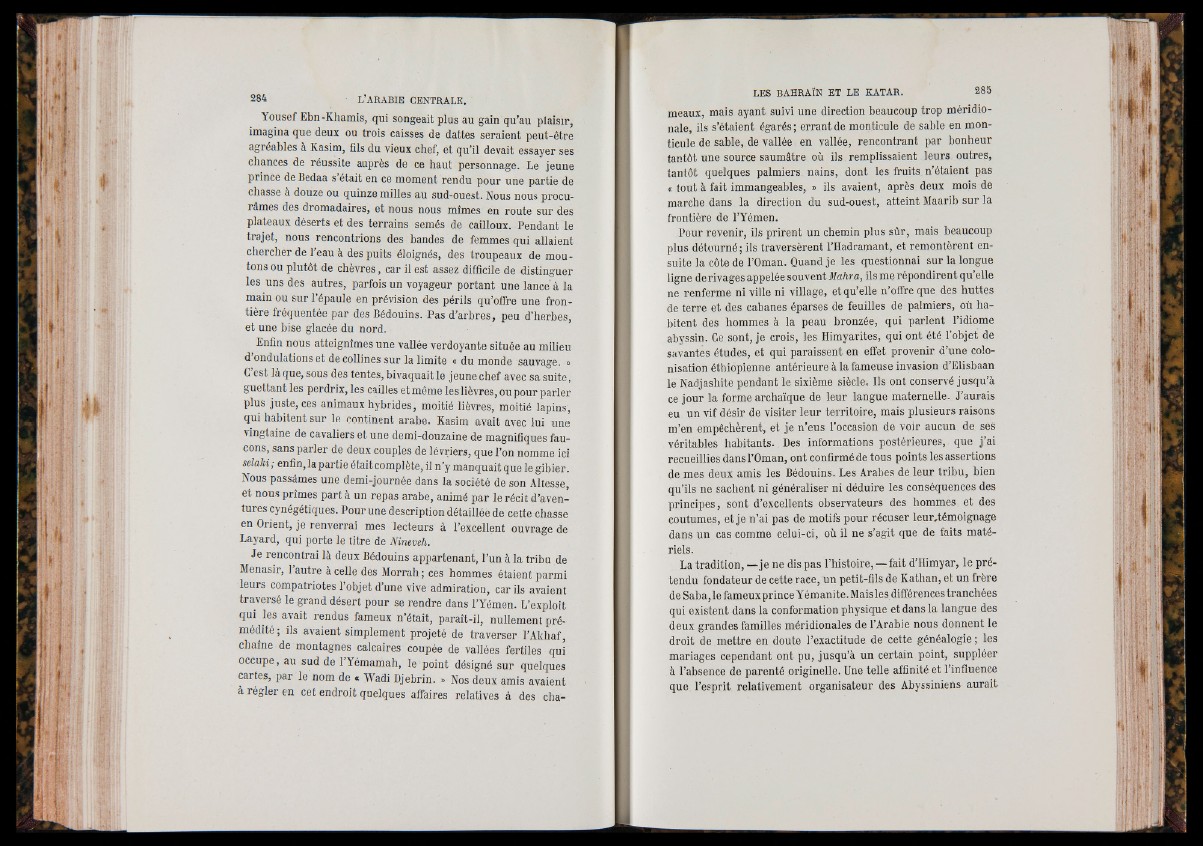
Yousef Ebn-Khamis, qui songeait plus au gain qu’au plaisir,
imagina que deux ou trois caisses de dattes seraient peut-être
agréables à Kasim, fils du vieux chef, et qu’il devait essayer ses
chances de réussite auprès de ce haut personnage. Le jeune
prince de Bedaa s était en ce moment rendu pour une partie de
chasse à douze ou quinze milles au sud-ouest. Nous nous procurâmes
des dromadaires, et nous nous mîmes en route sur des
plateaux déserts et des terrains semés de cailloux. Pendant le
trajet, nous rencontrions des bandes de femmes qui allaient
chercher de l’eau à des puits éloignés, des troupeaux de moutons
ou plutôt de chèvres, car il est assez difficile de distinguer
les uns des autres, parfois un voyageur portant une lance à la
main ou sur l’épaule en prévision des périls qu’offre une frontière
fréquentée par des Bédouins. Pas d’arbres, peu d’herbes,
et une bise glacée du nord.
Enfin nous atteignîmes une vallée verdoyante située au milieu
d ondulations et de collines sur la limite « du monde sauvage. »
C’est là que, sous des tentes, bivaquaitle jeune chef avec sasuite,
guettant les perdrix, les cailles et même les lièvres, ou pour parler
plus juste, ces animaux hybrides, moitié lièvres, moitié lapins,
qui habitent sur le continent arabe. Kasim avait avec lui une
vingtaine de cavaliers et une demi-douzaine de magnifiques faucons,
sans parler de deux couples de lévriers, que l’on nomme ici
selaki; enfin, la partie était complète, il n’y manquait que le gibier.
Nous passâmes une demi-journée dans la société de son Altesse,
et nous prîmes part à un repas arabe, animé par le récit d’aventures
cynégétiques. Pour une description détaillée de cette chasse
en Orient, je renverrai mes lecteurs à l’excellent ouvrage de
Layard, qui porte le titre de Nineveh.
Je rencontrai là deux Bédouins appartenant, l’un à la tribu de
Menasir, 1 autre à celle des Morrah; ces hommes étaient parmi
leurs compatriotes l’objet d’une vive admiration, car ils avaient
traversé le grand désert pour se rendre dans l’Yémen. L’exploit
qui les avait rendus fameux n’était, paraît-il, nullement prémédité
; ils avaient simplement projeté de traverser l’Akhaf,
chaîne de montagnes calcaires coupée de vallées fertiles qui
occupe, au sud de l’Yémamah, le point désigné sur quelques
cartes, par le nom de « Wadi Djebrin. » Nos deux amis avaient
à régler en cet endroit quelques affaires relatives à des chameaux,
mais ayant suivi une direction beaucoup trop méridionale,
ils s’étaient égarés ; errant de monticule de sable en monticule
de sable, de vallée en vallée, rencontrant par bonheur
tantôt une source saumâtre où ils remplissaient leurs outres,
tantôt quelques palmiers nains, dont les fruits n’étaient pas
« tout à fait immangeables, * ils avaient, après deux mois de
marche dans la direction du sud-ouest, atteint Maarib sur la
frontière de l’Yémen.
Pour revenir, ils prirent un chemin plus sûr, mais beaucoup
plus détourné ; ils traversèrent l’Hadramant, et remontèrent ensuite
la côte de l’Oman. Quand je les questionnai sur la longue
ligne de rivages appelée souvent Mahra, ils me répondirent qu elle
ne renferme ni ville ni village, et qu’elle n’offre que des huttes
de terre et des cabanes éparses de feuilles de palmiers, où habitent
des hommes à la peau bronzée, qui parlent l’idiome
abyssin. Ce sont, je crois, les Himyarites, qui ont été l’objet de
savantes études, et qui paraissent en effet provenir d’une colonisation
éthiopienne antérieure à la fameuse invasion d’Elisbaan
le Nadjashite pendant le sixième siècle. Ils ont conservé jusqu’à
ce jour la forme archaïque de leur langue maternelle. J’aurais
eu un vif désir de visiter leur territoire, mais plusieurs raisons
m’en empêchèrent, et je n’eus l’occasion de voir aucun de ses
véritables habitants. Des informations postérieures, que j’ai
recueillies dans l’Oman, ont confirmé de tous points les assertions
de mes deux amis les Bédouins. Les Arabes dé leur tribu, bien
qu’ils ne sachent ni généraliser ni déduire les conséquences des
principes, sont d’excellents observateurs des hommes et des
coutumes, et je n’ai pas de motifs pour récuser leur.témoignage
dans un cas comme celui-ci, où il ne s’agit que de faits matériels.
La tradition, —je ne dis pas l’histoire,—fait d’Himyar, le prétendu
fondateur de cette race, un petit-fils de Kathan, et un frère
de Saba, le fameuxprinceYémanïte.Maisles différences tranchées
qui existent dans la conformation physique et dans la langue des
deux grandes familles méridionales de l’Arabie nous donnent le
droit de mettre en doute l’exactitude de cette généalogie ; les
mariages cependant ont pu, jusqu’à un certain point, suppléer
à l’absence de parenté originelle. Une telle affinité et l’influence
que l’esprit relativement organisateur des Abyssiniens aurait