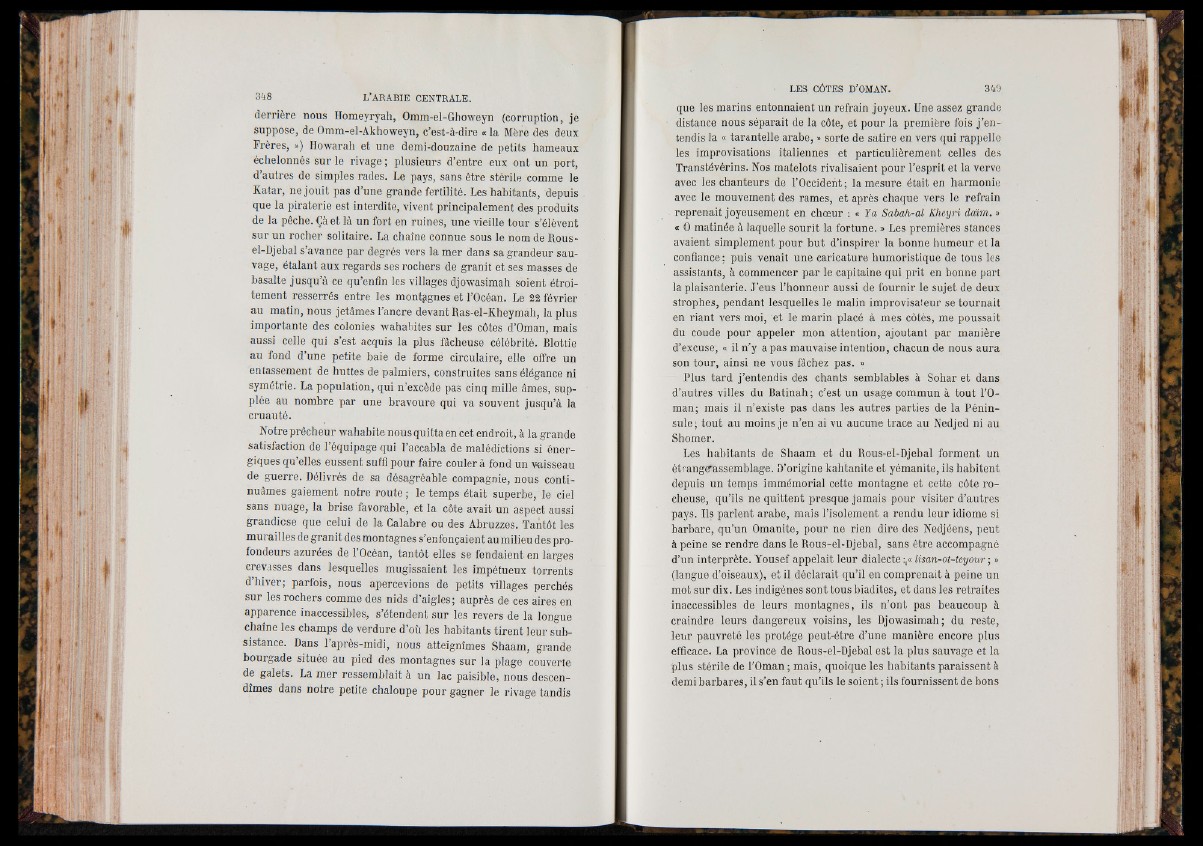
derrière nous Homeyryah, Omm-el-Ghoweyn (corruption, je
suppose, de Omm-el-Akhoweyn, c’est-à-dire « la Mère des deux
Frères, ») Howarah et une demi-douzaine de petits hameaux
échelonnés sur le rivage ; plusieurs d’entre eux ont un port,
d’autres de simples rades. Le pays, sans être stérile comme le
Katar, ne jouit pas d’une grande fertilité. Les habitants, depuis
que la piraterie est interdite, vivent principalement des produits
de la pêche. Çà et là un fort en ruines, une vieille tour s’élèvent
sur un rocher solitaire. La chaîne connue sous le nom de Rous-
el-Djebal s’avance par degrés vers la mer dans sa grandeur sauvage,
étalant aux regards ses rochers de granit et ses masses de
basalte jusqu’à ce qu’enfin les villages djowasimah soient étroitement
resserrés entre les montagnes et l’Océan. Le 22 février
au matin, nous jetâmes l’ancre devant Ras-el-Kheymah, la plus
importante des colonies wahabites sur les côtes d’Oman, mais
aussi celle qui s’est acquis la plus fâcheuse célébrité. Blottie
au fond d’une petite baie de forme circulaire, elle offre un
entassement de huttes de palmiers, construites sans élégance ni
symétrie. La population, qui n’excède pas cinq mille âmes, supplée
au nombre par une bravoure qui va souvent jusqu’à la
cruauté.
Notre prêcheur wahabite nous quitta en cet endroit, à la grande
satisfaction de l’équipage qui l’accabla de malédictions si énergiques
qu’elles eussent suffi pour faire couler à fond un vaisseau
de guerre. Délivrés de sa désagréable compagnie, nous continuâmes
gaiement notre route ; le temps était superbe, le ciel
sans nuage, la brise favorable, et la côte avait un aspect aussi
grandiose que celui de la Galabre ou des Abruzzes. Tantôt les
murailles de granit des montagnes s’enfonçaient au milieu des profondeurs
azurées de l’Océan, tantôt elles se fendaient en larges
crevasses dans lesquelles mugissaient les impétueux torrents
d hiver; parfois, nous apercevions de petits villages perchés
sur les rochers comme des nids d’aigles; auprès de ces aires en
apparence inaccessibles, s’étendent sur les revers de la longue
chaîne les champs de verdure d’où les habitants tirent leur subsistance.
Dans l’après-midi, nous atteignîmes Shaam, grande
bourgade située au pied des montagnes sur la plage couverte
de galets. La mer ressemblait à un lac paisible, nous descendîmes
dans notre petite chaloupe pour gagner le rivage tandis
que les marins entonnaient un refrain joyeux. Une assez grande
distance nous séparait de la côte, et pour la première fois j ’entendis
la « tarantelle arabe, » sorte de satire en vers qui rappelle
les improvisations italiennes et particulièrement celles des
Transtévérins. Nos matelots rivalisaient pour l’esprit et la verve
avec les chanteurs de l’Occident; la mesure était en harmonie
avec le mouvement des rames, et après chaque vers le refrain
reprenait joyeusement en choeur : « Ya Sabah-al Kheyri dcCim. »
« 0 matinée à laquelle sourit la fortune. » Les premières stances
avaient simplement pour but d’inspirer la bonne humeur et la
confiance: puis venait une caricature humoristique de tous les
assistants, à commencer par le capitaine qui prit en bonne part
la plaisanterie. J ’eus l’honneur aussi de fournir le sujet de deux
strophes, pendant lesquelles le malin improvisateur se tournait
en riant vers moi, et le marin placé à mes côtés, me poussait
du coude pour appeler mon attention, ajoutant par manière
d’excuse, » il n’y a pas mauvaise intention, chacun de nous aura
son tour, ainsi ne vous fâchez pas. »
Plus tard j ’entendis des chants semblables à Sohar et dans
d’autres villes du Batinah; c’est un usage commun à tout l’Oman;
mais il n’existe pas dans les autres parties de la Péninsule;
tout au moins je n’en ai vu aucune trace au Nedjed ni au
Shomer.
Les habitants de Shaam et du Rous-el-Djebal forment un
étrange'assemblage. D’origine kahtanite et yémanite, ils habitent
depuis un temps immémorial cette montagne et cette côte rocheuse,
qu’ils ne quittent presque jamais pour visiter d’autres
pays. Ils parlent arabe, mais l’isolement a rendu leur idiome si
barbare, qu’un Omanite, pour ne rien dire des Nedjéens, peut
à peine se rendre dans le Rous-el-Djebal, sans être accompagné
d’un interprète. Yousef appelait leur dialecte lisan-ot-teyowr ; »
(langue d’oiseaux), et il déclarait qu’il en comprenait à peine un
mot sur dix. Les indigènes sont tous biadites, et dans les retraites
inaccessibles de leurs montagnes, ils n’ont pas beaucoup à
craindre leurs dangereux voisins, les Djowasimah; du reste,
leur pauvreté les protège peut-être d’une manière encore plus
efficace. La province de Rous-el-Djebal est la plus sauvage et la
plus stérile de l’Oman ; mais, quoique les habitants paraissent à
demi barbares, il s’en faut qu’ils le soient ; ils fournissent de bons