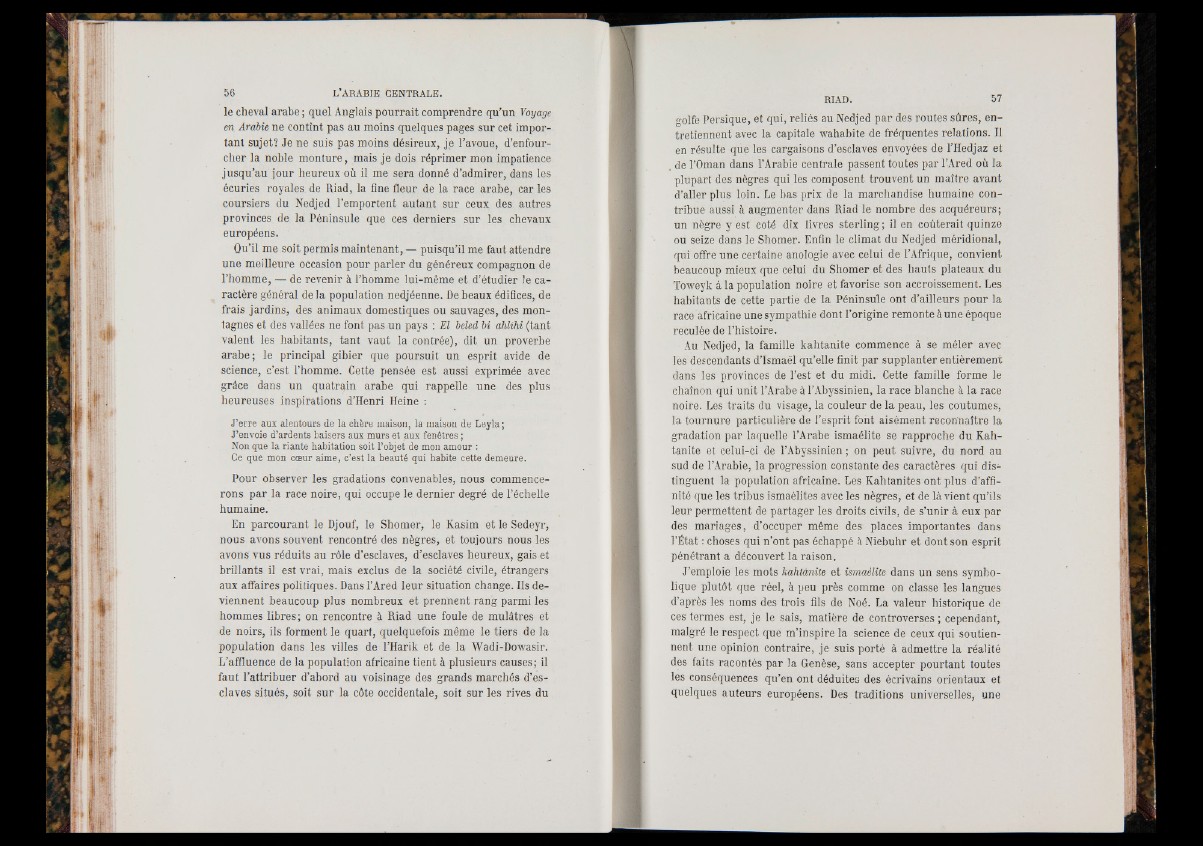
le cheval arabe ; quel Anglais pourrait comprendre qu'un Voyage
en Arabie ne contînt pas au moins quelques pages sur cet important
sujet? Je ne suis pas moins désireux, je l’avoue, d’enfourcher
la noble monture, mais je dois réprimer mon impatience
jusqu’au jour heureux où il me sera donné d’admirer, dans les
écuries royales de Riad, la fine fleur de la race arabe, car les
coursiers du Nedjed l’emportent autant sur ceux des autres
provinces de la Péninsule que ces derniers sur les chevaux
européens.
Qu’il me soit permis maintenant, — puisqu’il me faut attendre
une meilleure occasion pour parler du généreux compagnon de
l’homme, — de revenir à l’homme lui-même et d’étudier le caractère
général de la population nedjéenne. De beaux édifices, de
frais jardins, des animaux domestiques ou sauvages, des montagnes
et des vallées ne font pas un pays : El beled bi ahlihi (tant
valent les habitants, tant vaut la contrée), dit un proverbe
arabe; le principal gibier que poursuit un esprit avide de
science, c’est l’homme. Cette pensée est aussi exprimée avec
grâce dans un quatrain arabe qui rappelle une des plus
heureuses inspirations d’Henri Heine :
J ’erre aux alentours de la chère maison, la maison de Leyla ;
J ’envoie d’ardents baisers aux murs et aux fenêtres ;
Non que la riante habitation soit l’objet de mon amour :
Ce que mon coeur aime, c’est la beauté qui habite cette demeure.
Pour observer les gradations convenables, nous commencerons
par la race noire, qui occupe le dernier degré de l’échelle
humaine.
En parcourant le Djouf, le Shomer, le Kasim et le Sedeyr,
nous avons souvent rencontré des nègres, et toujours nous les
avons vus réduits au rôle d’esclaves, d’esclaves heureux, gais et
brillants il est vrai, mais exclus de la société civile, étrangers
aux affaires politiques. Dans l’Ared leur situation change. Ils deviennent
beaucoup plus nombreux et prennent rang parmi les
hommes libres; on rencontre à Riad une foule de mulâtres et
de noirs, ils forment le quart, quelquefois même le tiers de la
population dans les villes de l’Harik et de la Wadi-Dowasir.
L’affluence de la population africaine tient à plusieurs causes; il
faut l’attribuer d’abord au voisinage des grands marchés d’esclaves
situés, soit sur la côte occidentale, soit sur les rives du
golfe Persique, et qui, reliés au Nedjed par des routes sûres, entretiennent
avec la capitale wahabite de fréquentes relations. Il
en résulte que les cargaisons d’esclaves envoyées de l’Hedjaz et
, de l’Oman dans l’Arabie centrale passent toutes par l’Ared où la
plupart des nègres qui les composent trouvent un maître avant
d’aller plus loin. Le bas prix de la marchandise humaine contribue
aussi à augmenter dans Riad le nombre des acquéreurs;
un nègre y est coté dix livres sterling; il en coûterait quinze
ou seize dans le Shomer. Enfin le climat du Nedjed méridional,
qui offre une certaine anologie avec celui de l’Afrique, convient
beaucoup mieux que celui du Shomer et des hauts plateaux du
Toweyk à la population noire et favorise son accroissement. Les
habitants de cette partie de la Péninsule ont d’ailleurs pour la
race africaine une sympathie dont l’origine remonte à une époque
reculée de l’histoire.
Au Nedjed, la famille kahtànite commence à se mêler avec
les descendants d’Ismaël qu’elle finit par supplanter entièrement
dans les provinces de l’est et du midi. Cette famille forme le
chaînon qui unit l’Arabe à ¡’Abyssinien, la race blanche à la race
noire. Les traits du visage, la couleur de la peau, les coutumes,
la tournure particulière de l’esprit font aisément reconnaître la
gradation par laquelle l’Arabe ismaélite se rapproche du Kah-
tanite et celui-ci de l’Abyssinien ; on peut suivre, du nord au
sud de l’Arabie, la progression constante des caractères qui distinguent
la population africaine. Les Kahtanites ont plus d’affinité
que les tribus ismaélites avec les nègres, et de là vient qu’ils
leur permettent de partager les droits civils, de s’unir à eux par
des mariages, d’occuper même des places importantes dans
l’État : choses qui n’ont pas échappé à Niebuhr et dont son esprit
pénétrant a découvert la raison.
J’emploie les mots kahtànite et ismaélite dans un sens symbolique
plutôt que réel, à peu près comme on classe les langues
d’après les noms des trois fils de Noé. La valeur historique de
ces termes est, je le sais, matière de controverses ; cependant,
malgré le respect que m’inspire la science de ceux qui soutiennent
une opinion contraire, je suis porté à admettre la réalité
des faits racontés par la Genèse, sans accepter pourtant toutes
les conséquences qu’en ont déduites des écrivains orientaux et
quelques auteurs européens. Des traditions universelles, une