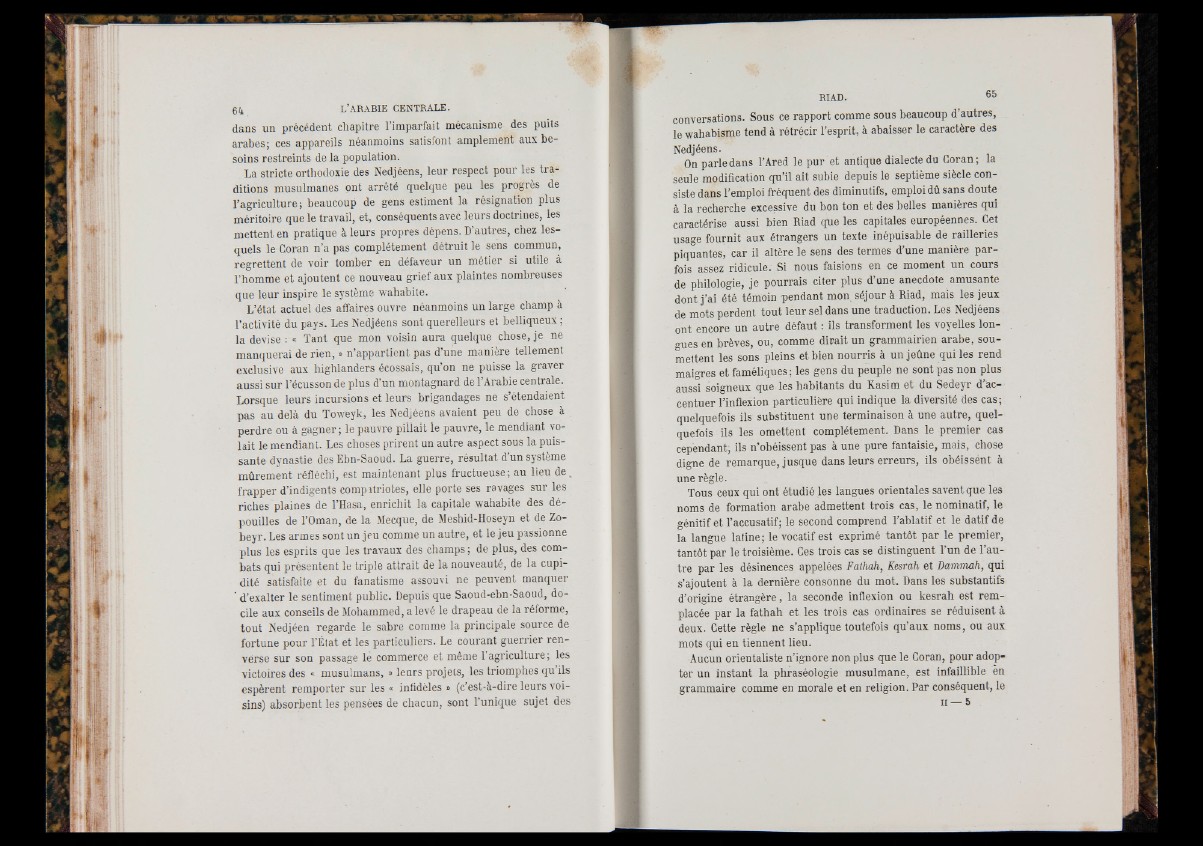
dans un précédent chapitre l’imparfait mécanisme des puits
arabes; ces appareils néanmoins satisfont amplement aux besoins
restreints de la population.
La stricte orthodoxie des Nedjéens, leur respect pour les traditions
musulmanes ont arrêté quelque peu les progrès de
l’agriculture; beaucoup de gens estiment la résignation plus
méritoire que le travail, et, conséquents avec leurs doctrines, les
mettent en pratique à leurs propres dépens. D’autres, chez lesquels
le Coran n’a pas complètement détruit le sens commun,
regrettent de voir tomber en défaveur un métier si utile à
l’homme et ajoutent ce nouveau grief aux plaintes nombreuses
que leur inspire le système wahabile.
L’état actuel des affaires ouvre néanmoins un large champ à
l’activité du pays. Les Nedjéens sont querelleurs et belliqueux ;
la devise : « Tant que mon voisin aura quelque chose, je ne
manquerai de rien, » n’appartient pas d’une manière tellement
exclusive aux highlanders écossais, qu’on ne puisse la graver
aussi sur l’écusson de plus d’un montagnard de l’Arabie centrale.
Lorsque leurs incursions et leurs brigandages ne s’étendaient
pas au delà du Toweyk, les Nedjéens avaient peu de chose à
perdre ou à gagner; le pauvre pillait le pauvre, le mendiant volait
le mendiant. Les choses prirent un autre aspect sous la puissante
dynastie des Ebn-Saoud. La guerre, résultat d’un système
mûrement réfléchi, est maintenant plus fructueuse; au lieu de,
frapper d’indigents compitriotes, elle porte ses ravages sur les
riches plaines de l’Hasa, enrichit la capitale wahabite des dépouilles
de l’Oman, de la Mecque, de Meshid-Hoseyn et de Zo-
beyr. Les armes sont un jeu comme un autre, et le jeu passionne
plus les esprits que les travaux des champs ; de plus, des combats
qui présentent le triple attrait de la nouveauté, de la cupidité
satisfaite et du fanatisme assouvi ne peuvent manquer
d’exalter le sentiment public. Depuis que Saoud-ebn-Saoud, docile
aux conseils de Mohammed, a levé le drapeau de la réforme,
tout Nedjéen regarde le sabre comme la principale source de
fortune pour l’État et les particuliers. Le courant guerrier renverse
sur son passage le commerce et même 1 agriculture ; les
victoires des « musulmans, » leurs projets, les triomphes qu ils
espèrent remporter sur les « infidèles » (c’est-à-dire leurs voisins)
absorbent les pensées de chacun, sont l’unique sujet des
conversations. Sous ce rapport comme sous beaucoup d’autres,
le wahabisme tend à rétrécir l’esprit, à abaisser le caractère des
Nedjéens. -
On parledans l’Ared le pur et antique dialecte du Coran; la
seule modification qu’il ait subie depuis le septième siècle consiste
dans l’emploi fréquent des diminutifs, emploi dû sans doute
à la recherche excessive du bon ton et des belles manières qui
caractérise aussi bien Riad que les capitales européennes. Cet
usage fournit aux étrangers un texte inépuisable de railleries
piquantes, car il altère le sens des termes d’une manière parfois
assez ridicule. Si nous faisions en ce moment un cours
de philologie, je pourrais citer plus d’une anecdote amusante
dont j ’ai été témoin pendant m o n , séjour à Riad, mais les jeux
de mots perdent tout leur sel dans une traduction. Les Nedjéens
ont encore un autre défaut : ils transforment les voyelles longues
en brèves, ou, comme dirait un grammairien arabe, soumettent
les sons pleins et bien nourris à un jeûne qui les rend
maigres et faméliques; les gens du peuple ne sont pas non plus
aussi soigneux que les habitants du Kasim et du Sedeyr d’accentuer
l’inflexion particulière qui indique la diversité des cas;
quelquefois ils substituent une terminaison à une autre, quelquefois
ils les omettent complètement. Dans le premier cas
cependant, ils n’obéissent pas à une pure fantaisie, mais, chose
digne de remarque, jusque dans leurs erreurs, ils obéissent à
une règle.
Tous ceux qui ont étudié les langues orientales savent que les
noms de formation arabe admettent trois cas, le nominatif, le
génitif et l’accusatif; le second comprend l ’ablatif et le datif de
la langue latine; le vocatif est exprimé tantôt par le premier,
tantôt par le troisième. Ces trois cas se distinguent l’un de l’autre
par les désinences appelées Fathah, Kesrah et Dammah, qui
s’ajoutent à la dernière consonne du mot. Dans les substantifs
d’origine étrangère, la seconde inflexion ou kesrah est remplacée
par la fathah et les trois cas ordinaires se réduisent à
deux. Cette règle ne s’applique toutefois qu’aux noms, ou aux
mots qui en tiennent lieu.
Aucun orientaliste n’ignore non plus que le Coran, pour adopter
un instant la phraséologie musulmane, est infaillible en
grammaire comme en morale et en religion. Par conséquent, le
h — 5