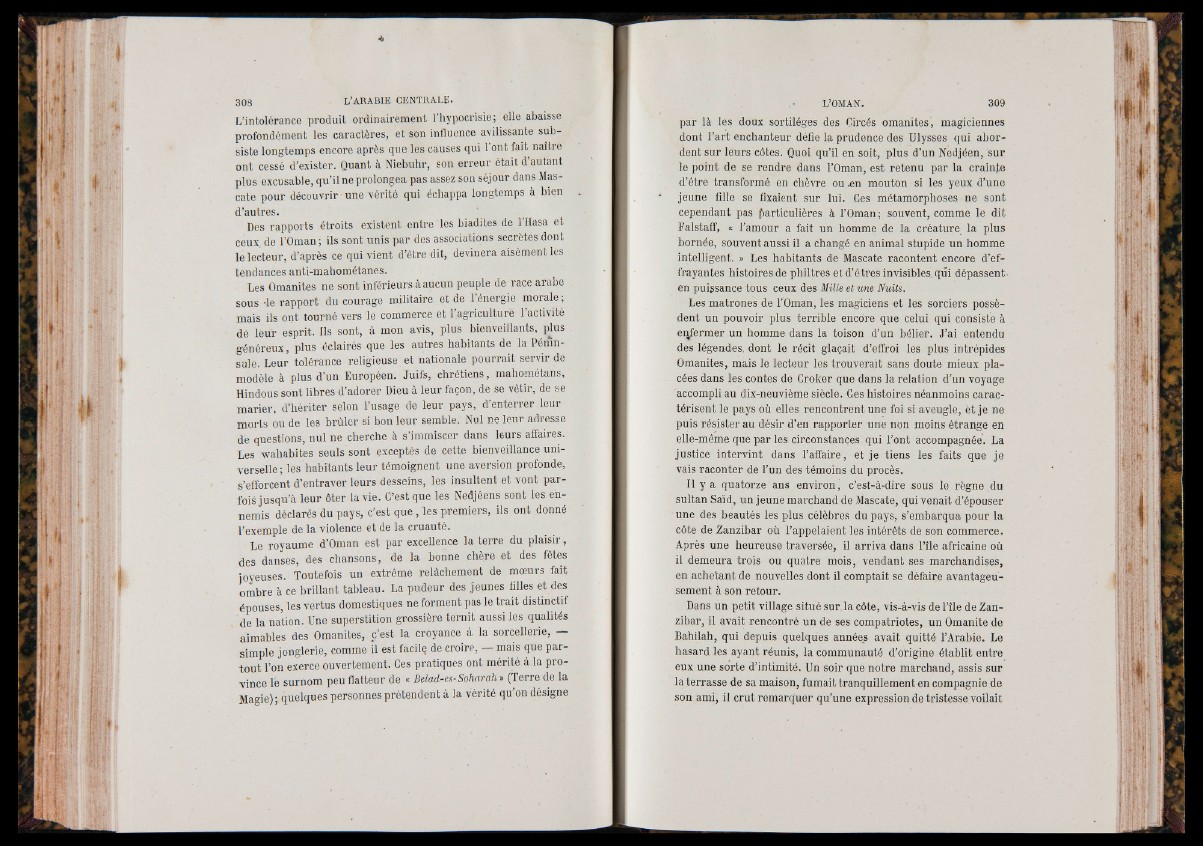
L’intolérance produit ordinairement l’hypocrisie; elle abaisse
profondément les caractères, et son influence avilissante subsiste
longtemps encore après que les causes qui 1 ont fait naître
ont cessé d’exister. Quant à Niebuhr, son erreur était d’autant
plus excusable, qu’il ne prolongea pas assez son séjour dans Mas-
cate pour découvrir une vérité qui échappa longtemps à bien
d’autres.
Des rapports étroits existent entre les biadites de l’Hasa et
ceux de l’Oman ; ils sont unis par des associations secrètes dont
le lecteur, d’après ce qui vient d’être dit, devinera aisément les
tendances anti-mahométanes.
Les Omanites ne sont inférieurs à aucun peuple de race arabe
sous de rapport du courage militaire et de 1 énergie morale ;
mais ils ont tourné vers le commerce et l’agriculture 1 activité
dé leur esprit. Ils sont, à mon avis, plus bienveillants, plus
généreux, plus éclairés que les autres habitants de la Péninsule.
Leur tolérance religieuse et nationale pourrait servir de
modèle à plus d’un Européen. Juifs, chrétiens, mahométans,
Hindous sont libres d’adorer Dieu à leur façon, de se vêtir, de se
marier, d’hériter selon l’usage de leur pays, d’enterrer leur
morts ou de les brûler si bon leur semble. Nul ne leur adresse
de questions, nul ne cherche à s’immiscer dans leurs affaires.
Les wahabites seuls sont exceptés de cette bienveillance universelle;
les habitants leur témoignent une aversion profonde,
s’efforcent d’entraver leurs desseins, les insultent et vont parfois
jusqu’à leur ôter la vie. C’est que les Nedjéens sont les ennemis
déclarés du pays, c’est q u e , les premiers, ils ont donné
l’exemple de la violence et de la cruauté.
Le royaume d’Oman est par excellence la terre du plaisir,
des danses, des chansons, de la bonne chère et des fêtes
joyeuses. Toutefois un extrême relâchement de moeurs fait
ombre à ce brillant tableau. La pudeur des jeunes filles et des
épouses, les vertus domestiques ne forment pas le trait distinctif
de la nation. Une superstition grossière ternit aussi les qualités
aimables des Omanites, c’est la croyance à la sorcellerie, —
simple jonglerie, comme il est facilç de croire, — mais que partout
Ton exerce ouvertement. Ces pratiques ont mérité à la province
le surnom peu flatteur de « Belad-es-Soharah » (Terre de la
Magie) ; quelques personnes prétendent à la vérité qu’on désigne
par là les doux sortilèges des Circés omanites, magiciennes
dont l’art enchanteur défie la prudence des Ulysses qui abordent
sur leurs côtes. Quoi qu’il en soit, plus d’un Nedjéen, sur
le point de se rendre dans l’Oman, est retenu par la crainte
d’être transformé en chèvre ou .en mouton si les yeux d’une
jeune fille se fixaient sur lui. Ces métamorphoses ne sont
cependant pas particulières à l’Oman; souvent, comme le dit
Falstaff, * Tamour a fait un homme de la créature la plus
bornée, souvent aussi il a changé en animal stupide un homme
intelligent. » Les habitants de Mascate racontent encore d’effrayantes
histoires de philtres et d’êtres invisibles,qui dépassent
en puissance tous ceux des Mille et une Nuits,
Les matrones de l’Oman, les magiciens et les sorciers possèdent
un pouvoir plus terrible encore que celui qui consiste à
enfermer un homme dans la toison d’un bélier. J’ai entendu
des légendes, dont le récit glaçait d’effroi les plus intrépides
Omanites, mais le lecteur les trouverait sans doute mieux placées
dans les contes de Croker que dans la relation d’un voyage
accompli au dix-neuvième siècle. Ces histoires néanmoins caractérisent
le pays où elles rencontrent une foi si aveugle, èt je ne
puis résister au désir d’en rapporter une non moins étrange en
elle-même que par les circonstances qui l’ont accompagnée. La
justice intervint dans l’affaire, et je tiens les faits que je
vais raconter de l’un des témoins du procès.
Il y a quatorze ans environ j c’est-à-dire sous le règne du
sultan Saïd, un jeune marchand de Mascate, qui venait d’épouser
une des beautés les plus célèbres du pays, s’embarqua pour la
côte de Zanzibar où l’appelaient les intérêts de son commerce.
Après une heureuse traversée, il arriva dans l’île africaine où
il demeura trois ou quatre mois, vendant ses marchandises,
en achetant de nouvelles dont il comptait se défaire avantageusement
à son retour.
Dans un petit village situé sur la côte, vis-à-vis de l’île de Zanzibar,
il avait rencontré un de ses compatriotes, un Omanite de
Bahilah, qui depuis quelques années avait quitté l’Arabie. Le
hasard les ayant réunis, la communauté, d’origine établit entre
eux une sorte d’intimité. Un soir que notre marchand, assis sur
la terrasse de sa maison, fumait tranquillement en compagnie de
son ami, il crut remarquer qu’une expression de tristesse voilait