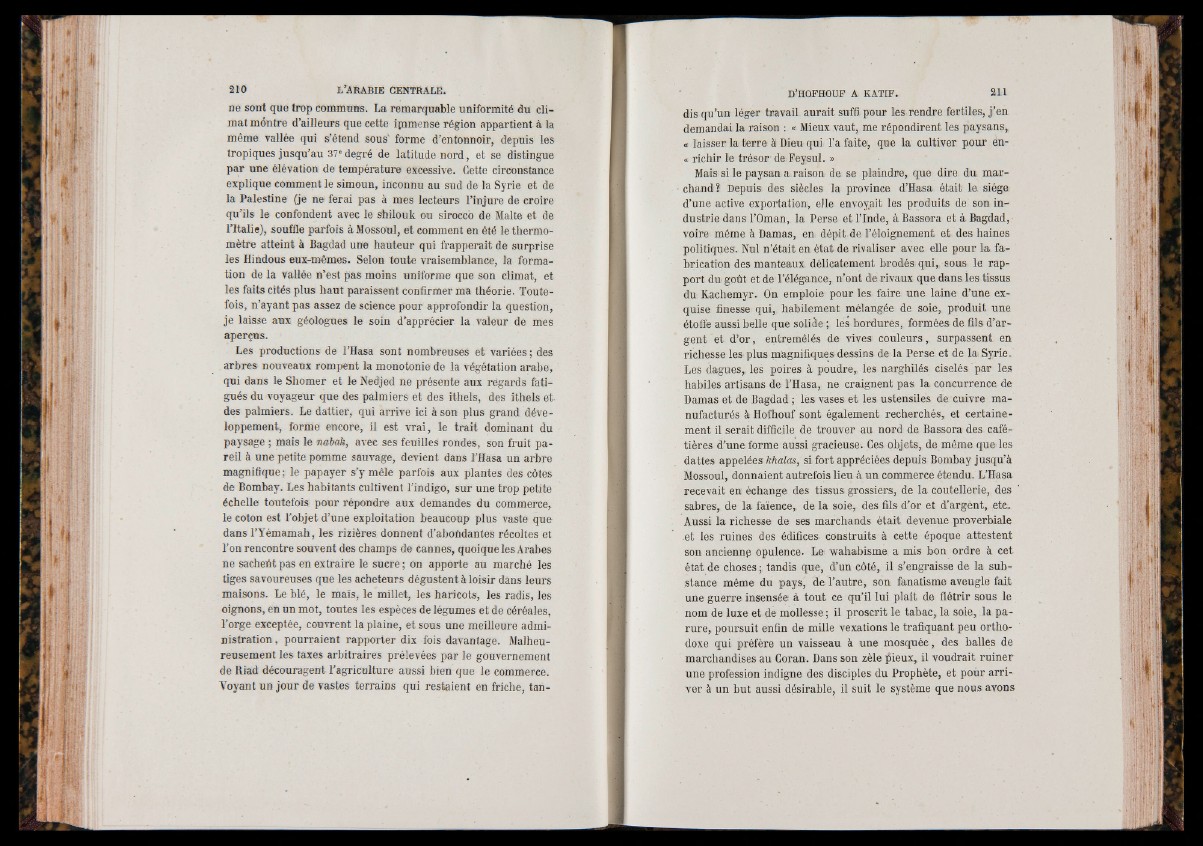
ne sont que trop communs. La remarquable uniformité du climat
montre d’ailleurs que cette ipimense région appartient à la
même vallée qui s’étend sous' forme d’entonnoir, depuis les
tropiques jusqu’au 37« degré de latitude nord, et se distingue
par une élévation de température excessive. Cette circonstance
explique comment le simoun, inconnu au sud de la Syrie et de
la Palestine (je ne ferai pas à mes lecteurs l’injure de croire
qu’ils le confondent avec le shilouk ou sirocco de Malte et de
l’Italie), souffle parfois à Mossoul, et comment en été le thermomètre
atteint à Bagdad une hauteur qui frapperait de surprise
les Hindous eux-mêmes. Selon toute vraisemblance, la formation
de la vallée n’est pas moins uniforme que son climat, et
les faits cités plus haut paraissent confirmer ma théorie. Toutefois,
n’ayant pas assez de science pour approfondir la question,
je laisse aux géologues le soin d’apprécier la valeur de mes
aperçus.
Les productions de l’Hasa sont nombreuses et variées ; des
arbres nouveaux rompent la monotonie de la végétation arabe,
qui dans le Shomer et le Nedjed ne présente aux regards fatigués
du voyageur que des palmiers et des ithels, des ithels et
des palmiers. Le dattier, qui arrive ici à son plus grand développement,
forme encore, il est vrai, le trait dominant du
paysage ; mais le nabak, avec ses feuilles rondes, son fruit pareil
à une petite pomme sauvage, devient dans l’flasa un arbre
magnifique ; le papayer s’y mêle parfois aux plantes des côtes
de Bombay. Les habitants cultivent l’indigo, sur une trop petite
échelle toutefois pour répondre aux demandes du commerce,
le coton est l’objet d’une exploitation beaucoup plus vaste que
dans l’Yémamah, les rizières donnent d’abofidantes récoltes et
l’on rencontre souvent des champs de cannes, quoique les Arabes
ne sa chérit pas en extraire le sucre ; on apporte au marché les
tiges savoureuses que les acheteurs dégustent à loisir dans leurs
maisons. Le blé, le maïs, le millet, les haricots, les radis, les
oignons, en un mot, toutes les espèces de légumes et de céréales,
l’orge exceptée, couvrent la plaine, et sous une meilleure administration
, pourraient rapporter dix fois davantage. Malheureusement
les taxes arbitraires prélevées par le gouvernement
de Riad découragent l’agriculture aussi bien que le commerce.
Voyant un jour de vastes terrains qui restaient en friche, tandis
qu’un léger travail aurait suffi pour les rendre fertiles, j ’en
demandai la raison : « Mieux vaut, me répondirent les paysans,
« laisser la terre à Dieu qui l’a faite, que la cultiver pour en-
« richir le trésor de Feysul. »
Mais si le paysan a raison de se plaindre, que dire dn marchand?
Depuis des siècles la province d’Hasa était le siège,
d’une active exportation, elle envoyait les produits de son industrie
dans l’Oman, la Perse et l’Inde, à Bassora et à Bagdad,
voire même à Damas, en dépit deTéloignement et des haines
politiques. Nul n’était en état de rivaliser avec elle pour la. fabrication
des manteaux délicatement brodés qui, sous le rapport
du goût et de l’élégance, n’ont de rivaux que dans les tissus
du Kachemyr. On emploie pour les faire une laine d’une exquise
finesse qui, habilement mélangée de soie, produit une
étoffe aussi belle que solide ; les bordures, formées de fils d’argent
et d’o r, entremêlés de vives couleurs, surpassent en
richesse les plus magnifiques dessins de la Perse et de la Syrie.
Les dagues, les poires à poudre, les narghilés ciselés par les
habiles artisans de l’Hasa, ne craignent pas la concurrence de
Damas et de Bagdad ; les vases et les ustensiles de cuivre manufacturés
à Hofhouf sont également recherchés, et certainement
il serait difficile de trouver au nord de Bassora des café-
tières d’une forme aussi gracieuse. Ces objets, de même que les
dattes appelées hhalas, si fort appréciées depuis Bombay jusqu’à
Mossoul, donnaient autrefois lieu à un commerce étendu. L’Hasa
recevait en échange, des tissus grossiers, de la coutellerie, des
sabres, de la faïence, de la soie, des fils d’or et d’argent, etc»
Aussi la richesse de ses marchands était devenue proverbiale
et les ruines des édifices, construits à cette époque attestent
son ancienne opulence. Le wahabisme a mis bon ordre à cet
état de choses ; tandis que, d’un côté, il s’engraisse de la substance
même du pays, de l’autre, son fanatisme aveugle fait
une guerre insensée à tout ce qu’il lui plaît de flétrir sous le
nom de luxe et de mollesse ; il proscrit le tabac, la soie, la parure,
poursuit enfin de mille vexations le trafiquant peu orthodoxe
qui préfère un vaisseau à une mosquée, des balles de
marchandises au Coran. Dans son zèle ]5ieux, il voudrait ruiner
une profession indigne des disciples du Prophète, et poùr arriver
à un but aussi désirable, il suit le système que nous avons