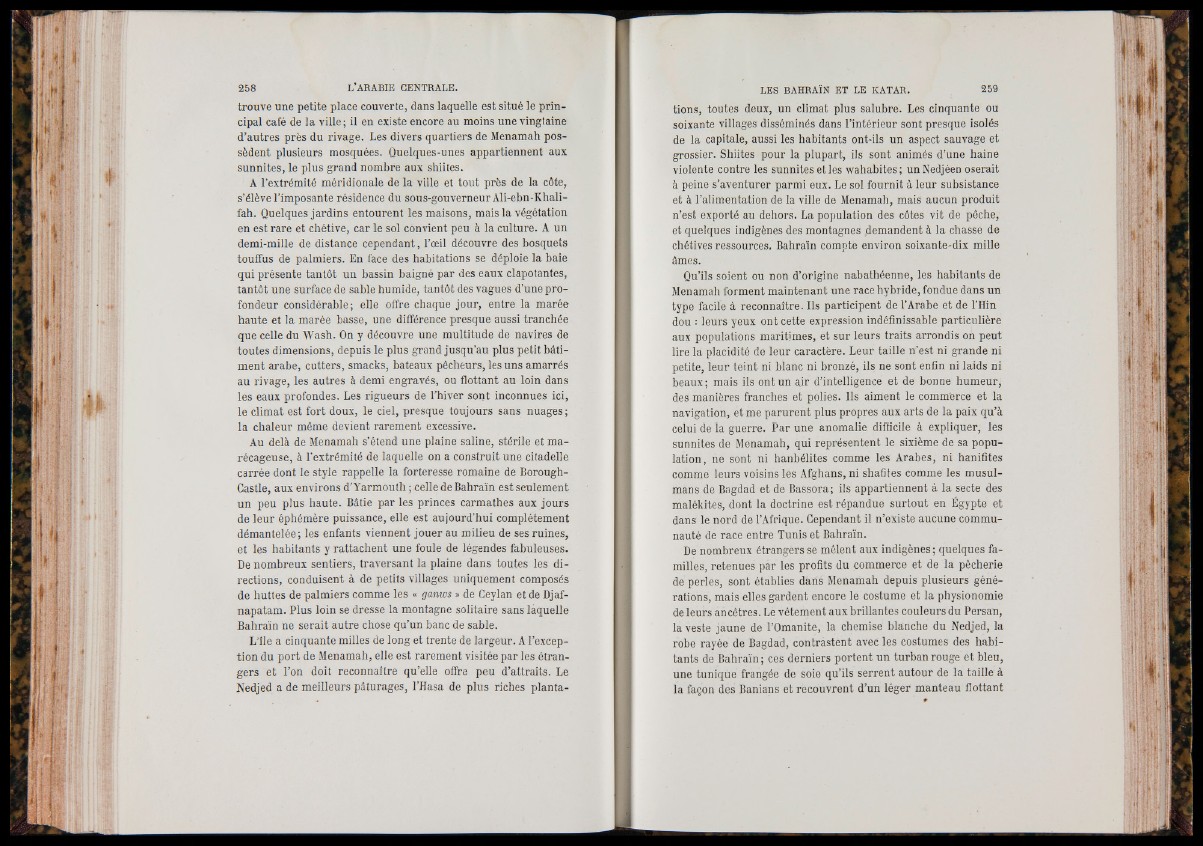
trouve une petite place couverte, dans laquelle est situé le principal
café de la ville; il en existe encore au moins une vingtaine
d’autres près du rivage. Les divers quartiers de Menamah possèdent
plusieurs mosquées. Quelques-unes appartiennent aux
sunnites, le plus grand nombre aux shiites.
A l’extrémité méridionale de la ville et tout près de la côte,
s’élève l’imposante résidence du sous-gouverneur Ali-ebn-Khali-
fah. Quelques jardins entourent les maisons, mais la végétation
en est rare et chétive, car le sol convient peu à la culture. A un
demi-mille de distance cependant, l’oeil découvre des bosquets
touffus de palmiers. En face des habitations se déploie la baie
qui présente tantôt un bassin baigné par des eaux clapotantes,
tantôt une surface de sable humide, tantôt des vagues d’une profondeur
considérable; elle offre chaque jour, entre la marée
haute et la marée basse, une différence presque aussi tranchée
que celle du Wash. On y découvre une multitude de navires de
toutes dimensions, depuis le plus grand jusqu’au plus petit bâtiment
arabe, cutters, smacks, bateaux pêcheurs, les uns amarrés
au rivage, les autres à demi engravés, ou flottant au loin dans
les eaux profondes. Les rigueurs de l’hiver sont inconnues ici,
le climat est fort doux, le ciel, presque toujours sans nuages;
la chaleur même devient rarement excessive.
Au delà de Menamah s’étend une plaine saline, stérile et marécageuse,
à l’extrémité de laquelle on a construit une citadelle
carrée dont le style rappelle la forteresse romaine de Borough-
Castle, aux environs d’Yarmouth ; celle de Bahraïn est seulement
un peu plus haute. Bâtie par les princes carmathes aux jours
de leur éphémère puissance, elle est aujourd’hui complètement
démantelée; les enfants viennent jouer au milieu de ses ruines,
et les habitants y rattachent une foule de légendes fabuleuses.
De nombreux sentiers, traversant la plaine dans toutes les directions,
conduisent à de petits villages uniquement composés
de huttes de palmiers comme les « ganws » de Ceylan et de Djaf-
napatam. Plus loin se dresse la montagne solitaire sans laquelle
Bahraïn ne serait autre chose qu’un banc de sable.
Lile a cinquante milles de long et trente de largeur. A l’exception
du port de Menamah, elle est rarement visitée par les étrangers
et l’on doit reconnaître qu’elle offre peu d’attraits. Le
Nedjed a de meilleurs pâturages, l’Hasa de plus riches plantations,
toutes deux, un climat plus salubre. Les cinquante ou
soixante villages disséminés dans l’intérieur sont presque isolés
de la capitale, aussi les habitants ont-ils un aspect sauvage et
grossier. Shiites pour la plupart, ils sont animés d’une haine
violente contre les sunnites et les wahabites; unNedjéen oserait
à peine s’aventurer parmi eux. Le sol fournit à leur subsistance
et à l’alimentation de la ville de Menamah, mais aucun produit
n’est exporté au dehors. La population des côtes vit de pêche,
et quelques indigènes des montagnes demandent à la chasse de
chétives ressources, Bahraïn compte environ soixante-dix mille
âmes.
Qu’ils soient ou non d’origine nabathéenne, les habitants de
Menamah forment maintenant une race hybride, fondue dans un
type facile à reconnaître. Ils participent de l’Arabe et de l’Hin
dou : leurs yeux ont cette expression indéfinissable particulière
aux populations maritimes, et sur leurs traits arrondis on peut
lire la placidité de leur caractère. Leur taille n’est ni grande ni
petite, leur teint ni blanc ni bronzé, ils ne sont enfin ni laids ni
beaux; mais ils ont un air d’intelligence et de bonne humeur,
des manières franches et polies. Ils aiment le comm'erce et la
navigation, et me parurent plus propres aux arts de la paix qu’à
celui de la guerre. Par une anomalie difficile à expliquer, les
sunnites de Menamah, qui représentent le sixième de sa population,
ne sont ni hanbélites comme les Arabes, ni hanifites
comme leurs voisins les Afghans, ni shafîfes comme les musulmans
de Bagdad et de Bassora; ils appartiennent à la secte des
malékites, dont la doctrine est répandue surtout en Egypte et
dans le nord de l’Afrique. Cependant il n’existe aucune communauté
de race entre Tunis et Bahraïn.
De nombreux étrangers se mêlent aux indigènes ; quelques familles,
retenues par les profits du commerce et de la pêcherie
de perles, sont établies dans Menamah depuis plusieurs générations,
mais elles gardent encore le costume et la physionomie
de leurs ancêtres. Le vêtement aux brillantes couleurs du Persan,
la veste jaune de l’Omanite, la chemise blanche du Nedjed, la
robe rayée de Bagdad, contrastent avec les costumes des habitants
de Bahraïn ; ces derniers portent un turban rouge et bleu,
une tunique frangée de soie qu’ils serrent autour de la taille à
la façon des Banians et recouvrent d’un léger manteau flottant