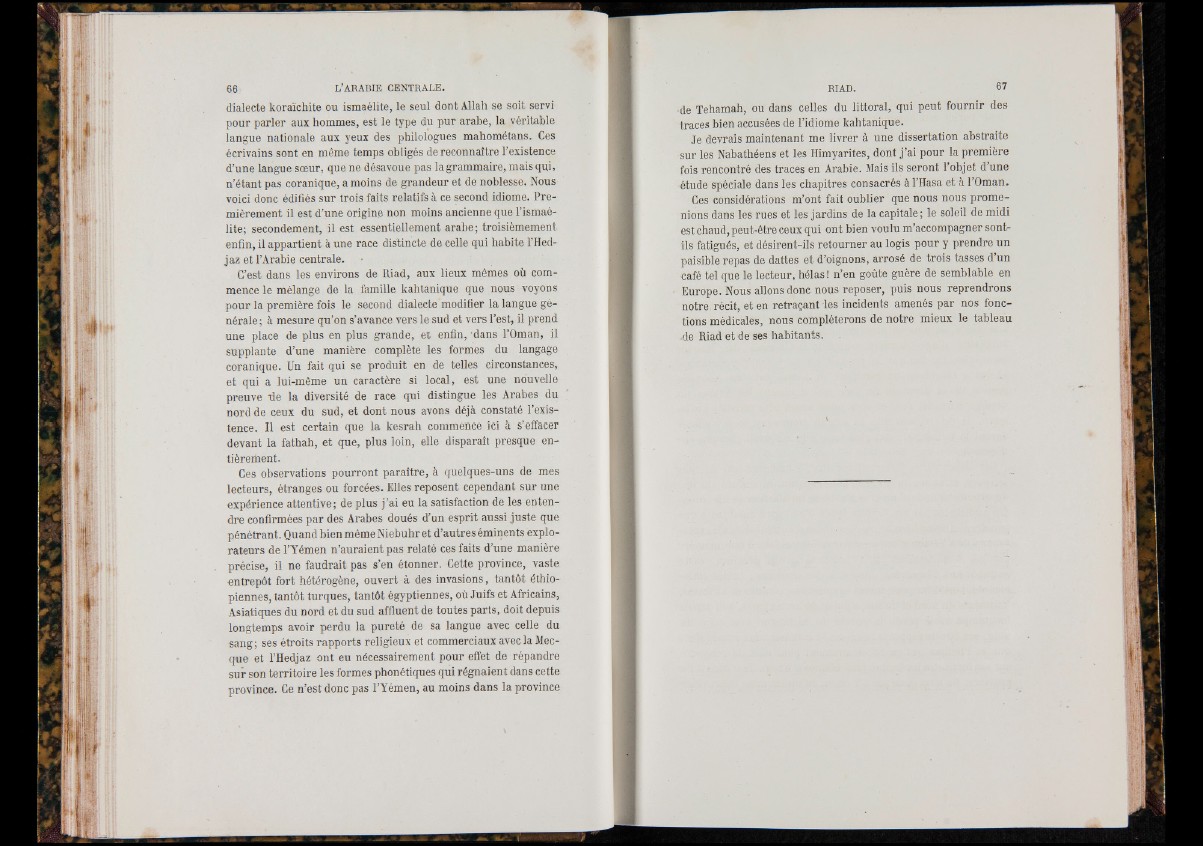
dialecte koraïchite ou ismaélite, le seul dont Allah se soit servi
pour parler aux hommes, est le type du pur arabe, la véritable
langue nationale aux yeux des philologues mahomëtans. Ces
écrivains sont en même temps obligés de reconnaître l’existence
d’une langue soeur, que ne désavoue pas la grammaire, mais qui,
n’étant pas coranique, a moins de grandeur et de noblesse. Nous
voici donc édifiés sur trois faits relatifs à ce second idiome. Premièrement
il est d’une origine non moins ancienne que l’ismaélite;
secondement, il est essentiellement arabe; troisièmement
enfin, il appartient à une race distincte de celle qui habite l’Hed-
jaz et l’Arabie centrale.
C’est dans les environs de Riad, aux lieux mêmes où commence
le mélange de la famille kahtanique que nous voyons
pour la première fois le second dialecte modifier la langue générale;
à mesure qu’on s’avance vers le sud et vers l’est, il prend
une place de plus en plus grande, et enfin, 'dans l’Oman, il
supplante d’une manière complète les formes du langage
coranique. Un fait qui se produit en de telles circonstances,
et qui a lui-même un caractère si local, est une nouvelle
preuve île la diversité de race qui distingue les Arabes du
nord de ceux du sud, et dont nous avons déjà constaté l’existence.
Il est certain que la kesrah commence ici à s’effacer
devant la fathah, et que, plus loin, elle disparaît presque entièrement.
Ces observations pourront paraître, à quelques-uns de mes
lecteurs, étranges ou forcées. Elles reposent cependant sur une
expérience attentive; de plus j’ai eu la satisfaction de les entendre
confirmées par des Arabes doués d’un esprit aussi juste que
pénétrant. Quand bien même Niebuhr et d’autres éminents explorateurs
de l’Yémen n ’auraient pas relaté ces faits d’une manière
précise, il ne faudrait pas s’en étonner. Cette province, vaste
entrepôt fort hétérogène, ouvert à des invasions, tantôt éthiopiennes,
tantôt turques, tantôt égyptiennes, où Juifs et Africains,
Asiatiques du nord et du sud affluent de toutes parts, doit depuis
longtemps avoir perdu la pureté de sa langue avec celle du
sang; ses étroits rapports religieux et commerciaux avec la Mecque
et l’Hedjaz ont eu nécessairement pour effet de répandre
sur son territoire les formes phonétiques qui régnaient dans cette
province. Ce n’est donc pas l’Yémen, au moins dans la province
de Tehamah, ou dans celles du littoral, qui peut fournir des
traces bien accusées de l’idiome kahtanique.
Je devrais maintenant me livrer à une dissertation abstraite
sur les Nabathéens et les Himyarites, dont j ’ai pour la première
fois rencontré des traces en Arabie. Mais ils seront l’objet d’une
étude spéciale dans les chapitres consacrés à l’Hasa et à l’Oman.
Ces considérations m’ont fait oublier que nous nous promenions
dans les rues et les jardins de la capitale ; le soleil de midi
est chaud, peut-être ceux qui ont bien voulu m’accompagner sont-
ils fatigués, et désirent-ils retourner au logis pour y prendre un
paisible repas de dattes et d’oignons, arrosé de trois tasses d’un
café tel que le lecteur, hélas! n’en goûte guère de semblable en
Europe. Nous allons donc nous reposer, puis nous reprendrons
notre récit, et en retraçant les incidents amenés par nos fonctions
médicales, nous compléterons de notre mieux le tableau
,de Riad et de ses habitants.