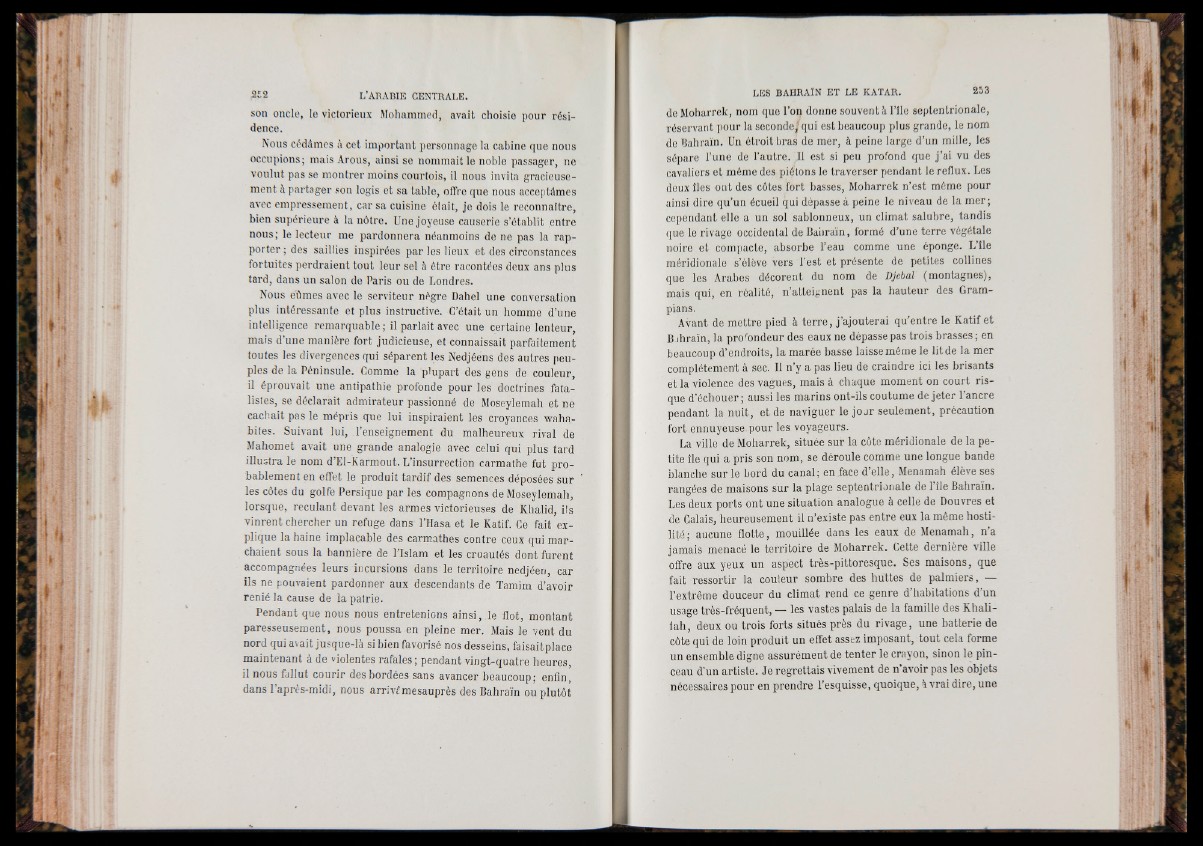
son oncle, le victorieux Mohammed, avait choisie pour résidence.
Nous cédâmes à cet important personnage la cabine que nous
occupions; mais Arous, ainsi se nommait le noble passager, ne
voulut pas se montrer moins courtois, il nous invita gracieusement
à partager son logis et sa table, offre que nous acceptâmes
avec empressement, car sa cuisine élait, je dois le reconnaître,
bien supérieure à la nôtre. Une joyeuse causerie s’établit entre
nous; le lecteur me pardonnera néanmoins de ne pas la rapporter
; des saillies inspirées par les lieux et des circonstances
fortuites perdraient tout leur sel à être racontées deux ans plus
tard, dans un salon de Paris ou de Londres.
Nous eûmes avec le serviteur nègre Dahel une conversation
plus intéressante et plus instructive. C’était un homme d’une
intelligence remarquable ; il parlait avec une certaine lenteur,
mais d’une manière fort judicieuse, et connaissait parfaitement
toutes les divergences qui séparent les Nedjéens des autres peuples
de la Péninsule. Comme la plupart des gens de couleur,
il éprouvait une antipathie profonde pour les doctrines fatalistes,
se déclarait admirateur passionné de Moseylemah et ne
cachait pas le mépris que lui inspiraient les croyances waha-
bites. Suivant lui, l’enseignement du malheureux rival de
Mahomet avait une grande analogie avec celui qui plus tard
illustra le nom d’El-Karmout. L’insurrection carmathe fut probablement
en effet le produit tardif des semences déposées sur
les côtes du golfe Persique par les compagnons de Moseylemah,
lorsque, reculant devant les armes victorieuses de Iihalid, ils
vinrent chercher un refuge dans l’Hasa et le Katif. Ce fait explique
la haine implacable des carmathes contre ceux qui marchaient
sous la bannière de l’Islam et les cruautés dont furent
accompagnées leurs incursions dans le territoire nedjéen, car
ils ne pouvaient pardonner aux descendants de Tamim d’avoir
renié la cause de la patrie.
Pendant que nous nous entretenions ainsi, le flot, montant
paresseusement, nous poussa en pleine mer. Mais le vent du
nord qui avait jusque-là si bien favorisé nos desseins, faisait place
maintenant à de violentes rafales ; pendant vingt-quatre heures,
il nous fallut courir des bordées sans avancer beaucoup; enfin,
dans l ’après-midi, nous arrivémesauprès des Bahraïn ou plutôt
deMoharrek, nom que l’on donne souvent à l’île septentrionale,
réservant pour la seconde^qui est beaucoup plus grande, le nom
de Bahraïn. Un étroit bras de mer, à peine large d’un mille, les
sépare l’une de l’autre. ,11 est si peu profond que j ’ai vu des
cavaliers et même des piétons le traverser pendant le reflux. Les
deux îles ont des côtes fort basses, Moharrek n’est même pour
ainsi dire qu’un écueil qui dépasse à peine le niveau de la mer;
cependant elle a un sol sablonneux, un climat salubre, tandis
que le rivage occidental de Bahraïn, formé d’une terre végétale
noire et compacte, absorbe l’eau comme une éponge. L’île
méridionale s’élève vers l’est et présente de petites collines
que les Arabes décorent du nom de Djebal (montagnes),
mais qui, en réalité, n’atteignent pas la hauteur des Gram-
pians.
Avant de mettre pied à terre, j ’ajouterai qu’entre le Katif et
Bihraïn, la profondeur des eaux ne dépasse pas trois brasses; en
beaucoup d’endroits, la marée basse laisse même le litde la mer
complètement à sec. Il n’y a pas lieu de craindre ici les brisants
et la violence des vagues, mais à chaque moment on court risque
d’échouer ; aussi les marins ont-ils coutume de jeter l’ancre
pendant la nuit, et de naviguer le joar seulement, précaution
fort ennuyeuse pour les voyageurs.
La ville de Moharrek, située sur la côte méridionale de la petite
île qui a pris son nom, se déroule comme une longue bande
blanche sur le bord du canal; en face d’elle, Menamah élève ses
rangées de maisons sur la plage septentrionale de l’île Bahraïn.
Les deux ports ont une situation analogue à celle de Douvres et
de Calais, heureusement il n’existe pas entre eux la même hostilité;
aucune flotte, mouillée dans les eaux de Menamah, n’a
jamais menacé le territoire de Moharrek. Cette dernière ville
offre aux yeux un aspect très-pittoresque. Ses maisons, que
fait ressortir la couleur sombre des huttes de palmiers, —
l’extrême douceur du climat rend ce genre d’habitations d’un
usage très-fréquent, --- les vastes palais de la famille des Khali-
fah, deux ou trois forts situés près du rivage, une batterie de
côte qui de loin produit un effet assez imposant, tout cela forme
un ensemble digne assurément de tenter le crayon, sinon le pinceau
d'un artiste. Je regrettais vivement de n’avoir pas les objets
nécessaires pour en prendre l’esquisse, quoique, à vrai dire, une