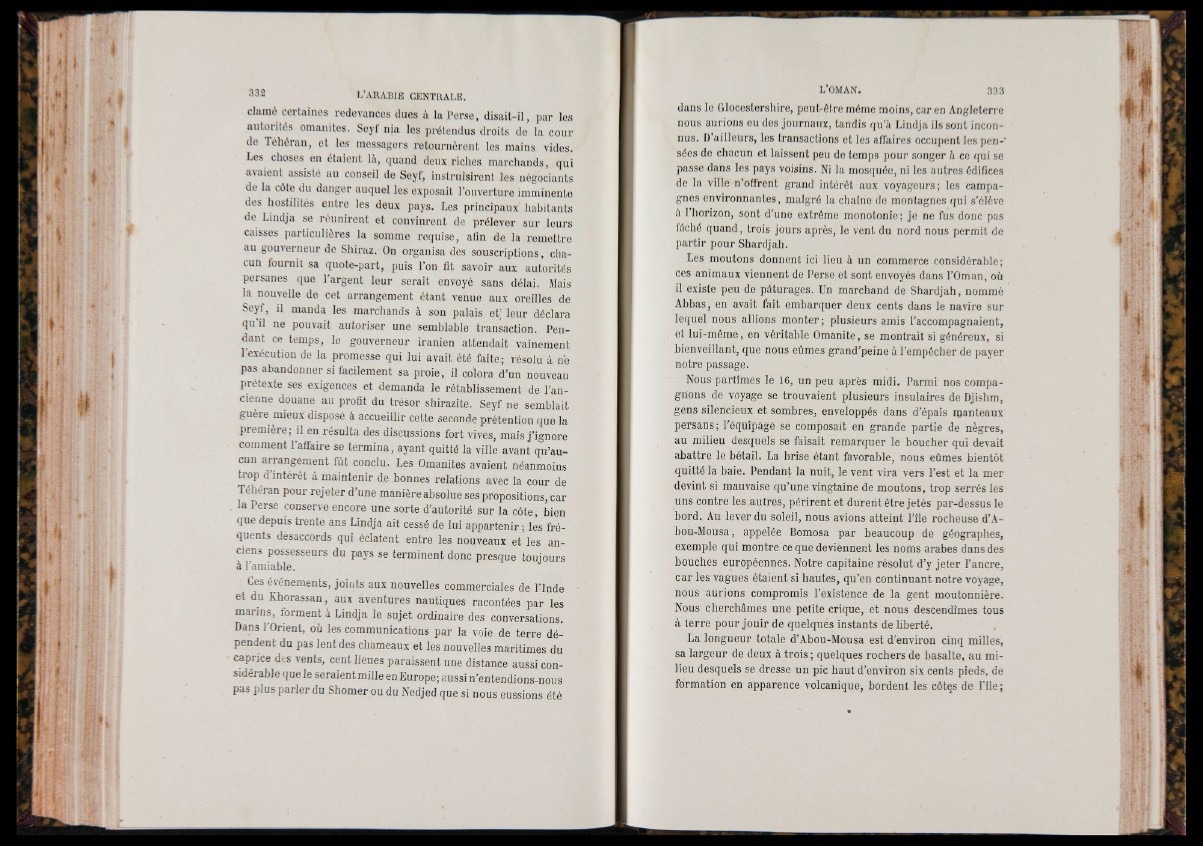
clamé certaines redevances dues à la Perse, disait-il, par les
autorités omanites. Seyf nia les prétendus droits de la cour
de Téhéran, et les messagers retournèrent les mains vides.
Les choses en étaient là, quand deux riches marchands, qui
avaient assisté au conseil de Seyf, instruisirent les négociants
de la côte du danger auquel les exposait l’ouverture imminente
des hostilités entre les deux pays. Les principaux habitants
de Lindja se réunirent et convinrent de prélever sur leurs
caisses particulières la somme requise, aiin de la remettre
au gouverneur de Shiraz. On organisa des souscriptions, chacun
fournit sa quote-part, puis l’on fit savoir aux autorités
persanes que l’argent leur serait envoyé sans délai. Mais
la nouvelle de cet arrangement étant venue aux oreilles de
Seyf, il manda les marchands à son palais et; leur déclara
qu il ne pouvait autoriser une semblable transaction. Pendant
ce temps, le gouverneur iranien attendait vainement
l’exécution de la promesse qui lui avait été faite; résolu à ne
pas abandonner si facilement sa proie, il colora d’un nouveau
prétexte ses exigences et demanda le rétablissement de l’ancienne
douane au profit du trésor shirazite. Seyf ne semblait
guère mieux disposé à accueillir cette seconde prétention que la
première; il en résulta des discussions fort vives, mais j’ignore
comment l’afifaire se termina, ayant quitté la ville avant qu’aucun
arrangement fût conclu. Les Omanites avaient néanmoins
trop d intérêt à maintenir de bonnes relations avec la cour de
Téhéran pour rejeter d’une manière absolue ses propositions, car
la Perse conserve encore une sorte d’autorité sur la côte, bien
que depuis trente ans Lindja ait cessé de lui appartenir ; les fréquents
désaccords qui éclatent entre les nouveaux et les anciens
possesseurs du pays se terminent donc presque toujours
à l’amiable.
Ces événements, joints aux nouvelles commerciales de l’Inde
et du Khorassan, aux aventures nautiques racontées par les
marins, forment à Lindja le sujet ordinaire des conversations.
Dans l’Orient, où les communications par la voie de terre dépendent
du pas lent des chameaux et les nouvelles maritimes du
caprice des vents, cent lieues paraissent une distance aussi considérable
que le seraient mille en Europe; aussi n’entendions-nous
pas plus parler du Shomer ou du Nedjed que si nous eussions été
dans le Glocestershire, peut-être même moins, car en Angleterre
nous aurions eu des journaux, tandis qu’à Lindja ils sont inconnus.
D’ailleürs, les transactions et les affaires occupent les pen-'
sées de chacun et laissent peu de temps pour songer à ce qui se
passe dans les pays voisins. Ni la mosquée, ni les autres édifices
de la ville n’offrent grand intérêt aux voyageurs; les campagnes
environnantes, malgré la chaîne de montagnes qui s’élève
à l’horizon, sont d’une extrême monotonie; je ne fus donc pas
lâché quand, trois jours après, le vent du nord nous permit de
partir pour Shardjah.
Les moutons donnent ici lieu à un commerce considérable;
ces animaux viennent de Perse et sont envoyés dans l’Oman, où
il existe peu de pâturages. Un marchand de Shardjah, nommé
Abbas, en avait fait embarquer deux cents dans le navire sur
lequel nous allions monter; plusieurs amis l’accompagnaient,
et lui-même, en véritable Omanite, se montrait si généreux, si
bienveillant, que nous eûmes grand’peine à l’empécher de payer
notre passage.
Nous partîmes le 16, un peu après midi. Parmi nos compagnons
de voyage se trouvaient plusieurs insulaires de Djishm,
gens silencieux et sombres, enveloppés dans d’épais manteaux
persans; l’équipage se composait en grande partie de nègres,
au milieu desquels se faisait remarquer le boucher qui devait
abattre le bétail. La brise étant favorable, nous eûmes bientôt
quitté la baie. Pendant la nuit, le vent vira vers l’est et la mer
devint si mauvaise qu’une vingtaine de moutons, trop serrés les
uns contre les autres, périrent et durent être jetés par-dessus le
bord. Au lever du soleil, nous avions atteint l’île rocheuse d’A-
bou-Mousa-, appelée Bomosa par beaucoup de géographes,
exemple qui montre ce que deviennent les noms arabes dans des
bouches européennes. Notre capitaine résolut d’y jeter l’ancre,
car les vagues étaient si hautes, qu’en continuant notre voyage,
nous aurions compromis l’existence de la gent moutonnière.
Nous cherchâmes une petite crique, et nous descendîmes tous
à terre pour jouir de quelques instants de liberté.
La longueur totale d’Abou-Mousa est d’environ cinq milles,
sa largeur de deux à trois ; quelques rochers de basalte, au milieu
desquels se dresse un pic haut d’environ six cents pieds, de
formation en apparence volcanique, bordent les côtes de l'île ;