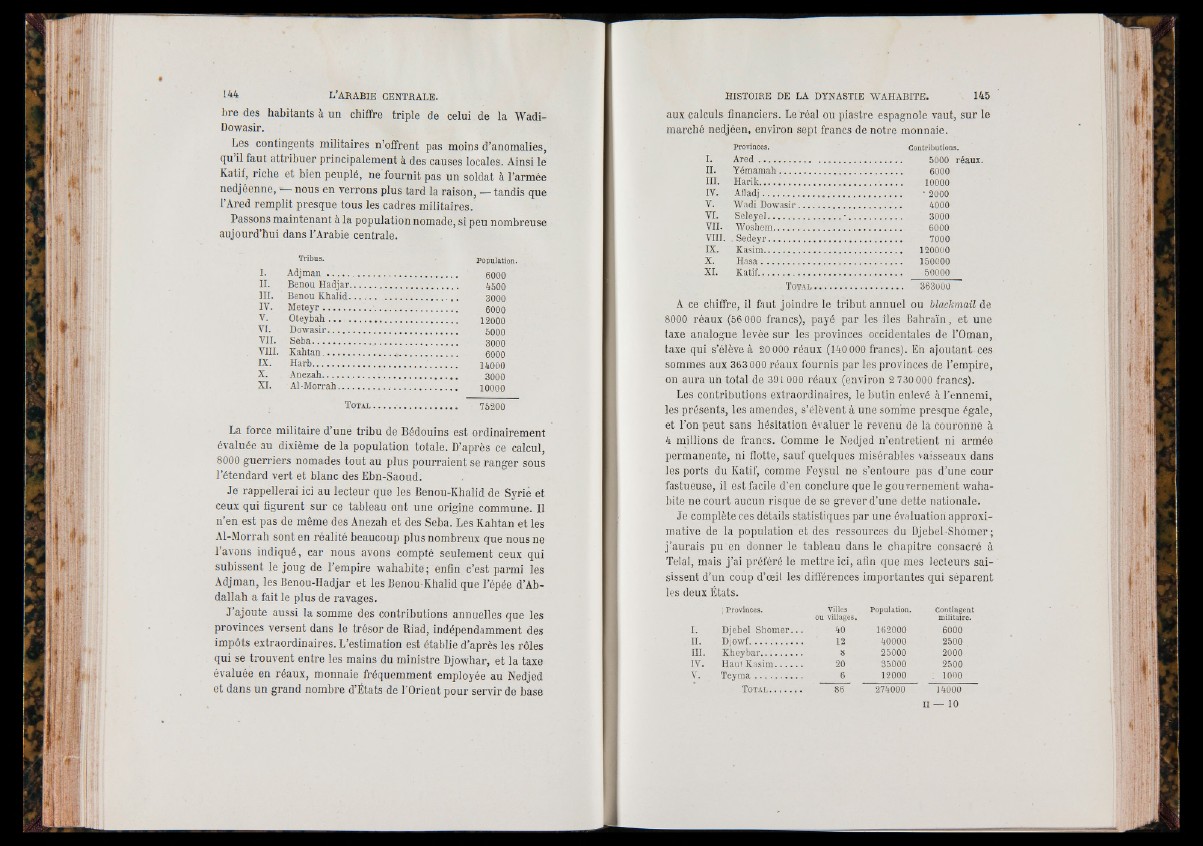
bre des habitants à un chiffre triple de celui de la Wadi-
Dowasir.
Les contingents militaires n ’offrent pas moins d’anomalies,
qu il faut attribuer principalement à des causes locales. Ainsi le
Katif, riche et bien peuplé, ne fournit pas un soldat à l’armée
nedjéenne, » nous en verrons plus tard la raison, —tandis que
i’Ared remplit presque tous les cadres militaires.
Passons maintenant à la population nomade, si peu nombreuse
aujourd’hui dans l’Arabie centrale.
T r ib u s . P o p u la tio n .
I. A d jm an .............................................. ' 6000
II. Benou Hadjar............................... ; ............ 4500
III. Benou K h a lid . ............................................ 3000
IV. Meteyr..................... 600o
V. O t e y b a h ............................................ 12000
VI. D o w a s ir ...................................................... 5000
VII. Seba................................................................. 3000
VIII. Kahtan................................ 6000
EL Harb.................................................... 14000
X. Anezah ................. 3000
XI. Al-Morrah....................... 10000
T o t a l . . ....................... 75200
La force militaire d’une tribu de Bédouins est ordinairement
évaluée au dixième de la population totale. D’après ce calcul,
8000 guerriers nomades tout au plus pourraient se ranger sous
l’étendard vert et blanc des Ebn-Saoud.
Je rappellerai ici au lecteur que les Benou-Khalid de Syrie et
ceux qui figurent sur ce tableau ont une origine commune. Il
n’en est pas de même des Anezah et des Seba. Les Kahtan et les
Al-Morrah sont en réalité beaucoup plus nombreux que nous ne
l’avons indiqué, car nous avons compté seulement ceux qui
subissent le joug de l’empire wahabite; enfin c’est parmi les
Adjman, les Benou-Hadjar et les Benou-Khalid que l’épée d’Abdallah
a fait le plus de ravages.
J ’ajoute aussi la somme des contributions annuelles que les
provinces versent dans le trésor de Riad, indépendamment des
impôts extraordinaires. L’estimation est établie d’après les rôles
qui se trouvent entre les mains du ministre Djowhar, et la taxe
évaluée en réaux, monnaie fréquemment employée au Nedjed
et dans un grand nombre d’États de l’Orient pour servir de base
aux calculs financiers. Le réal ou piastre espagnole vaut, sur le
marché nedjéen, environ sept francs de notre monnaie.
P ro v in c e s. Co n trib u tio n s.
I. A re d 5000 réaux.
II. Yémâmah .............................................. 6000
III. Harik .....................................■.......... 10000
IV. Afladj....................................................... • 2000
V. Wadi Dowasir.............................. 4000
VI. Seleyel.................. ..........• ...................... 3000
VII. Woshem........................... 6000
VIII. . Se.deyr................................................... 7000
IX. Kasim................................. 120000
X. Hasa 1........................................... 150000
XI. Katif. .............................. 50000
T o t a l . . ......................— _____ 363000
A ce chiffre, il faut joindre le tribut annuel ou blackmail de
8000 réaux (56 000 francs), payé par les îles Bahrain, et une
taxe analogue levée sur les provinces occidentales de l’Oman,
taxe qui s’élève à 20 000 réaux (140 000 francs). En ajoutant ces
sommes aux 363 000 réaux fournis par les provinces de l’empire,
on aura un total de 391 000 réaux (environ 2 730 000 francs).
Les contributions extraordinaires, le butin enlevé à l’ennemi,
les présents, les amendes, s’élèvent à une somme presque égale,
et l’on peut sans hésitation évaluer le revenu de la couronne à
4 millions de francs. Comme le Nedjed n’entretient ni armée
permanente, ni flotte, sauf quelques misérables vaisseaux dans
les ports du Katif, comme Feysul ne s’entoure pas d’une cour
fastueuse, il est facile d'en conclure que le gouvernement wahabite
ne court aucun risque de se grever d’une dette nationale.
Je complète ces détails statistiques par une évaluation approximative
de la population et des ressources du Djebel-Shomer ;
j’aurais pu en donner le tableau dans le chapitre consacré à
Telal, mais j ’ai préféré le mettre ici, afin que mes lecteurs saisissent
d’un coup d’oeil les différences importantes qui séparent
les deux États.
; Pro v in c e s. Villes
o u v illa g e s .
P o p u la tio n . C o n tin g en t
m ilita ire .
I. Djebel Shomer.. 40 162000 6000
II. Djowf................... 12 40000 2500
IH. Kheybar.............. 8 25000 2000
IV. Haut Kasim.. . . . 20 35000 2500
V. Teyma . . . . . . . . . 6 12000 . 1000
T o t a l ................ 86 274000 14000
I I — 1 0