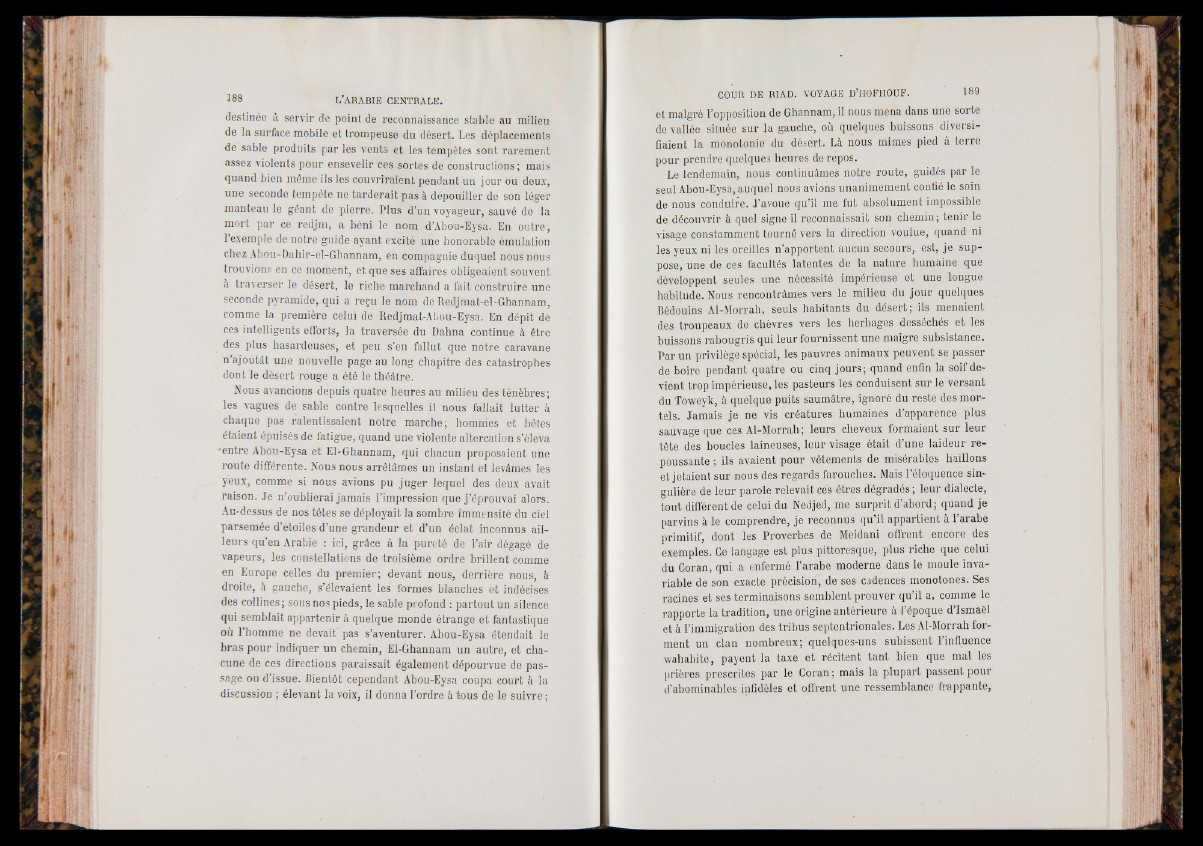
destinée à servir de point de reconnaissance stable au milieu
de la surface mobile et trompeuse du désert. Les déplacements
de sable produits par les vents et les tempêtes sont rarement
assez violents pour ensevelir ces sortes de constructions ; mais
quand bien même ils les couvriraient pendant un jour ou deux,
une seconde tempête ne tarderait pas à dépouiller de son léger
manteau le géant de pierre. Plus d’un voyageur, sauvé de la
mort par ce redjm, a béni le nom d’Abou-Eysa. En outre,
1 exemple de notre guide ayant excité une honorable émulation
chez Abou-Dahir-el-Ghannam, en compagnie duquel nous nous
trouvions en ce moment, et que ses affaires obligeaient souvent
à traverser le désert, le riche marchand a fait construire une
seconde pyramide, qui a reçu le nom de Redjmat-el-Ghannam,
comme la première celui de Redjmat-Abou-Eysa. En dépit de
ces intelligents efforts, la traversée du Dahna continue à être
des plus hasardeuses, et peu s’en fallut que notre caravane
n’ajoutât une nouvelle page au long chapitre des catastrophes
dont le désert rouge a été le théâtre.
Nous avancions depuis quatre heures au milieu des ténèbres;
les vagues de sable contre lesquelles il nous fallait lutter à
chaque pas ralentissaient notre marche; hommes et bêtes
étaient épuisés de fatigue, quand une violente altercation s’éleva
•entre Abou-Eysa et El-Ghannam, qui chacun proposaient une
route différente. Nous nous arrêtâmes un instant et levâmes les
yeux, comme si nous avions pu juger lequel des deux avait
raison. Je n’oublierai jamais l’impression que j ’éprouvai alors.
Au-dessus de nos têtes se déployait la sombre immensité du ciel
parsemée d’étoiles d’une grandeur et d’un éclat inconnus ailleurs
qu’en Arabie : ici, grâce à la pureté de l’air dégagé de
vapeurs, les constellations de troisième ordre brillent comme
en Europe celles du premier; devant nous, derrière nous, à
droite, à gauche, s’élevaient les formes blanches et indécises
des collines; sous nos pieds, le sable profond : partout un silence
qui semblait appartenir à quelque monde étrange et fantastique
où l’homme ne devait pas s’aventurer. Abou-Eysa étendait le
bras pour indiquer un chemin, El-Ghannam un autre, et chacune
de ces directions paraissait également dépourvue de passage
ou d’issue. Bientôt cependant Abou-Eysa coupa court à la
discussion ; élevant la voix, il donna l’ordre à tous de le suivre ;
et malgré l’opposition de Ghannam, il nous mena dans une sorte
de vallée située sur la gauche, où quelques buissons diversifiaient
la monotonie du désert. Là nous mîmes pied à terre
pour prendre quelques heures de repos.
Le lendemain, nous continuâmes notre route, guidés par le
seul Abou-Eysa, auquel nous avions unanimement confié le soin
de nous conduire. J’avoue qu’il me fut absolument impossible
de découvrir à quel signe il reconnaissait son chemin; tenir le
visage constamment tourné vers la direction voulue, quand ni
les yeux ni les oreilles n’apportent aucun secours, est, je suppose,
une de ces facultés latentes de la nature humaine que
développent seules une nécessité impérieuse et une longue
habitude. Nous rencontrâmes vers le milieu du jour quelques
Bédouins Al-Morrah, seuls habitants du désert; ils menaient
des troupeaux de chèvres vers les herbages desséchés et les
buissons rabougris qui leur fournissent une maigre subsistance.
Par un privilège spécial, les pauvres animaux peuvent se passer
de boire pendant quatre ou cinq jours; quand enfin la soif devient
trop impérieuse, les pasteurs les conduisent sur le versant
du Toweyk, à quelque puits saumâtre, ignoré du reste des mortels.
Jamais je ne vis créatures humaines d’apparence plus
sauvage que ces Al-Morrah; leurs cheveux formaient sur leur
tête des boucles laineuses, leur visage était d’une laideur repoussante
; ils avaient pour vêtements de misérables haillons
et jetaient sur nous des regards farouches. Mais l’éloquence singulière
de leur parole relevait ces êtres dégradés; leur dialecte,
tout différent de celui du Nedjed, me surprit d’abord ; quand je
parvins à le comprendre, je reconnus qu’il appartient à l’arabe
primitif, dont les Proverbes de Meidani offrent encore des
exemples. Ce langage est plus pittoresque, plus riche que celui
du Coran, qui a enfermé l’arabe moderne dans le moule invariable
de son exacte précision, de ses cadences monotones. Ses
racines et ses terminaisons semblent prouver qu’il a, comme le
rapporte la tradition, une origine antérieure à l’époque d’Ismaël
et à l’immigration des tribus septentrionales. Les Al-Morrah forment
un clan nombreux; quelques-uns subissent 1 influence
•wahabite, payent la taxe et récitent tant bien que mal les
prières prescrites par le Coran; mais la plupart passent pour
d’abominables infidèles et offrent une ressemblance frappante,