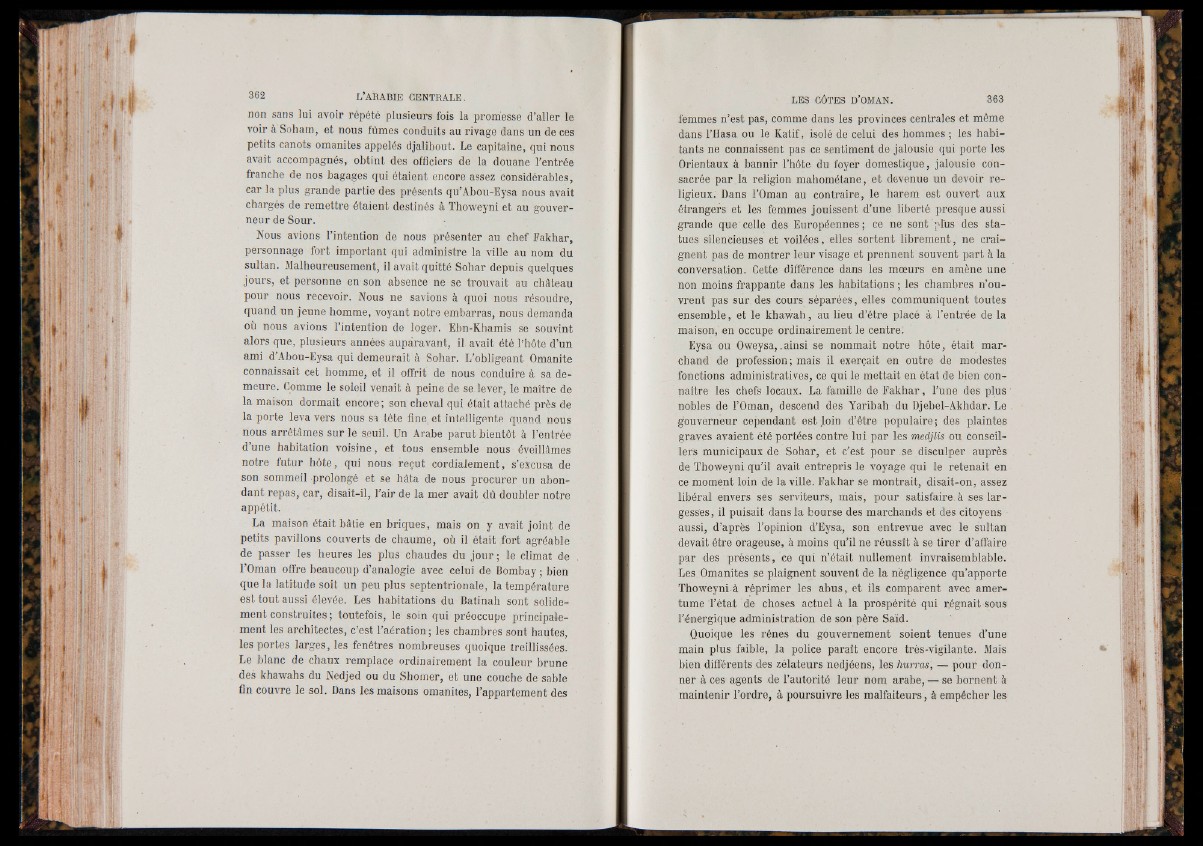
non sans lui avoir répété plusieurs fois la promesse d’aller le
voir à Soham, et nous fûmes conduits au rivage dans un de ces
petits canots omanites appelés djalibout. Le capitaine, qui nous
avait accompagnés, obtint des officiers de la douane l’entrée
franche de nos bagages qui étaient encore assez considérables,
car la plus grande partie des présents qu’Abou-Eysa nous avait
chargés de remettre étaient destinés à Thoweyni et au gouverneur
de Sour.
Nous avions l’intention de nous présenter au chef Fakhar,
personnage fort important qui administre la ville au nom du
sultan. Malheureusement, il avait quitté Sohar depuis quelques
jours, et personne en son absence ne se trouvait au château
pour nous recevoir. Nous ne savions à quoi nous résoudre,
quand un jeune homme, voyant notre embarras, nous demanda
où nous avions l’intention de loger. Ebn-Khamis se souvint
alors que, plusieurs années auparavant, il avait été l’hôte d’un
ami d’Abou-Eysa qui demeurait à Sohar. L’obligeant Omanite
connaissait cet homme, et il offrit de nous conduire à sa demeure.
Comme le soleil venait à peine de se lever, le maître de
la maison dormait encore; son cheval qui était attaché près de
la porte leva vers nous sa tête fine et intelligente quand nous
nous arrêtâmes sur le seuil. Un Arabe parut bientôt à l’entrée
d’une habitation voisine, et tous ensemble nous éveillâmes
notre futur hôte, qui nous reçut cordialement, s’excusa de
son sommeil prolongé et se hâta de nous procurer un abondant
repas, car, disait-il, l’air de la mer avait dû doubler notre
appétit.
La maison était bâtie en briques, mais on y avait joint de
petits pavillons couverts de chaume, où il était fort agréable
de passer les heures les plus chaudes du jo u r; le climat de
l’Oman offre beaucoup d’analogie avec celui de Bombay ; bien
que la latitude soit un peu plus septentrionale, la température
est tout aussi élevée. Les habitations du Batinah sont solidement
construites ; toutefois, le soin qui préoccupe principalement
les architectes, c’est l’aération; les chambres sont hautes,
les portes larges, les fenêtres nombreuses quoique treillissées.
Le blanc de chaux remplace ordinairement la couleur brune
des khawahs du Nedjed ou du Shomer, et une couche de sable
fin couvre le sol. Dans les maisons omanites, l’appartement des
femmes n’est pas, comme dans les provinces centrales et même
dans l’Hasa ou le Katif, isolé dé celui des hommes ; les habitants
ne connaissent pas ce sentiment de jalousie qui porte les
Orientaux à bannir l’hôte du foyer domestique, jalousie consacrée
par la religion mahométane, et devenue un devoir religieux.
Dans l’Oman au contraire, le harem est ouvert aux
étrangers et les femmes jouissent d’une liberté presque aussi
grande que celle des Européennes; ce ne sont plus des statues
silencieuses et voilées, elles sortent librement, ne craignent
pas de montrer leur visage et prennent souvent part à la
conversation. Cette différence dans les moeurs en amène une
non moins frappante dans les habitations ; les chambres n’ouvrent
pas sur des cours séparées, elles communiquent toutes
ensemble, et le khawah, au lieu d’être placé à l’entrée de la
maison, en occupe ordinairement le centre.
Eysa ou Oweysa,.ainsi se nommait notre hôte, était marchand
de profession; mais il exerçait en outre de modestes
fonctions administratives, ce qui le mettait en état de bien connaître
les chefs locaux. La famille de Fakhar, l’une des plus
nobles de l’Oman, descend des Yaribah du Djebel-Akhdar. Le
gouverneur cependant est loin d’être populaire; des plaintes
graves avaient été portées contre lui par les medjlis ou conseillers
municipaux de Sohar, et c’est pour se disculper auprès
de Thoweyni qu’il avait entrepris le voyage qui le retenait en
ce moment loin de la ville. Fakhar se montrait, disait-on, assez
libéral envers ses serviteurs, mais, pour satisfaire à ses largesses,
il puisait dans la bourse des marchands et des citoyens
aussi, d’après l’opinion d’Eysa, son entrevue avec le sultan
devait être orageuse, à moins qu’il ne réussît à se tirer d’affaire
par des présents, ce qui n’était nullement invraisemblable.
Les Omanites se plaignent souvent de la négligence qu’apporte
Thoweyni.à réprimer les abus, et ils comparent avec amertume
l’état de choses actuel à la prospérité qui régnait sous
l’énergique administration de son père Saïd.
Quoique les rênes du gouvernement soient tenues d’une
main plus faible, la police paraît encore très-vigilante. Mais
bien différents des zélateurs nedjéens, les hurras, — pour donner
à ces agents de l’autorité leur nom arabe, — se bornent à
maintenir l’ordre, à poursuivre les malfaiteurs, à empêcher les