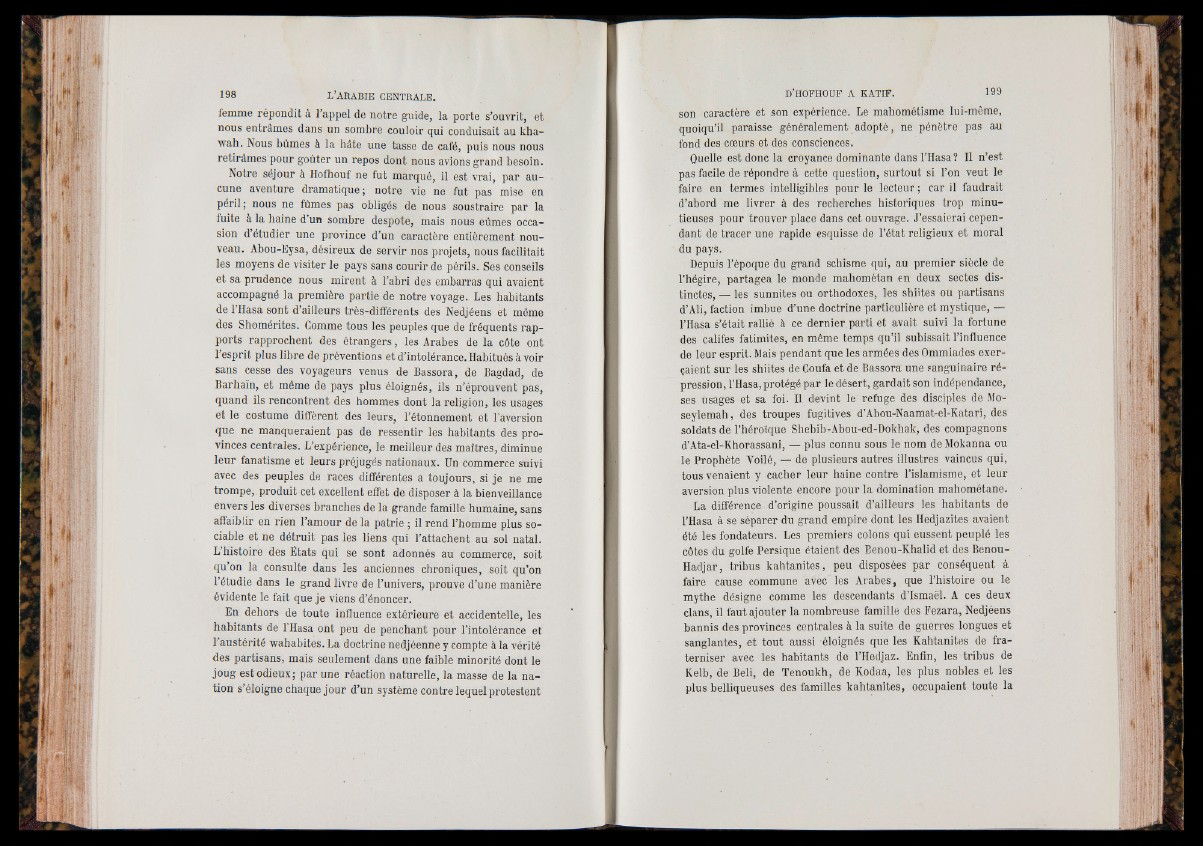
femme répondit à l’appel de notre guide, la porte s’ouvrit, et
nous entrâmes dans un sombre couloir qui conduisait au kha-
wah. Nous bûmes à la hâte une tasse de café, puis nous nous
retirâmes pour goûter un repos dont nous avions grand besoin.
Notre séjour à Hofhouf ne fut marqué, il est vrai, par aucune
aventure dramatique ; notre -vie ne fut pas mise en
péril; nous ne fûmes pas obligés de nous soustraire par la
fuite à la haine d’un sombre despote, mais nous eûmes occasion
d’étudier une province d’un caractère entièrement nouveau.
Abou-Eysa, désireux de servir nos projets, nous facilitait
les moyens de visiter le pays sans courir de périls. Ses conseils
et sa prudence nous mirent à l’abri des embarras qui avaient
accompagné la première partie de notre voyage. Les habitants
de l’Hasa sont d’ailleurs très-différents des Nedjéens et même
des Shomérites. Comme tous les peuples que de fréquents rapports
rapprochent des étrangers, les Arabes de la côte ont
l’esprit plus libre de préventions et d’intolérance. Habitués à voir
sans cesse des voyageurs venus de Bassora, de Bagdad, de
Barhaïn, et même de pays plus éloignés, ils n’éprouvent pas,
quand ils rencontrent des hommes dont la religion, les usages
et le costume diffèrent des leurs, l’étonnement et l ’aversion
que ne manqueraient pas de ressentir les habitants des provinces
centrales. L’expérience, le meilleur des maîtres, diminue
leur fanatisme et leurs préjugés nationaux. Un commerce suivi
avec des peuples de races différentes a toujours, si je ne me
trompe, produit cet excellent effet de disposer à la bienveillance
envers les diverses branches de la grande famille humaine, sans
affaiblir en rien l’amour de la patrie ; il rend l’homme plus sociable
et ne détruit pas les liens qui l’attachent au sol natal.
L’histoire des États qui se sont adonnés au commerce, soit
qu’on la consulte dans les anciennes chroniques, soit qu’on
l’étudie dans le grand livre de l’univers, prouve d’une manière
évidente le fait que je viens d’énoncer.
En dehors de toute influence extérieure et accidentelle, les
habitants de 1 Hasa ont peu de penchant pour l’intolérance et
l’austérité wahabites. La doctrine nedjéenne y compte à la vérité
des partisans, mais seulement dans une faible minorité dont le
joug est odieux; par une réaction naturelle, la masse de la nation
s’éloigne chaque jour d’un système contre lequel protestent
son caractère et son expérience. Le mahométisme lui-même,
quoiqu’il paraisse généralement adopté, ne pénètre pas au
fond des coeurs et des consciences.
Quelle est donc la croyance dominante dans l’Hasa? Il n’est
pas facile de répondre à cette question, surtout si l’on veut le
faire en termes intelligibles pour le lecteur ; car il faudrait
d’abord me livrer à des recherches historiques trop minutieuses
pour trouver place dans cet ouvrage. J’essaierai cependant
de tracer une rapide esquisse de l’état religieux et moral
du pays.
Depuis l’époque du grand schisme qui, au premier siècle de
l’hégire, partagea le monde mahométan en deux sectes distinctes,
— les sunnites ou orthodoxes, les shiites ou partisans
d’Ali, faction imbue d’une doctrine particulière et mystique, —
l’Hasa s’était rallié à ce dernier parti et avait suivi la fortune
des califes fatimites, en même temps qu’il subissait l’influence
de leur esprit. Mais pendant que les armées des Ommiades exerçaient
sur les shiites de Goufa et de Bassora une sanguinaire répression,
l’Hasa, protégé par le désert, gardait son indépendance,
ses usages et sa foi. Il devint le refuge des disciples de Mo-
seylemah, des troupes fugitives d’Abou-Naamat-el-Katari, des
soldats de l’héroïque Shebib-Abou-ed-Dokhak, des compagnons
d’Ata-el-Khorassani, — plus connu sous le nom de Mokanna ou
le Prophète Voilé, — de plusieurs autres illustres vaincus qui,
tous venaient y cacher leur haine contre l’islamisme, et leur
aversion plus violente encore pour la domination mahométane.
La différence d’origine poussait d’ailleurs les habitants de
l’Hasa à se séparer du grand empire dont les Iledjazites avaient
été les fondateurs. Les premiers colons qui eussent peuplé les
côtes du golfe Persique étaient des Benou-Khalid et des Benou-
Hadjar, tribus kahtanites, peu disposées par conséquent à
faire cause commune avec les Arabes, que l’histoire ou le
mythe désigne comme les descendants d’Ismaël. A ces deux
clans, il faut ajouter la nombreuse famille des Fezara, Nedjéens
bannis des provinces centrales à la suite de guerres longues et
sanglantes, et tout aussi éloignés que les Kahtanites de fraterniser
avec les habitants de l’Hedjaz. Enfin, les tribus de
Kelb, de Beli, de Tenoukh, de Kodaa, les plus nobles et les
plus belliqueuses des familles kahtanites, occupaient toute la