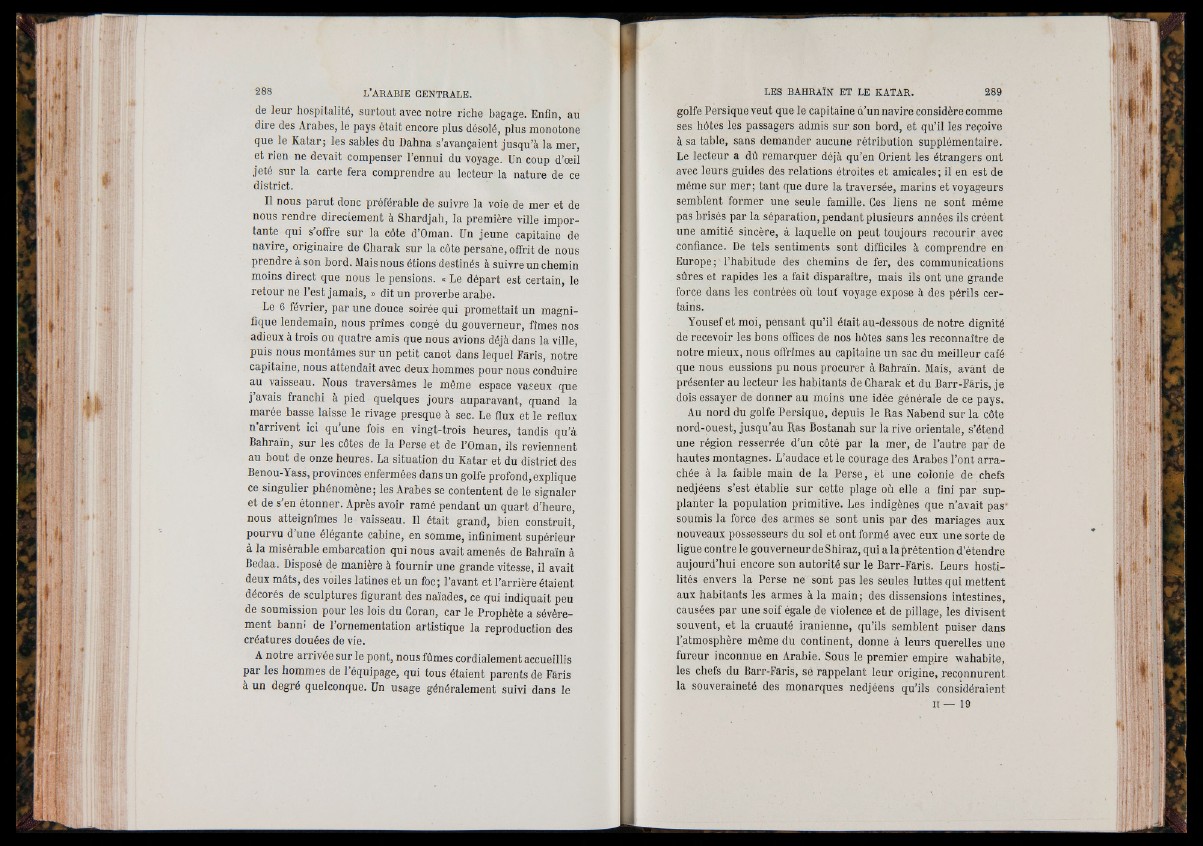
de leur hospitalité, surtout avec notre riche bagage. Enfin, au
dire des Arabes, le pays était encore plus désolé, plus monotone
que le Katar; les sables du Dahna s’avançaient jusqu’à la mer,
et rien ne devait compenser l’ennui du voyage. Un coup d’oeil
jeté sur la carte fera comprendre au lecteur la nature de ce
district.
Il nous parut donc préférable de suivre la voie de mer et de
nous rendre directement à Shardjah, la première ville importante
qui s’offre sur la côte d’Oman. Un jeune capitaine de
navire, originaire de Charak sur la côte persane, offrit de nous
prendre à son bord. Mais nous étions destinés à suivre un chemin
moins direct que nous le pensions. « Le départ est certain, le
retour ne l’est jamais, » dit un proverbe arabe.
Le 6 février, par une douce soirée qui promettait un magnifique
lendemain, nous prîmes congé du gouverneur, fîmes nos
adieux à trois ou quatre amis que nous avions déjà dans la ville,
puis nous montâmes sur un petit canot dans lequel Faris, notre
capitaine, nous attendait avec deux hommes pour nous conduire
au vaisseau. Nous traversâmes le même espace vaseux que
j avais franchi à pied quelques jours auparavant, quand la
marée basse laisse le rivage presque à sec. Le flux et le reflux
n arrivent ici qu une fois en vingt-trois heures, tandis qü’à
Bahraïn, sur les côtes de la Perse et de l’Oman, ils reviennent
au bout de onze heures. La situation du Katar et du district des
Benou-Yass, provinces enfermées dans un golfe profond, explique
ce singulier phénomène; les Arabes se contentent de le signaler
et de s en étonner. Après avoir ramé pendant un quart d’heure,
nous atteignîmes le vaisseau. Il était grand, bien construit’
pourvu d’une élégante cabine, en somme, infiniment supérieur
à la misérable embarcation qui nous avait amenés de Bahraïn à
Bedaa. Disposé de manière à fournir une grande vitesse, il avait
deux mâts, des voiles latines et un foc; l’avant et l’arrière étaient
décorés de sculptures figurant des naïades, ce qui indiquait peu
de soumission pour les lois du Coran, car le Prophète a sévèrement
banni de l’ornementation artistique la reproduction des
créatures douées de vie.
A notre arrivée sur le pont, nous fûmes cordialement accueillis
par les hommes de l’équipage, qui tous étaient parents de Fâris
à un degré quelconque. Un usage généralement suivi dans le
golfe Persique veut que le capitaine d’un navire considère comme
ses hôtes les passagers admis sur son bord, et qu’il les reçoive
à sa table, sans demander aucune rétribution supplémentaire.
Le lecteur a dû remarquer déjà qu’en Orient les étrangers ont
avec leurs guides des relations étroites et amicales; il en est de
même sur mer; tant que dure la traversée, marins et voyageurs
semblent former une seule famille. Ces liens ne sont même
pas brisés par la séparation, pendant plusieurs années ils créent
une amitié sincère, à laquelle on peut toujours recourir avec
confiance. De tels sentiments sont difficiles à comprendre en
Europe l’habitude des chemins de fer, des communications
sûres et rapides les a fait disparaître, mais ils ont une grande
force dans les contrées où tout voyage expose à des périls certains.
Yousef et moi, pensant qu’il était au-dessous de notre dignité
de recevoir les bons offices de nos hôtes sans les reconnaître de
notre mieux, nous offrîmes au capitaine un sac du meilleur café
que nous eussions pu nous procurer à Bahraïn. Mais, avant de
présenter au lecteur les habitants de Charak et du Barr-Fâris, je
dois essayer de donner au moins une idée générale de ce pays.
Au nord du golfe Persique, depuis le Ras Nabend sur la côte
nord-ouest, jusqu’au Ras Bostanah sur la rive orientale, s’étend
une région resserrée d’un côté par la mer, de l’autre par de
hautes montagnes. L’audace et le courage des Arabes l’ont arrachée
à la faible main de la Perse, ët une colonie de chefs
nedjéens s’est établie sur cette plage où elle a fini par supplanter
la population primitive. Les indigènes que n’avait pas*
soumis la force des armes se sont unis par des mariages aux
nouveaux possesseurs du sol et ont formé avec eux une sorte de
ligue contre le gouverneur de S hiraz, qui a la prétention d’étendre
aujourd’hui encore son autorité sur le Barr-Fâris. Leurs hostilités
envers la Perse ne sont pas les seules luttes qui mettent
aux habitants les armés à la main; des dissensions intestines,
causées par une soif égale de violence et de pillage, les divisent
souvent, et la cruauté iranienne, qu’ils semblent puiser dans
l’atmosphère même du continent, donne à leurs querelles une
fureur inconnue en Arabie. Sous le premier empire wahabite,
les chefs du Barr-Fâris, se rappelant leur origine, reconnurent
la souveraineté des monarques nedjéens qu’ils considéraient
n — 19