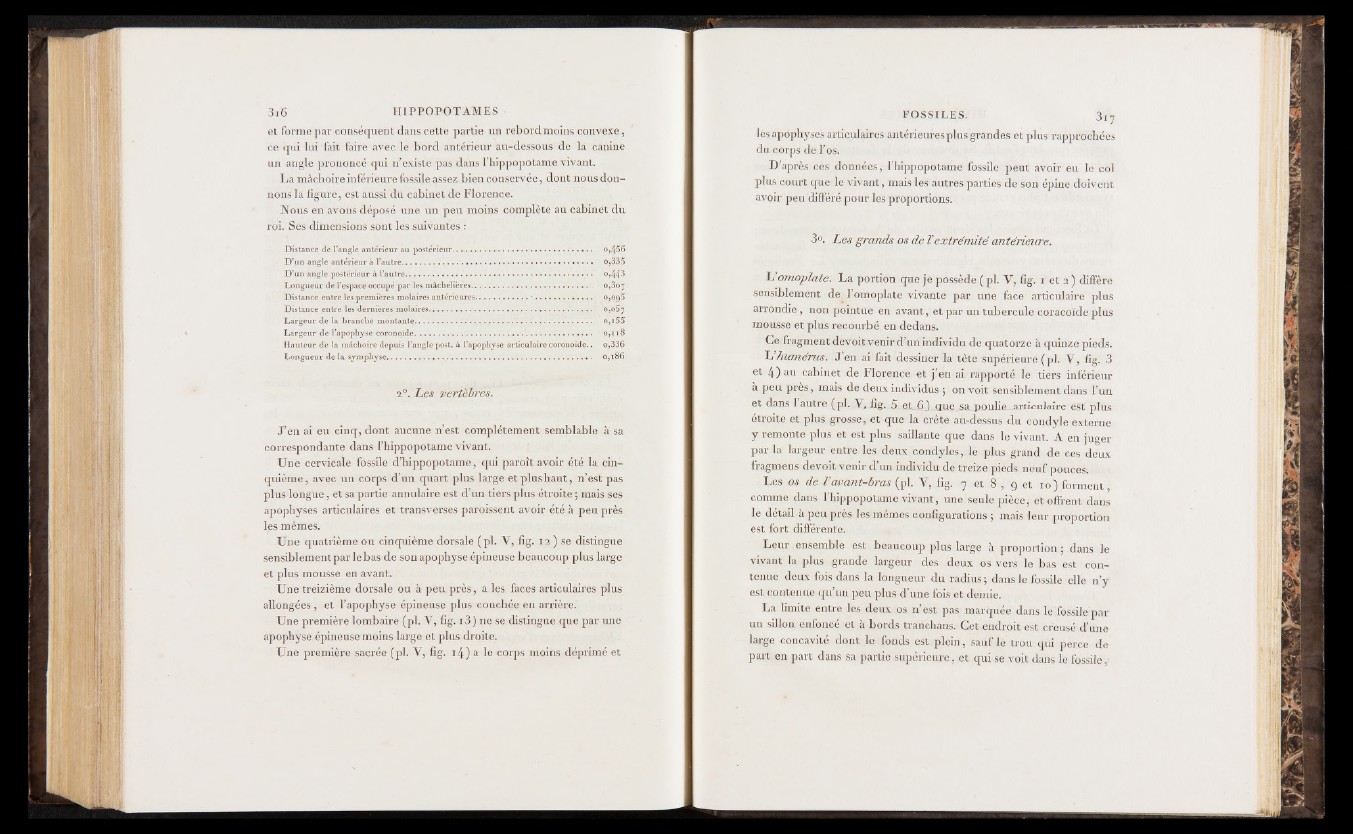
et forme par conséquent dans cette partie un rebord moins convexe,
ce qui lui fait faire avec le bord antérieur au-dessous de la canine
un angle prononcé qui n’existe pas dans l’hippopotame vivant.
La mâchoire inférieure fossile assez bien conservée, dont nous donnons
la figure, est aussi du cabinet de Florence.
Nous en avons déposé une un peu moins complète au cabinet du
roi. Ses dimensions sont les suivantes :
Distance de l’angle antérieur au postérieur.................................................................. o,456
D ’un angle antérieur à l’autre.......................................................................................* • o,335
D ’un angle postérieur à l’autre..................................................................................... o,443
Longueur dé l’espace occupé par les mâchelières.......................................................... 0,307
Distance entre les premières molaires antérieures.........................' . •.......................... 0,095
Distance entre les dernières molaires................................................... .. o,o5 j
Largeur de la branche montante........... ................................... ' . ..................... .. 0,155
Largeur de l’apophyse coronoïde.................................................................. .............. . ' 0,118
Hauteur de la mâchoire depuis l’angle post. à l’apophyse articulaire coronoïde.. 0,336
Longueur de la symphyse......................................... ....................................................... 0,186
20. L es vertèbres.
J’en ai eu cinq, dont aucune n’est complètement semblable à sa
correspondante dans l’hippopotame vivant.
Une cervicale fossile d’hippopotame, qui paroît avoir été la cinquième,
avec un corps d’un quart plus large et plus haut, n’est pas
plus longue, et sa partie annulaire est d’un tiers plus étroite; mais ses
apophyses articulaires et transverses paroissent avoir été à peu près
les mêmes.
Une quatrième ou cinquième dorsale (pi. Y , fig. 12 ) se distingue
sensiblement par le bas de son apophyse épineuse beaucoup plus large
et plus mousse en avant.
Une treizième dorsale ou à peu près, a les faces articulaires plus
allongées , et l’apophyse épineuse plus couchée en arrière.
Une première lombaire (pl. Y , fig. 13) ne se distingue que par une
apophyse épineuse moins large et plus droite.
Une première sacrée (pl. V, fig. i 4) a Ie corps moins déprimé et
les apophyses articulaires antérieures plus grandes et plus rapprochées
du corps de l’os.-
D’après ces données, l’hippopotame fossile peut avoir eu le col
plus court que le vivant, mais les autres parties de son épine doivent
avoir peu différé pour les proportions.
3«. L es grands os de Vextrémité antérieure.
L ’omoplate. La portion que je possède ( pl. Y , fig. 1 et 2 ) diffère
sensiblement de l’omoplate vivante par une face articulaire plus
arrondie, non pointue en avant, et par un tubercule coracoïde plus
mousse et plus recourbé en dedans.
Ce fragmentdevoitvenird’un individu de quatorze à quinze pieds.
L ’humérus. J’en ai fait dessiner la tête supérieure ( pl. V , fig. 3
et 4) au cabinet de Florence et j’en ai rapporté le tiers inférieur
à peu près, mais de deux individus ; on voit sensiblement dans l’un
et dans 1 autre (pl. V, fikr. 5 cL G j que sa jioulic :n'tienLare est plus
étroite et plus grosse, et que la crête au-dessus du condyle externe
y remonte plus et est plus saillante que dans le vivant. A en juger
par la largeur entre les deux condyles, le plus grand de ces deux
fragmens devoit venir d’un individu de treize pieds neuf pouces.
Les os de l ’avant-bras (pl. Y , fig. 7 et 8 , 9 et 10) forment,
comme dans l’hippopotame vivant, une seule pièce; et offrent dans
le détail à peu près les mêmes configurations ; mais leur proportion
est fort différente.
Leur ensemble est beaucoup plus large à proportion ; dans le
vivant la plus grande largeur des deux os vers le bas est contenue
deux fois dans la longueur du radius ; dans le fossile elle n’y
est contenue qu’un peu plus d’une fois et demie.
La limite entre les deux os n est pas marquée dans le fossile par
un sillon enfonce et à bords tranchans. Cet endroit est creusé d’une
large concavité dont le fonds est plein, sauf le trou qui perce de
part en part dans sa partie supérieure, et qui se voit dans le fossile ,-